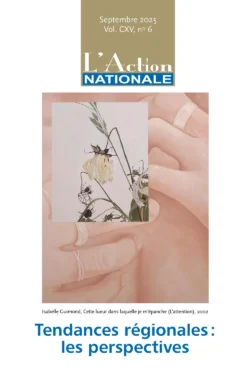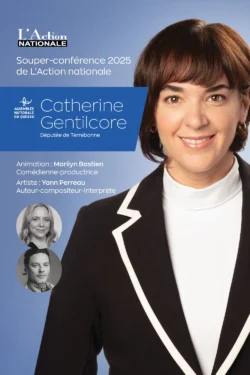Que signifie donc cette crise du logement au Québec qui n’épargne à peu près aucune ville et sévit depuis des années ? Explorons les conséquences souvent méconnues, mais qui frappent des centaines de milliers de nos concitoyens avec comme point de départ quelques constats accablants : dans un contexte de pénurie de logements à coût raisonnable et un taux d’inoccupation famélique, des ménages à revenu modeste doivent avoir un taux d’effort disproportionné pour payer leur loyer, 35-50 voire 70 % de leur revenu consacré à cette dépense. Des personnes qui au quotidien doivent composer avec des conditions d’habitation médiocre et qui n’osent déménager de peur de se retrouver devant rien. Et on pourrait aussi parler de ceux et celles se retrouvant justement dans ce vide… à la rue sans oublier une phase intermédiaire, celle du nomadisme, que l’on qualifie en anglais de couchsurfing : se déplacer d’un ami à l’autre pour se loger, en utilisant, ici un divan, là un sofa et souhaiter ne pas basculer dans le néant (dans la rue) avec ses conséquences délétères.
Deux sources d’information serviront de base : un rapport produit par la direction de la santé publique de Montréal en 2015 et plus près de nous, un dossier sur les inégalités sociales et le mal-logement récemment mis en ligne en 2024 par le réseau français des centres de santé communautaire.
Le portrait brossé dans le rapport publié en 2015 et signé par le docteur Richard Massé fournit un portrait inquiétant des conséquences de la crise du logement à Montréal. Bien que vieille de dix ans, ces données guère réjouissantes à ce moment, sont, selon toute apparence, encore d’actualité, voir, plus dramatiques en 2024. Ainsi, sur l’île de Montréal, on dénombrait déjà 210 000 ménages locataires devant consacrer plus de 30 % de leur revenu pour se loger. De ce nombre 95 000 ont souffert d’insécurité alimentaire et près de 50 000 n’ont pas eu assez de nourriture pour la simple raison d’un manque d’argent.
On voit donc la relation directe entre une charge de loyer trop exigeante et une alimentation inadéquate. Comme le mentionnait le docteur Massé, cela peut provoquer de nombreux problèmes de santé tels le diabète, l’hypertension, des maladies cardiovasculaires, l’obésité et plusieurs cancers.
Outre l’insécurité alimentaire, ce rapport révélait également que près de 30 % des ménages montréalais devaient composer avec au moins un problème d’insalubrité dans leur logement. Plus de 20 % avaient de la moisissure apparente ou des traces d’infiltration d’eau ; 9 %, des rongeurs (souris ou rats) ; 3,4 %, des punaises de lit et 3,3 %, des coquerelles. Ces facteurs d’insalubrité ne sont pas sans conséquences sur la santé humaine. On évoque le développement ou l’aggravation de maladies respiratoires telles que l’asthme, la rhinite allergique ou les infections respiratoires. On dénombrait 5 000 enfants victimes d’asthme en lien avec des problèmes d’humidité excessive ou de moisissures dans leur logement.
Du côté de la France, dans le rapport mis en ligne ces derniers mois par le réseau des centres de santé communautaire, on souligne les conséquences de la crise du logement en termes d’espérance de vie réduite, de précocité de l’apparition de pathologies chroniques. Ainsi, l’espérance de vie d’une personne sans domicile fixe est de 48 ans ! La mauvaise isolation de logement est une nuisance constante de ses occupants : trop froid en hiver, trop chaud l’été. On évoque aussi les enjeux de santé mentale : habiter dans un logement dégradé, conduit également à un processus de stigmatisation, de perte d’estime de soi. Les effets de la mauvaise qualité du logement et de sa suroccupation sur la santé mentale, la dépression, l’anxiété ont été scientifiquement démontrés.
L’OMS Europe a évalué que près de 130 000 décès sont associés sur une base annuelle à des conditions de logements inadéquates.
On cite également des données tirées du rapport annuel 2024 de la Fondation Abbé Pierre : 26 % des ménages ont eu froid chez eux en 2023 (14 % en 2020). On a dénombré 767 000 interventions pour impayés d’électricité en 2022 (553 000 en 2019), […] 330 000 personnes sont sans domicile (143 000 en 2012), […] et 2,4 millions de ménages sont en attente d’un logement social en 2022 (2 millions en 2017).
En somme, cette crise du logement ressemble à des métastases : sans traitement adéquat et pérenne, elle touche un nombre croissant de personnes, des gens qui basculent dans un quotidien de plus en plus lourd à supporter avec des impacts tant sur le plan de la santé physique qu’en matière de santé mentale. Fermer les yeux sur cette crise revient à cautionner de l’exclusion sociale à grande échelle, accepter qu’au quotidien, des centaines de milliers de personnes ne puissent s’épanouir et trouver leur place dans une société supposément post-moderne ou il fait bon vivre.
Changer de paradigme
Il est à la fois fascinant et décevant d’observer l’agitation politique au Québec sur la crise du logement avec une grande constante : une analyse de surface faisant l’impasse des fondements de cette crise et des mesures de correction à la marge qui évite soigneusement de proposer des solutions structurantes et à long terme.
Faut-il se rappeler que si le logement social et communautaire (LSC) représente dans certains pays (notamment le Danemark, l’Autriche et les Pays-Bas), au-delà de 20 % du parc locatif, au pays du Québec, selon les méthodes de calcul, il se situe autour de 4-5 % ?
Cette présence à la marge du LSC dans le parc locatif au Québec fait qu’on laisse principalement jouer les mécanismes du marché ce qui se traduit par une financiarisation du secteur, la marchandisation du logement et un puissant phénomène de spéculation avec les résultats catastrophiques que l’on connaît sur des dizaines de milliers de ménages qui doivent donc accorder un poids disproportionné à ce poste de dépense dans le budget familial.
Évitable ? Oui, mais en ne pratiquant pas les faux-fuyants. En outre, il faudrait trois qualités plutôt rarissimes chez nos décideurs, l’innovation, l’audace et une vision à long terme. L’écosystème du LSC québécois est aussi concerné par un changement de paradigme dans ses façons de faire. Bref, pour tous, penser en dehors de la boîte !
L’inspiration viennoise
En octobre 2023, j’ai eu le privilège de diriger une mission d’étude québécoise d’une semaine à Vienne sur la question du logement avec la fructueuse collaboration de l’ancienne numéro deux de la ville, Maria Vassilakous. Depuis, à la faveur de conférences, cours et autres séminaires donnés ici et en France, j’ai pu approfondir ma compréhension du miracle viennois en matière de LSC incluant la fructueuse période de 1918 à 1934 qualifié de Vienne la Rouge ! Ce miracle veut dire qu’à peu de chose près, avec ses 600 000 logements, le LSC représente tout près de 60 % du parc locatif de la capitale autrichienne ! Montréal, Québec, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke et autres villes ont du pain sur la planche avant d’atteindre ce seuil !
En raison des contraintes d’espace inhérent à ce type d’article, on ne peut qu’esquisser ces apprentissages sans trop les approfondir, mais cela devrait contribuer à mettre en relief des savoir-faire extrêmement inspirants !
Le point de départ se situe donc en 1918 avec l’élection d’un gouvernement municipal fruit d’une coalition de sociaux-démocrates et de chrétiens-sociaux. Face à une situation de logement catastrophique marqué par un nombre incalculable de taudis et la misère humaine en découlant – outre l’après règne des Habsbourg, on est aussi dans les affres de la fin de la Première Guerre mondiale avec une démobilisation massive de soldats, les autorités municipales décident d’une kyrielle de mesures en matière de logement social et… les mets en application ! Pour mémoire :
- La récupération de nombreux terrains et la constitution d’une importante réserve foncière ;
- La mise à la disposition de cette réserve pour du logement social ;
- La mise en place de deux systèmes de taxation pour financer ledit logement social ce qui inclut une taxe destinée aux grandes fortunes.
Ainsi, sur le seul plan du logement social (donc de type HLM), de 1919 à 1934, c’est plus de 65 000 unités qui verront le jour incluant le bien nommé Karl-Marx-Hof, un ensemble résidentiel de plus d’un kilomètre de long et offrant 5000 logements, le plus grand au monde en son temps !
Fait à relever, la ville ne veut pas créer de ghetto de pauvreté donc les ensembles de logements sociaux sont répartis en divers endroits du territoire !
Outre que ces logements sont à coût abordable pour la classe ouvrière, innovation pour l’époque, ils offrent l’accès à l’eau courante, à l’électricité, sont équipés de sanitaires dignes de ce nom en plus d’être connectés à un réseau d’égouts et sont conçus pour donner accès à un éclairage naturel. Ces ensembles résidentiels sont construits dans des environnements dotés d’espaces verts et de terrains de jeux. On a également multiplié le nombre de garderies et de services de santé. En somme, on a créé de toute pièce des milieux de vie agréable, mais plus essentiel encore, qui n’étrangle pas les finances familiales !
Il faut aussi savoir qu’au début des années 1920, Vienne s’est vu accorder le statut de Länder, soit l’équivalent canadien d’une province. Ce n’est pas rien, cela va lui donner des moyens additionnels pour mettre en œuvre ses actions incluant en matière de taxation et fiscalité. Pratico-pratique, en sus du logement social, on parle aussi de mesures touchant la protection sociale et la réforme scolaire.
Enfin, dernière initiative et non la moindre, se constitue dans les années 1920, les premières entités à profitabilité limitée (en anglais, Limited Profit Housing Association ou simplement LPHA), qui vont devenir des acteurs importants de développement de logements abordables, que l’on qualifierait au Québec de coopérative ou association à but non lucratif. Il s’agit donc d’une offre qui s’additionne au logement social de type HLM. Ainsi, en 1921, la ville de Vienne constitue la corporation GESIBA qui de ce fait, devient le plus vieux LPHA. Elle y détient plus de 99 % du capital, mais c’est une propriété passive, GESIBA est donc en gestion autonome avec son propre conseil d’administration.
La période 1934-1945 est une page sombre dans l’histoire de ce pays caractérisé par un gouvernement réactionnaire suivi en 1938 de l’Anschluss, soit l’annexion de l’Autriche à l’Allemagne nazie. C’est donc un intermède sur les mesures sociales incluant le logement.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les initiatives se bousculent pour reprendre des mesures structurantes touchant le logement abordable. Ainsi, en 1946, se constitue la fédération des LPHA qui en allemand, porte le nom de GBV suivie l’année suivante de l’engagement de l’État fédéral pour soutenir la multiplication des dits LPHA. En 1954, toujours au parlement autrichien, on adopte une loi sur le logement subventionné qui démultiplie les moyens pour de nouvelles constructions, le tout financé par un impôt sur le revenu. L’ensemble de ces mesures se traduit, à l’échelle du pays, par la construction de plus d’un million de logements sur quelques années !
Enfin, la ville de Vienne va adhérer successivement au concept de Smart City (2011) et de Smart Climate City (2022) ce qui va l’emmener à adopter et mettre en œuvre un plan avec 11 indicateurs incluant l’inclusion sociale, l’adaptation aux changements climatiques, le transport et la mobilité durable, la numérisation et les nouvelles constructions.
Le portrait en 2024
La ville de Vienne dispose de trois leviers pour intervenir sur la question du logement. Le Wiener Wohnen est sensiblement l’équivalent de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), mais avec un parc immobilier nettement supérieur. Ainsi, elle est la plus grande société immobilière d’Europe avec un parc de HLM de 220 000 logements. Pour mémoire, l’OMHM en détient un peu plus de 20 000 soit dix fois moins pour sensiblement la même population.
Le Wohnservice Wien est, comme son nom le suggère, un service-conseil gratuit créé en 2000 par Vienne dont la mission est d’informer et d’assister les citoyens et citoyennes dans tout ce qui a trait à l’habitation. Le service-conseil se charge également d’attribuer les logements subventionnés par la Ville.
Enfin, le Wohnfonds Wien constitue le bras immobilier de la ville. Ce fonds est engagé dans la construction et la rénovation urbaine, il fournit et aménage des terrains pour le logement social, acquiert des sites patrimoniaux et gère les concours/appels d’offres – au nom de la ville, pour de nouveaux ensembles résidentiels. L’organisme s’assure aussi de la coordination entre les promoteurs, les propriétaires, dans ces deux cas, ce sont souvent les LPHA et les services et départements de la ville. C’est également un contact obligé pour obtenir des subventions de la ville.
Dans un autre registre, à l’échelle du pays on relève 185 LPHA qui se divisent ainsi : 98 coopératives, 77 sociétés à responsabilité limitée et 10 sociétés anonymes. Ces LPHA détiennent en moyenne 4000 logements et des coopératives et peuvent regrouper plusieurs milliers de membres, voire jusqu’à 12 000. La plus grosse LPHA, Socialbau AG constitué en 1954 dispose d’un parc de 54 000 logements en plus de 577 locaux commerciaux ! On le devine, sur le plan de la taille des organisations, on est aux antipodes du Québec, par exemple, ici, la plus grosse coopérative d’habitation compte un peu plus de 500 membres.
Ces LPHA sont encadrés par une loi très stricte que l’on pourrait résumer par les dimensions suivantes :
L’audit est sous la responsabilité de GBV.
On pourrait ainsi se dire que ces règles limitent l’audace des LPHA ? Non, au contraire, elles servent de stimulants sans parler de la mise en concurrence des LPHA pour des appels d’offres. Le grand patron de GESIBA ne s’en est d’ailleurs pas caché lors d’un échange avec les participants de la mission : pour lui, incontestablement, la compétition encourage l’innovation ! Ainsi, l’organisation qu’il dirige, la plus vieille LPHA en Autriche, loin de dormir sur ses lauriers est continuellement à l’affût de nouvelles idées, de nouveaux créneaux. GESIBA qui dispose d’un parc de plus de 30 000 logements vise à moyen terme la carboneutralité et prenant acte du vieillissement de sa clientèle, a développé une nouvelle génération de résidence avec services pour aînés en perte d’autonomie donc avec des services d’assistance et de soins à la personne de grande qualité. Un contexte radicalement différent de nos trop nombreuses RPA québécoises à bout de souffle !
Il faut maintenant plonger dans l’architecture des montages financiers pour saisir la clé de cette formidable réussite du modèle viennois en matière de logement ! En quelques mots, il s’agit d’un système à quatre étages : le financement hypothécaire ; les prêts publics ; la mobilisation de l’équité des LPHA et la contribution financière de l’occupant.
Sous la responsabilité de quelques grandes banques, le financement hypothécaire consiste en l’émission d’obligations auprès du grand public, des régimes de retraite, des fonds institutionnels ou autres investisseurs pour une durée de 10-15 ans. Un avantage fiscal est consenti par l’État et le taux d’intérêt est de 1 % inférieur à celui du marché. Il y a presque systématiquement une seconde émission après 15 ans, car les prêts sont consentis pour des périodes de 30 ans.
Les prêts publics sont donc accordés par les municipalités, dans le cas qui nous occupe, Vienne. Ils sont généralement sur une période de 30-35 ans au taux de 1 %. Comment se finance le tout ? 33 % proviennent d’une contribution de l’employeur qui prélève 1 % sur la masse salariale et 66 % du rendement des anciens prêts subventionnés.
Il faut souligner que selon les projets et les clientèles prioritaires, il peut arriver que la ville verse des subventions au projet donc son action ne se limite pas à de seuls prêts.
La troisième mesure vise donc à exiger des LPHA qu’ils utilisent l’équité accumulée dans des projets existants pour investir dans de nouveaux projets. On parle ici de prêts d’une durée de 50 ans avec un taux d’intérêt oscillant de 2 à 3,5 %. Cette équité permet dans certains cas de couvrir 100 % des coûts du projet. En fait, à Vienne, chaque année, il s’agit de 6 000 logements financés uniquement avec cette équité sans autres apports ! Que serait la situation au Québec si on transposait cette pratique ? La mobilisation de l’équité de l’ensemble des coopératives d’habitation et des OBNL ! Un formidable levier de développement !
La dernière mesure qui, on le devine, pourrait sembler controversée au Québec, consiste en la contribution des membres (mise de fonds) en raison des coûts du foncier. Il s’agit d’un apport se situant entre 2 à 8 % du coût du projet avec dépréciation de 1 % par année. Ainsi, pour un membre ayant souscrit 30 000 € à l’origine du projet, après dix ans, il aura droit en un remboursement de 27 000 € soit une dépréciation annuelle de 300 €. Pour les personnes à faible revenu, il est possible de toucher une aide de l’État pour la mise de fonds.
Des résultats spectaculaires et avant-gardistes
La visite accompagnée de Vienne autour des projets immobiliers de l’époque de Vienne la Rouge, mais aussi de projets plus récents et d’autres en devenir n’est rien de moins qu’électrisante ! En 2024, le Karl-Marx-Hof est d’une architecture que l’on pourrait qualifier d’austère pour nos critères d’appréciation actuels, mais l’édifice est impeccablement entretenu et remplit toujours sa mission initiale près d’un centenaire après sa construction ! Au sommet de l’édifice central trône deux grand mat, on les devine accueillant les drapeaux de circonstance lors de la fête des Travailleurs dans les années 1920 qui regroupait des milliers d’ouvriers et leur famille dans une ambiance festive !
Situé près du centre-ville, Biotope City est une plongée dans un complexe résidentiel comprenant plus de 980 logements dont 400 qui sont subventionnés et 200 désignés SMART, c’est-à-dire, des logements de taille plus modeste pour personnes seules et à faible revenu. Comme l’essentiel des projets développés par les LPHA, Biotope est ainsi constitué avec une mixité de clientèle. C’est un projet qui date des années 2010 et se situe sur un ancien lieu d’exploitation de la firme Coca-Cola. En se promenant dans les cours intérieures, impossible de distinguer un immigrant récemment arrivé et à la recherche d’un emploi d’un professeur d’université !
Au-delà de ces aspects, ce qui détonne à Biotope est la végétation, et ce, en plein contexte urbain ! Laissons parler les données :
– Jardins communautaires de 600 m2
– Jardins de 3850 m2 au premier étage
– Environ 250 arbres
– Toiture végétalisée de 13 600 m2
– Végétalisation de façade de 2 200 m2
– Bassin de rétention de 760 m2
On ne sera pas surpris d’apprendre que ces mesures ont un impact direct pour atténuer l’effet des changements climatiques. Ainsi, on a vu des projets ou en jouant avec la densité de la végétation, éliminant les principaux îlots de chaleur et configurant la construction en créant une cour intérieure, on parvient à abaisser la température de 3 à 5 degrés ! Avec les épisodes à répétition de canicule, ce n’est pas rien !
Enfin, nous avons visité un quartier en émergence, le Seestadt, soit le 22e arrondissement de Vienne. On a commencé à aménager ce quartier en 2010 avec l’objectif de disposer de 10 000 logements d’ici 2028 ce qui en fait le plus grand complexe urbain en construction en Europe. Au milieu du site, on a creusé un lac artificiel peu profond, donc propice à la baignade.
En outre, on a commencé à déployer les transports en commun avant toute construction et par voie de conséquence, réduire drastiquement les espaces de stationnement auto. D’ailleurs en marchant sur le site, on ne voit pratiquement pas de voitures, mais une grande variété de vélos, vélos électriques, vélos cargo, etc. Probablement un avant-goût du futur par des villes avant-gardistes !
Les retombées
La première impression que nous laisse Vienne après une semaine à arpenter ses rues et quartiers est l’extraordinaire qualité de vie de ses résidents. Le tout est confirmé par un sondage annuel mené par la firme Mercer : Vienne trône régulièrement au sommet international du palmarès des villes sur le plan de la qualité de la vie !
Pas étonnant, même si tout n’est pas parfait, avec ces mesures touchant entre autres le logement, ici, on pratique activement l’inclusion sociale. Même si cela n’était pas le but de la mission, le nombre de personnes sans-abri est minime comparé à la situation catastrophique de Montréal. En une semaine, j’ai vu le nombre de personnes sans-abri que je vois en 5 minutes à proximité de l’UQAM.
Voilà, avec l’exemple viennois, une feuille de route qui démontre que la crise du logement n’est pas une fatalité, mais qu’avec une ferme volonté de changer les choses, on peut poser les fondations d’un devenir qui offre une place à tous !
Parler d’une seule voix !
Il ne fait aucun doute qu’avec la crise de logement que traverse le Québec, il importe d’avoir un puissant plaidoyer pour lancer des pistes et initiatives visant à corriger la situation, faire pression, produire des données probantes, etc. Or, l’observation de l’écosystème du logement social et communautaire (LSC) laisse voir un éclatement des acteurs.
Il y a les organismes à but non lucratif en habitation regroupée en fédérations régionales et qui elles-mêmes sont associées au sein du Regroupement québécois des OSBL d’habitation (RQOH). Depuis peu, des développeurs de logements à but non lucratif se sont concertés pour créer l’Alliance des corporations d’habitation abordables du territoire du Québec (ACHAT). On y retrouve, entre autres, la corporation le Mainbourg, Loge-action, l’UTILE, etc. Depuis plus de 35 ans, des organismes sont dédiés au développement du LSC, les groupes de ressources techniques, unis dans l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Ce réseau compte plus de 20 GRT dont certains ont aussi des sociétés acheteuses tel Bâtir son quartier (Montréal) et Action-Habitation (Québec). Sur le plan coopératif, la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) a été créée en 1987 à l’initiative de cinq fédérations régionales qui elles-mêmes regroupent les coopératives d’habitation de leur territoire. Cependant, ce secteur compose depuis quelques années avec une division. Ainsi, la Fédération des coopératives d’habitation de l’Île de Montréal communément appelée FÉCHIM s’est transformée en Fédération québécoise des coopératives d’habitation (FQCH).
Outre ces organismes, il existe aussi deux organisations qui ont des vocations de plaidoyer, le Regroupement des comités logement et association de locataires du Québec (RCLALQ) et le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).
Bonne nouvelle, depuis un certain temps, on assiste à une concertation de certains de ces acteurs comme en a témoigné le grand rassemblement national du LSC en mai 2024 au Palais des congrès de Montréal. Cela est incontestablement un pas dans la bonne direction !
Nous croyons cependant qu’à terme, il serait souhaitable de formaliser cette concertation dans une organisation faîtière qui serait ainsi un puissant levier de représentation, voire plus ! En portant notre regard sur le vieux continent, on relève que cette idée s’est matérialisée à l’échelle de quelques pays, sur le plan sous-continental et pour l’Europe entière. Voyons-y de plus près avec cinq cas.
Au moins trois pays en Europe disposent d’une entité unique pour parler au nom de l’ensemble du LSC : la France, le Danemark et l’Autriche. Ainsi, en France, depuis 1929, l’Union sociale pour l’habitat (USH) regroupe cinq entités et est l’intervenant pour défendre dans l’Hexagone le LSC. Du côté de l’Autriche, la Fédération GBV a vu le jour en 1946. Elle regroupe des sociétés coopératives, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes. Elle est omniprésente dans toutes les questions touchant les questions du LSC au pays de Mozart. Enfin au Danemark, l’organisme faîtier national du LSC, BL, est plus que centenaire, elle œuvre depuis 1919 ! En 1967, une loi a constitué le fonds national de construction et c’est le dirigeant de BL qui en est aussi le grand patron !
Les regroupements nationaux de LSC des pays nordiques, dont BL a fondé en 1950 l’organisme NBO, entité de concertation et de représentation. En matière de LSC, elle est donc l’interlocutrice du Conseil nordique des ministres (l’acronyme anglais NCM). S’inspirant des objectifs de développement durable des Nations unies, ce Conseil s’est doté de sa propre vision 2030 qui n’ambitionne rien de moins que dans un horizon de 5-6 ans, en faire la région du monde la plus intégrée et engagée en matière de développement durable ! Un de ces objectifs se présente ainsi : une région socialement équitable : qui met la priorité sur le bien-être, l’égalité et l’inclusion. On devine que la question du logement est centrale dans ce plan !
Enfin à l’échelle de l’Europe, c’est en 2008, que des organismes nationaux de LSC – dont l’USH, BL et la Fédération GBV –, ont constitué Housing Europe. En 2024, c’est donc l’entité qui se veut le porte-parole du LSC auprès des diverses instances européennes, dont la Commission européenne et le Parlement européen.
En observant plus en détail ces divers regroupements de LSC en Europe, il ressort qu’au-delà d’être une entité unique donnant une formidable force de frappe sur cet enjeu dans le débat public, souvent on dispose d’une cellule de recherche pour documenter les diverses dimensions du LSC. Disposant ainsi de données probantes, il est plus aisé d’intervenir dans le débat public, chiffre à l’appui!
C’est ce que l’on retrouve avec Housing Europe dans son observatoire qui publie un portrait annuel extrêmement fouillé de l’état du logement en Europe. En Autriche, la Fédération GBV a aussi une responsabilité de réaliser des études sur le LSC. Elle ne les fait pas elle-même, mais a une entente de collaboration avec l’Institut autrichien d’études économiques (WIFO).
Ainsi, en 2021, elle a fait réaliser une étude par WIFO portant sur l’impact économique des LPHA. En quelques mots, le rapport permet ainsi de comprendre à quel point les réductions de loyer généré par le modèle d’affaires résidentiel à but non lucratif c’est-à-dire louer au coûtant, a un impact significatif sur le budget des ménages en termes de baisse de la charge habitation, mais exerce aussi un impact sur le coût moyen de l’habitation à l’échelle du pays, le pouvoir d’achat des ménages et le PIB.
En France, avec une équipe de plus de 70 employés, une multitude de commissions d’études et groupe de travail, l’USH dispose d’une formidable capacité de production de rapports et études diverses pour nourrir le débat.
Ces organismes faîtiers proposent aussi à leurs membres des formations et autres séminaires, directement ou indirectement. De nouveau, du côté de l’Autriche, cela se fait en collaboration avec un institut.
À quand un GBV ou BL québécois?
* Expert-conseil international en entrepreneuriat collectif