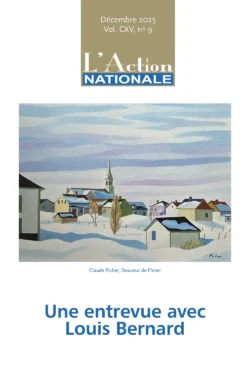Le spectacle en désole plusieurs et, pourtant, rien de ce qu’il nous offre n’est vraiment surprenant. Les choses meurent. Et, en politique, elles ne meurent que dans l’insignifiance. La province de la survivance a terminé sa vie utile. Le Québec ne peut plus se penser dans ce que lui laisse son régime vétuste, le cadre de pensée du minoritaire qui s’efforce de se convaincre qu’il y a toujours moyen de moyenner. L’effondrement de la CAQ, la déliquescence du Parti libéral, l’implosion de Québec solidaire et la régression dans le ressentiment de la tentative de ressusciter un parti conservateur provincial ont d’ores et déjà signé non pas seulement la fin d’un cycle politique, mais bien la mort de la politique provinciale.
En effet, ce que ces convulsions révèlent, c’est bien l’impasse absolue dans laquelle les projets d’alibis viennent s’enliser. Les provinciaux ne sont plus capables de produire du sens. Ils ne sont plus capables de concevoir et de proposer un destin. Leurs malheurs leur viennent de ce qu’ils ne sont porteurs de rien d’autre que du consentement. Ce que la pensée politique avait coutume de désigner comme la question québécoise – ou, dans sa version plus affirmée, les « revendications du Québec » – s’est littéralement volatilisé. Le Canada est devenu leur horizon indépassable. Leur prison mentale. Ils n’ont plus d’espace politique que le clientélisme de résignation, celui qui s’occupe des vraies affaires. Ils ont même du mal à assumer notre nom, nous donnant du « francophone » à qui mieux mieux et ne voyant notre destin que dans le bricolage de sondages et l’assemblage de segments de l’électorat.
Le Canada en a fini avec le Québec. Il n’en a plus que pour les manœuvres d’organisateurs d’élection. Les francophones de service ont de moins en moins d’utilité, et cela a scellé le sort des « fédéralistes » québécois. Ils ne savent plus comment recycler le pseudo-réformisme qui leur donnait une posture. Non seulement les autonomistes de la CAQ ont détruit toute forme d’illusion à cet égard, mais encore et surtout, le Canada les a-t-il privés de tout espace de dialogue. Le Québec n’est plus un interlocuteur dans la recherche d’une amélioration du régime, comme on l’a longtemps laissé entendre. Il n’est désormais qu’une composante à ajuster, un rouage dans la prestation de service. La politique fédérale se décline selon des paramètres auxquels il doit se conformer et plus personne ne songe aux fioritures rhétoriques. La nomination d’un Miller agacé par ce qu’il entend en a fourni une illustration qui fera florès.
Le Canada est d’ores et déjà en campagne anti-séparatiste. L’embardée de Pablo et ses suites l’amènent à penser son positionnement en fonction de l’agenda du Parti québécois. À Ottawa, l’on sait qu’il ne sera pas facile – et que c’est peine perdue – de tenter de parachuter une figure crédible. Les Mélanie Joly et François-Philippe Champagne sont irrémédiablement folkloriques. Restera la peur et l’on a vu avec Joly combien la profondeur de vue peut la rendre risible : la menace américaine lancée devant un sondage n’a pas tardé à la faire voir telle que son rôle la campe dans les officines d’Ottawa. Ces personnages ne sont destinés qu’à la consommation locale, au vaudeville provincial. Les libéraux du Québec seront peut-être tentés de faire le coup d’un successeur nationaliste et de se tourner vers le Milliard de la dernière audition de figurants. Son sort est déjà réglé : depuis l’épisode Anglade, tout ce qui a l’air d’une concession pour courtiser les segments francophones est immédiatement rejeté.
Le Parti libéral du Québec est un parti ethnique et son establishment n’a que faire de ces calculs électoralistes : il reste convaincu que c’est Ottawa qui va dénouer l’impasse en cassant les reins des séparatistes. La noyade démographique est au programme, comme l’a annoncé Christos Sirros de sinistre mémoire au lendemain de 1995. Il faut miser sur l’usure et la démoralisation. La raison d’État canadian s’accommode fort bien de cette patience. Et Ottawa ne ménagera rien du côté des prébendes pour encourager les pressés à prendre leur mal en patience. Il ne sert donc à rien de s’agiter dans la politique provinciale. C’est ce que les Québécois et les Québécoises doivent réaliser. C’est ce que les indépendantistes doivent leur faire réaliser.
La prochaine élection sera la toute première élection nationale de notre histoire. Sa logique et ses enjeux ne se déploieront que dans l’espace intérieur. L’indépendance est la seule issue pour éviter d’officialiser le consentement à notre propre effacement. La minorisation est chose faite dans la dynamique outaouaise : un gouvernement fédéral majoritaire peut être formé sans aucun député du Québec. L’enjeu de la politique québécoise ne porte plus que sur l’internalisation de ce consentement, que sur la provincialisation minoritaire. Le dilemme est existentiel et il se pose d’ores et déjà sans ornement rhétorique. Sera-t-il tranché cette fois-ci ou les Québécois tenteront-ils encore de tergiverser? La question n’est pas futile, mais la réponse canadian est déjà posée : il n’y aura pas d’autre destin pour notre peuple dans ce régime.
Il appartiendra au Parti québécois et aux indépendantistes de faire comprendre qu’il n’y aura pas de redressement possible du délabrement provincial dans le Canada qui se fait. Cela dresse des obstacles qu’on aurait tort de ne pas nommer : non seulement l’échec de la CAQ laisse-t-il le Québec dans un marasme sans nom, mais aucune conjoncture provinciale ne permet d’envisager une sortie de crise dans un Canada irréformable et ayant refusé de le faire.
Il faut l’indépendance.