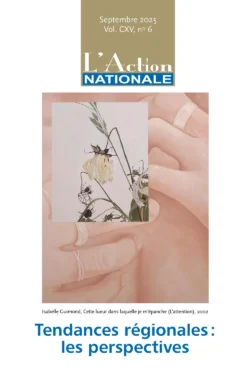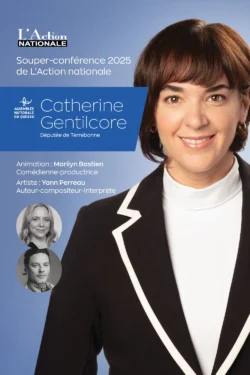Le 14 décembre 2000, Jean Charest interpelle le premier ministre Bouchard au sujet de propos qu’Yves Michaud aurait tenu la veille et annonce qu’une motion sera présentée après la période de questions : « Que l’Assemblée nationale dénonce sans nuance, de façon claire et unanime, les propos inacceptables à l’égard des communautés ethniques et, en particulier, à l’égard de la communauté juive tenus par Yves Michaud à l’occasion des audiences des États généraux sur le français à Montréal le 13 décembre 2000. »
« … exécuté sur la place publique »
Généralement, le premier ministre trouve le moyen d’esquiver les questions du chef de l’Opposition. Contre-attaquer, répondre à côté de la question, reporter la réponse, blaguer : tous les moyens sont permis à la période des questions orales, quand on veut défendre le gouvernement ou le parti, mais, le 14 décembre 2000, Lucien Bouchard ne semblait pas mécontent voir Jean Charest essayer de l’embêter.
Yves Michaud était pressenti comme candidat à l’élection partielle dans Mercier, ce qui ne plaisait pas du tout au premier ministre. La motion permettait donc aux deux chefs de projeter hors-piste un militant dérangeant. L’affaire ayant vraisemblablement été orchestrée en coulisses, le premier ministre accueille alors favorablement la proposition et engage à l’avance « toute la députation ministérielle ».
Une heure plus tard, la motion proposée conjointement par André Boulerice et Lawrence Bergman est adoptée, séance tenante, à l’unanimité des 109 députés présents, sans qu’on sache un mot des « propos inacceptables » dénoncés et sans débat.
À la sortie, le ministre Sylvain Simard déclare que Michaud a « banalisé l’Holocauste […] ». Bernard Landry abonde dans le même sens : « [M. Michaud] a nié l’épisode le plus barbare de l’Histoire humaine dans son exceptionnalité. »
Gérald Larose, qui présidait la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, a appris aux nouvelles du soir qu’un des témoins qui s’était présenté devant lui dans la journée était condamné par l’Assemblée nationale pour des propos dont il n’avait absolument aucun souvenir ni le secrétaire de la Commission qui est néanmoins allé vérifier. Larose n’avait pas la berlue : Michaud n’a jamais parlé de l’Holocauste la veille, comme en témoigne la transcription officielle de son intervention qui ne contient pas de « propos inacceptables » contre le peuple juif qu’il a présenté comme modèle aux Québécois qui souhaitent affirmer « leur propre identité nationale ».
Des tentatives de réparation
Yves Michaud demande sans succès d’être entendu par l’Assemblée nationale. Il est ensuite débouté en Cour supérieure et en Cour d’appel (2006), tandis que la Cour suprême refuse de l’entendre. Un juge de la Cour d’appel a cependant ajouté un « obiter dictum » (« soit dit en passant ») étonnant au bas de la décision rendue par sa collègue la juge Dutil : « […] le Droit à l’époque des Chartes et de la prédominance des droits individuels permet qu’un individu soit condamné pour ses idées (bonnes ou mauvaises, politiquement correctes ou non, la chose importe peu), et ce sans appel et qu’il soit ensuite exécuté sur la place publique sans, d’une part, avoir eu la chance de se défendre et, d’autre part, sans même que les raisons de sa condamnation aient préalablement été clairement exposées devant ses juges, les parlementaires ».
Le juge Baudouin constatait implicitement l’injustice et, sans le dire ouvertement, relançait la balle à l’Assemblée nationale, mais son commentaire est pratiquement passé inaperçu et les parlementaires (que Me Jean-C. Hébert a qualifiés de « juges en culottes courtes ») l’ont ignoré.
Le livre L’affaire Michaud : chronique d’une exécution parlementaire est publié en octobre 2010. « Il est maintenant clair, commente Michel David, que M. Michaud n’a pas tenu devant la Commission des États généraux sur la langue les propos antisémites qu’on lui a reprochés ». Selon Gilbert Lavoie, le livre établit « clairement qu’on lui a imputé des propos qu’il n’a pas tenus et qu’on l’a jugé sans vérifier la véracité des accusations portées contre lui ». Michaud « a perdu sa bataille devant les tribunaux et n’a pas eu gain de cause à l’Assemblée nationale, écrivait encore Lavoie, mais il a gagné la guerre aux yeux de l’histoire » et cette victoire « constitue une leçon pour les parlementaires ». Stéphane Bédard lui donne raison en mars 2011, lorsque le PQ refuse d’appuyer une motion du même genre présentée par le député de D’Arcy-McGee (encore !) : « […] on a appris une chose. […] à l’Assemblée, on n’est pas un tribunal. On ne peut pas condamner un individu […]. Il y a des lieux pour ça, et, si des gens ont tenu des propos haineux, il y a des tribunaux pour les condamner ».
Au Parlement, le 1er décembre 2010, le député Amir Khadir essaie de présenter une motion par laquelle l’Assemblée nationale reconnaîtrait « avoir commis une erreur ». Le Parti libéral aurait donné son consentement, mais le Parti québécois refuse le débat, craignant qu’on refasse le procès de Michaud… Visiblement dissidents sur cette question, des membres du caucus péquiste expriment des excuses à l’endroit de Michaud, ajoutant leur nom à la courte liste des ex-parlementaires qui l’avaient fait peu après la sortie de L’affaire Michaud en octobre (Joseph Facal, Louise Beaudoin). Puis, les excuses se multiplient. L’ancien ministre Paul Bégin contacte ses ex-collègues : un mois plus tard, 51 membres du caucus péquiste de décembre 2000 avaient fait amende honorable. Certains s’expliquent publiquement. Claude Lachance reconnaît avoir été « carrément floué ». Mathias Rioux exprime « la honte [qu’il] éprouve d’avoir été roulé dans la farine par des manipulateurs 1» et pose une question qui n’a toujours pas de réponse : « Quel personnage ou quel groupe a instrumentalisé Bernard Landry et Sylvain Simard […] ? » François Beaulne explique qu’il a voté suivant « la volonté du chef » et en se fiant à la « grande crédibilité » des coauteurs de la motion, Lawrence Bergman et André Boulerice ; or, ce dernier écrit en janvier 2011 « que les propos de M. Michaud avaient été inventés ou interprétés vraisemblablement dans le but de tromper ou de provoquer une vive réaction émotive ».
Pendant plusieurs années, le comité Solidarité Yves Michaud milite pour obtenir justice. En 2016, Yves Michaud s’adresse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sans succès. On a même envisagé une démarche devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU.
En 2018, une pétition est déposée à l’Assemblée par l’intermédiaire d’un député du PQ, qui se limite à un « geste d’estime », selon le mot du chef du parti, et ne la soumet même pas à la commission compétente pour étudier les pétitions, faisant ainsi avorter le processus.
Le 11 décembre 2020, Pascal Bérubé sollicite le consentement de l’Assemblée afin de présenter, conjointement avec le leader du deuxième groupe d’opposition et la députée de Marie-Victorin, la motion sans préavis suivante :
Que l’Assemblée nationale reconnaisse avoir commis une erreur le 14 décembre 2000 en condamnant M. Yves Michaud ;
Qu’elle admette qu’à titre d’institution parlementaire, elle n’est pas le forum approprié pour blâmer un citoyen ou rendre justice ;
Qu’elle réitère que seuls les tribunaux sont en mesure de garantir le respect des droits fondamentaux de chacun, tel le droit à une défense pleine et entière, et celui d’être entendu par une instance impartiale et indépendante ;
Qu’elle reconnaisse que le fait de blâmer un citoyen, sans lui donner la possibilité de se faire entendre dans le respect des règles de justice naturelle, peut causer une atteinte injustifiée à sa réputation ;
Que dans le cadre des travaux sur la réforme parlementaire en cours, l’Assemblée nationale s’engage à assurer qu’à l’avenir, des motions de blâme contre un citoyen ne soient plus possibles.
Sans consentement, la motion présentée n’a pu être débattue.
En mars 2021, Louis Bernard, ancien secrétaire général du Conseil exécutif, signe une lettre ouverte invitant l’Assemblée nationale à annuler la motion de décembre 2000. Dans le même but, en mai, il pilote une lettre collective signée par plusieurs anciens parlementaires, incluant Pauline Marois et (enfin !) deux libéraux ; l’ancien ministre libéral Benoît Pelletier y donne son appui dans une lettre ouverte en juin.
Des hommages
En mai 2022, la députée Ruba Ghazal remet une « médaille de l’Assemblée nationale » à Yves Michaud au cours d’une réunion privée réunissant des membres de la famille Michaud et quelques invités. Le geste est sympathique et certainement bienvenu, compte tenu de l’état de santé du « Robin des banques », mais, dans les médias, le titre de la nouvelle (« Yves Michaud décoré de la médaille de l’Assemblée nationale ») porte à croire que l’Assemblée nationale a posé un geste de réparation alors qu’il s’agit d’une initiative personnelle de la députée de Mercier.
À la suite du décès de Yves Michaud, en mars dernier, le chef du Parti québécois sollicite à son tour le consentement de ses collègues afin de présenter, conjointement avec le ministre de la Langue française, la députée de Bourassa-Sauvé, la députée de Mercier et la députée de Vaudreuil, la motion sans préavis suivante :
Que l’Assemblée nationale rende hommage à M. Yves Michaud, député de Gouin de 1966 à 1970, haut-commissaire à la Coopération au ministère des Affaires intergouvernementales de 1970 à 1973, délégué du Québec aux organisations internationales en 1977, puis conseiller du premier ministre aux Affaires internationales en 1978 et en 1979, délégué général du Québec à Paris [jusqu’en] 1984 et récipiendaire de la Médaille de l’Assemblée nationale, pour son engagement indéfectible envers la nation québécoise, la langue française et l’indépendance politique du Québec ;
Qu’elle souligne sa contribution au développement du journalisme québécois, notamment au Clairon maskoutain, où il en occupa les fonctions de rédacteur en chef de 1954 à 1960, de directeur de janvier 1960 à janvier 1961 et de directeur-gérant de janvier 1961 à mai 1966, au journal La Patrie dont il fut le rédacteur en chef et directeur général de 1962 à 1966 et au journal Le Jour dont il fut également le directeur de 1973 à 1976 ;
Qu’elle rappelle qu’il a été récipiendaire de plusieurs prix d’excellence en journalisme, notamment ceux du meilleur reportage en 1957, du meilleur journal hebdomadaire de langue française en 1958 et du meilleur éditorial de l’année en 1963 et en 1964 ;
Qu’elle salue son importante contribution à la défense des petits épargnants et actionnaires par la fondation et la présidence de l’Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec, maintenant connue sous le nom de Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires ;
Que les membres de cette Assemblée observent une minute de silence en sa mémoire.
Le chef du Parti québécois avait préalablement obtenu le consentement au dépôt d’une motion sans préavis, dans la mesure où elle se limiterait à un hommage au défunt.
Il était cependant possible d’évoquer « l’affaire » dans les interventions, ce que le chef du PQ a fait à la fin de sa courte intervention: « En terminant, il ne faudrait pas passer sous silence que cette Assemblée l’a faussement accusé d’avoir tenu des propos antisémites. Ce triste et injuste épisode de sa vie l’aura affecté grandement pendant plusieurs années, mais je suis certain que nous aurons l’occasion, dans les prochaines années, de lui rendre justice. »
Pour sa part, la députée de Mercier a réitéré la demande faite la veille aux autres partis : « Rencontrons-nous dans les prochains jours pour discuter d’avenues possibles pour réparer l’erreur qui a été commise à l’encontre de M. Michaud en l’an 2000. J’espère vraiment que ce sera possible de commencer par ouvrir un dialogue pour que nous puissions, nous, membres de l’Assemblée nationale, tourner la page de ce chapitre noir de notre histoire ».
Une autre voie
Il serait étonnant que le vœu de la députée de Mercier se réalise. Pour en finir avec l’affaire Michaud, il faudrait procéder autrement et passer outre aux demandes de consentements exigées pour présenter des motions sans préavis alors que le Règlement de l’Assemblée permet à tout député d’inscrire une motion à l’ordre du jour sans avoir à solliciter de permission à quiconque.
Si un parti (ou un député) souhaite corriger l’injustice faite à Yves Michaud (et il semble y en avoir deux), il devrait inscrire au Feuilleton une motion qui s’inspirerait du commentaire du juge Baudouin : les propos de Michaud importent peu, l’injustice tient au fait (incontestable) que Michaud a été « exécuté sur la place publique sans, d’une part, avoir eu la chance de se défendre et, d’autre part, sans même que les raisons de sa condamnation aient préalablement été clairement exposées ». L’injustice est essentiellement la conséquence d’une procédure fautive, et non d’une exégèse erronée.
C’est le leader du gouvernement qui décide de l’ordre du jour, mais il y a un moment de la semaine, le mercredi, de 15 à 17 heures, où l’opposition peut imposer son choix.
Le président « détermine l’ordre dans lequel les affaires sont débattues en tenant compte de l’ordre de leur inscription au feuilleton ou de la réception des préavis, de l’alternance entre les groupes parlementaires et de la présence de députés indépendants (art. 97) ».
Après consultation auprès des leaders des groupes parlementaires, le président répartit le temps de parole entre les groupes. La motion ne peut être amendée, sauf avec la permission de son auteur (art. 98), ce qui empêche d’en dénaturer le contenu et, dans le cas qui nous occupe, de faire porter le débat sur les idées exprimées par Yves Michaud aux États généraux (ou ailleurs, comme l’a laissé entendre le premier ministre récemment).
Il suffit donc qu’un parti veuille bien consacrer un de « ses » mercredis à l’affaire Michaud. Les membres de l’Assemblée nationale devraient alors se prononcer, ou aller « prendre une marche » au moment du vote.
Si ce dernier est positif, une tache honteuse sera lavée dans les procès-verbaux de l’Assemblée nationale.
1 Matthias Rioux, « L’affaire Michaud ou Le complot des mous », L’Action nationale, Mars 2011, p. 58-64.
* Historien de l’Assemblée nationale pendant trente ans, Auteur de L’affaire Michaud : chronique d’une exécution parlementaire (Québec, Septentrion, 2010).