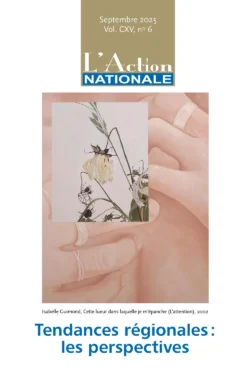« La société n’est rien, mais on n’a pas autre chose » disait Pierre Maranda1 dans ses cours d’anthropologie à l’Université Laval. Énoncé absurde ? Énigmatique ? Aveu d’impuissance ? Proposition de recherche ? On peut aborder cet énoncé sous plusieurs angles. Reste qu’il indique la place que devrait tenir la société dans les préoccupations humaines : elle est incontournable.
Tout le monde se fait une idée de la société. Je vais donc commencer par là. La société est une affaire personnelle avant d’être une expérience problématisée et un objet de recherche. Mon expérience de la société est coupée en deux. Voici 30 ans, en 1992, j’ai commencé à étudier la société, objet d’anthropologie. J’ai d’abord cherché à l’envers, en commençant par l’exclusion, puis en poursuivant avec la colonisation.
Mes recherches et mon enseignement m’ont porté vers les principes de regroupement social et les moyens de faire société. Je me suis penché sur les rapports sociaux, leur aménagement et leur transformation, en me tournant vers les fondements de la société2. Aujourd’hui, après la fin d’un terrain de quatre années dans le quartier où j’habite, je m’interroge sur la société humaine, porteuse d’enjeux contemporains.
Disons-le tout de suite, je n’ai pas l’intention d’offrir des réponses ou des solutions, tout au plus des questions de recherche. Mon questionnement porte sur le mot « société ». Que recouvre ce mot ? Que dit-il ? De quoi parle-t-il ? Offre-t-il des ressources pour s’en sortir ? Dans un contexte où l’isolement augmente et les identités polarisent, quelles pistes de recherche l’anthropologue peut-il esquisser ?
La société, une affaire personnelle
Toute ma vie, je me suis fait une idée de la société.
Je suis né à Montréal. Dans Ahuntsic où j’ai habité la moitié de ma vie. Mes parents y sont nés et y ont vécu toute leur vie. Ils évoquaient souvent la Crise des années 1930 qu’ils avaient vécues différemment même s’ils habitaient des rues voisines l’une de l’autre. Mes grands-parents étaient nés sur des fermes, derrière Vaudreuil à peu de distance de Montréal du côté paternel et, pas loin de Trévise en Italie du Nord-Est, du côté maternel.
Leur installation à Montréal après la Première Guerre mondiale change leur vie, celle des enfants qui vont y naître et le cours des héritages à transmettre. En passant d’un monde agricole à un monde urbain et industriel, d’un monde où on cherche à thésauriser à un monde où on investit, ils sont entrés dans la mutation contemporaine au début du XXe siècle, en composant avec le libéralisme, chacun à leur manière.
Né Canadien français catholique, vers la fin d’une société repliée sur elle-même et pratiquant religieusement le sacrifice, je me suis débattu avec le mot société. Il amalgamait la plupart des règles qu’il fallait suivre, des normes auxquelles se soumettre. Nos parents étaient les premiers instruments de la contrainte, suivis d’assez près par la directrice de l’école primaire et le curé de la paroisse. Au nom de l’autorité qu’ils exerçaient, pas grand-chose ne leur échappait de la vie des jeunes qu’il fallait éduquer dans un monde de turbulences, celui des années 1960.
La seule mention du mot société déchaînait entre mes sœurs et moi, à la maison, ou avec mes amis au collège, des discussions passionnées sur la liberté comme antidote au poison normatif. Je vous laisse imaginer le contenu du mot liberté pour de jeunes Québécois rejetant la tradition canadienne-française catholique encore vive à l’époque. Jusques là, nous habitions la maison des parents. Quitter la maison familiale et quitter l’école, allait-il nous libérer de la société ? Telle était notre vision des choses. La mienne en tous cas.
Certains parents encourageaient leurs enfants dans cette voie (la liberté), d’autres se braquaient dans la discipline. Dans ce cas, il fallait claquer la porte pour partir. Mes sœurs et moi avons quitté la maison des parents et nous sommes recomposés à l’intersection des identités en ébullition (générationnelle, sexuelle, culturelle, sociale, économique). Au cours des deux décennies qui suivent (1970-1980), le mot société s’efface, son poids décline. Il est plus ou moins oblitéré par le mot identité.
Au Québec, le régime a été transformé, la société, touchée : réagencement des relations entre hommes et femmes, libéralisation, laïcisation, restauration de la langue, démocratisation de l’éducation, émergence d’un sujet québécois. Tout ça bouillonnait en même temps et nous projetait de tous bords tous côtés en cassant les moules qui avaient servi pour fabriquer le monde de mes grands-parents et celui de mes parents.
J’ai joint une grande corporation où j’ai escaladé quelques échelons dans la hiérarchie gestionnaire, mes sœurs plus résistantes ont préféré les coopératives (alimentation et habitation). La visée néolibérale d’un individu sans passé et sans lien social, est devenue un prisme par lequel le monde était vu et même construit : un je-gestionnaire prenait place, un travailleur autonome s’installait, plus ou moins sans société en dehors du travail.
Dans ce contexte, je n’étais pas seul à vivre les fragmentations, les désaffiliations, les démariages, les polarisations qui se multipliaient. Il a fallu que je voyage dans le monde pour me rendre compte que toutes les sociétés ne sont pas de même facture, que tous les destins individuels ne sont pas fabriqués dans le même moule et que les enfermements ne prennent pas tous la même forme. Souvent, le choc culturel n’est pas vécu à l’aller, mais au retour en prenant la mesure des écarts entre plusieurs mondes.
Confronté par mon vécu et mes voyages, je commençais à voir autre chose et autrement au tournant de 1990. La société n’était plus un système de contraintes pour l’individu qui cherche son chemin dans le monde. La société était ce que l’individu défait, délie, dissout en réalisant les missions corporatives pour lesquelles il est salarié. Certains se moulent dans le nouveau régime. D’autres, dans la mesure des moyens dont ils disposent, se repositionnent.
Chercher la société, à l’envers
Entre société contraignante dont des jeunes cherchaient à s’éjecter et identité mythique dont plusieurs faisaient la quête, nous étions passé d’une société du sacrifice et du repli sur soi (1840-1970) à une société de la performance et du dépli de soi (à partir de 1970-1980). Autrement dit le régime avait basculé, pas seulement moi. Au-delà de la société répressive et de l’identité recherchée qui ont marqué les quarante premières années de ma vie, il y avait place à des questions et des problématiques.
En optant pour l’anthropologie sociale au début des années 1990, j’ai viré à 180°. Mais au-delà du voyage, que fait l’anthropologue ? Première caractéristique : il arrive par le dehors, dans des sociétés autres puis dans la sienne. Deuxièmement : il n’est pas dans l’instantané. Ses terrains vont durer un an ou deux, voire quatre ou cinq et même huit ou neuf ans. Troisième élément : le point de départ est le sujet local dont il va explorer le monde, les parts connues et inconnues. Et dernier élément : son approche de la composition des mondes est qualitative et comparative.
Au fil d’un peu plus de deux décennies (1992-2016), j’ai cherché la société à l’envers, depuis les vies bouleversées, chamboulées. Durant cette période j’ai étudié, enseigné et cherché. Il faut du temps pour constituer son anthropologie. Ça ne relève pas de la quête ou du voyage, mais d’une application de la pensée à la science du devenir humain et des formes de vie humaine, sociale. Dans le cours de sa pratique, dans l’exercice de son métier, l’anthropologue est pris entre… le sujet humain et l’objet de recherche.
En recueillant les témoignages de gens plus ou moins sans société, je me suis penché sur l’exclusion. J’ai rencontré des travailleurs vieillissants, des fonctionnaires mis en disponibilité, des jeunes de la rue, souvent des gens isolés, plus ou moins aptes à former une collectivité. J’ai croisé des organisations divisées par l’âge et par l’évaluation individuelle. Au regard de ce sujet humain, j’ai travaillé sur le processus d’exclusion, ses logiques et ses effets. J’ai noté qu’il y avait de l’auto-exclusion induite, et surtout que la part symbolique de ce processus agissant dans la société, clivait celle-ci.
En me tournant vers les archives et la littérature, je me suis penché sur des formes sociales à petite échelle, un village en Gaspésie, Grande-Vallée, et une filiation dans le Haut-Saint-Laurent québécois. Le sujet n’était plus abordé en tant qu’individu, mais en tant que collectivité, aux prises avec une situation socio-historique particulière. A priori j’aurais pu poursuivre avec l’exclusion comme objet de recherche, mais des lectures en « études coloniales et postcoloniales », m’ont mené vers la colonisation (en tant que processus et régime) où des sociétés sont en rapport asymétrique avec d’autres sociétés.
La colonisation est un objet de recherche exigeant avec lequel on ne finit pas de se colleter. J’associe la colonisation à une double exclusion, à la fois cognitive et politique. Le sujet colonisé ne détient pas les moyens cognitifs et politiques pour changer la donne. Nombre d’institutions avec lesquelles il doit composer sont hétérogènes, elles ne sont pas de son fait. C’est aussi le cas des repères symboliques. On observe des gens n’ayant pas accès aux forêts avoisinant leur village ou encore des familles exclues sur une terre.
Ne souhaitant pas présenter des portraits de société à mes étudiants du collégial, je me suis tourné vers la mutation anthropologique qui traverse les sociétés de part en part : le passage à l’agriculture et à l’élevage, puis le passage à l’industrie et au capital3. Dans l’optique d’un anthropologue, une société s’étudie à petite échelle, celle de la localité, du village ou du quartier. Or, peu importe l’échelle, toutes les sociétés sont complexes et se transforment. Toute société demande une attention patiente, longue, pour saisir les systèmes de relations qui y sont manifestes et les processus sociaux qui les traversent.
En comparant les sociétés, des correspondances ressortent, lesquelles renvoient à des structures communes, dont homo sapiens serait porteur4. Plus on se penche sur les commencements générés par homo sapiens, plus on met le doigt sur des constantes qui débordent les particularités. Poser le problème anthropologique du devenir humain, soulève le problème des formes de vie sociale et, donc, de la société. La plupart des gens retiennent la diversité, la différence entre sociétés. Or on peut observer des constantes d’une société à l’autre. Toutes les sociétés ont des maisons, des parentés, des rituels, des associations, des assemblées, une langue, des politiques partagées, des récits communs.
Au sein des sociétés, s’associent des personnes de parentés différentes et s’assemblent des personnes issues d’associations et de parentés distinctes. Les personnes vivent et se gouvernent dans une langue. La langue n’est pas un simple outil de communication. Elle est l’assise de l’être au monde d’une société et du soi. La projection et l’organisation d’un ensemble humain passent par une langue. Les réflexions de chacun aussi. Ce serait dans les associations multiples du sujet de langage d’une société5 que la collision entre émotions et intérêts est minimisée : le passage au symbolique du sujet, ses relations, leur multiplicité dans de nombreux groupes sociaux, réduirait le risque de collisions6.
Pour enseigner le cours Enjeux contemporains au collégial, je me suis déplacé, sans perdre de vue le mot société qui demeurait mon objet de science, donc de débats, de nouvelles questions et de re-problématisations. Sans que ce soit définitif, j’associais de plus en plus souvent le mot « société » au concept « rapport social ». Au fil des années d’étude, d’enseignement et de recherche, la relation comme point focal avait déplacé la personne, l’individu, lequel n’était plus au point de départ de la recherche. En posant les relations au centre, la perspective a changé. Il y aurait du « nous » à plusieurs niveaux, ceux de la société et ceux de l’humanité7.
Dans cette perspective, une hypothèse émerge : la société, un aménagement de rapports sociaux en mutation. Les comparaisons entre sociétés font ressortir que les positions dans les rapports sociaux (tant en société qu’entre sociétés) ne sont pas toutes équivalentes, certaines attestant d’une asymétrie, alors que d’autres tendent vers la symétrie, certaines permettant des marges de manœuvre, d’autres non. Les rapports sociaux se constituent sur la base de relations qui sont un lieu de tensions, d’émotions. Cette analyse en termes de rapports sociaux n’est pas originale. On la trouve chez l’anthropologue Alain Testart8.
Chercher la société, au plus près
L’année 2015 a marqué un point tournant. Des préoccupations m’ont mené vers la production de trois dossiers analytiques, prenant comme point de départ soit un conte bas-laurentien, un mythe pawnee, une littérature de guerre en Europe. Au fil de ces dossiers, mon autoposition d’anthropologue était recadrée vers le passé récent et le proche avenir, le gouvernement de soi et des autres, l’émergence d’un sujet collectif et l’adjacentéité du chercheur9. Sur quelles bases ce déplacement a-t-il pu se faire ?
En 2016, avec l’anthropologue David Aubé, nous cocréons le Studarium, cabinet de travail commun fait pour échanger par écrit à propos de nos objets de recherche respectifs. La discipline de l’écriture est rarement interrompue, à peine quelques fois par année, pour une rencontre de vive voix ou une vacance méritée. Nous visons l’application de la pensée à l’anthropologie. Nos échanges contribuent à des réflexions et productions distinctes, propres à chacun de nous. Nous ne sommes ni subventionnés, ni dirigés par d’autres.
Dès nos premiers échanges, David insiste sur un point : pas d’anthropologie sans terrain. En mars 2017, j’entre sur un nouveau terrain en devenant membre de Solidarité-Ahuntsic, Table de concertation du quartier où j’habite. Et en août 2017, je m’associe à la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville. Je suis toujours membre de la Société d’histoire à laquelle je contribue, avec l’aide de Jacques Lebleu, coordonnateur du bulletin semestriel. Mes articles dans le bulletin sont en lien avec le terrain. Les articles de Jacques et d’autres collaborateurs témoignent de la transformation locale et contribuent à l’avancée des connaissances10.
En juin 2021, après quatre années, je me retire. Simple césure suivie d’un réalignement ou rupture plus nette en vue d’une production écrite ? Rien n’est définitif. Mais la matière recueillie pendant ces 4 années fait l’objet d’un retour en vue de produire de nouvelles connaissances. Ce matériel porte le titre Relations ahuntsicoises : procès-verbaux, documents, rapports et articles, récits de vie, entretiens formels, et informels, notes auto/ethnographiques, et ethnographiques, archives, romans, statistiques, photos. Ce à quoi j’inclus ma production écrite au cours de ces années.
En cherchant, je n’ai pas prédisposé l’exclusion sociale, la (dé)colonisation ou la mutation anthropologique. J’ai privilégié une route ouverte, laissant aux relations locales, le soin de faire émerger des notions nouvelles, aptes à constituer des objets de recherche qui sont à découvrir, sans présupposer la méthode de construction de l’objet. Les notions de maison, forme de vie, espace public et localité ont pris une place significative dans l’objet de recherche11. Ce n’était ni envisagé ni préfiguré au moment de franchir le seuil du terrain.
Du côté du sujet humain, j’ai rencontré des citoyens, des bénévoles, des intervenantes, des dirigeantes, des agentes, des élues (des femmes en majeure partie). Ahuntsic est un quartier de Montréal (centre-nord) dont la population est de 80 175 habitants (selon le recensement 2016, données colligées par Centraide à la rue près). Parmi les habitants, 22 % sont seuls, 32 % ont immigré pendant leur vie, 20 % ont de faibles revenus. Près de la moitié des ménages locataires paie plus de 30 % de leur revenu en loyer. La Table de concertation Solidarité Ahuntsic est un centre névralgique du champ communautaire qui comprend une soixantaine d’organismes, des élus municipaux et provinciaux, des agents de l’État et quelques citoyens du quartier12.
Tracés à gros traits, tels sont les éléments du sujet humain et de l’objet de recherche entre lesquels je m’active. Le mot société ne disparaît pas sous les allers-retours entre sujet et objet, il demeure l’attracteur. Il donne un sens à la poursuite du travail et motive mon retour occasionnel sur le terrain pour une rencontre. Sans aller jusqu’à représenter graphiquement l’objet, sans prétendre avoir fait le tour du sujet, je cherche de nouvelles interprétations, mais ce sont des questions auxquelles je fais face. Je demeure pris dans une démarche exploratoire, entre ce sujet que je me refuse à réifier et cet objet en cours de construction.
Hypothèses sur deux sites de recherche
Il faudra quelque temps pour décortiquer tout mon matériel. La question actuelle, sur ma table de travail, n’est pas de savoir s’il y a ou s’il n’y a pas société, mais de saisir ce que mon matériel de terrain aurait à dire à propos du mot société. Cette question est centrée sur les rapports sociaux. Notons que si les gens ont à dire à propos de la société, ce qu’elle est, et même sur la classe sociale et leur position dans la société, peu ont à dire sur le rapport social en tant que tel, puisqu’il s’agit d’un terme analytique. Voyons deux des quatre sites de ce terrain multi-situé13.
Premier site de recherche : la marchandisation du domicile et du soi.
Deux romans où il est question de la localité ahuntsicoise permettent d’esquisser le sens de la transformation du régime, allant d’une société à maisons, installée au Sault-au-Récollet sur l’île de Montréal vers 1820, vers une localité urbaine circonscrite dans la Ville de Montréal en 2012. La terre paternelle de Patrice Lacombe paru en 1846 et Paul à la maison de Michel Rabagliati paru en 2019 sont des romans de facture très différente. Or, tous deux posent la maison (à la fois habitation et institution) au centre de la trame narrative, en permettant de dégager une perspective sur les rapports sociaux.
Mon propos n’est pas de résumer ces romans, mais de souligner que, dans les deux cas, la famille est touchée. Or si, en 1820, un atome de parenté perdure et se recompose, ce n’est pas le cas en 2012. Le contemporain serait marqué par l’isolement de personnes, une forme de vie solitaire plutôt que solidaire. L’isolement du sujet serait accentué par une culture de l’écart et du refus relationnel, couplée à une recherche de résonnance avec la nature. La seule mesure statistique des isolés dit le nombre de personnes vivant seules, mais ne dit rien du vécu subjectif dans la solitude.
Autre point de comparaison. Vers 1820, la propriété de la maison familiale est perdue, engouffrée dans la marchandisation naissante du domicile des gens, dans le passage du régime seigneurial au régime entrepreneurial. En 2012, le propriétaire de la maison demeure, alors que le soi est soumis à la marchandisation avec le produit de son travail. Un monde de travailleurs autonomes a émergé. Si les pathologies sont différentes, elles n’en traduisent pas moins des bouleversements : dans le premier cas, le noyau familial se transforme avec de nouvelles relations, dans le second, l’isolé se reproduit sans société.
Dernier point : le rapport social de propriété immobilière interpelle14. Bien transmis entre générations sous un régime ? Domicile ancestral volatilisé sous un nouveau régime ? Assise d’un isolement social refermé sur lui-même ? Lieu de télétravail et de contention du soi ? Les modalités de ce rapport social ne sont pas toutes exposées dans les deux romans, même si sont explicites des effets qui lui sont attachés. Un processus de marchandisation opère, des effets de marché jouent, sur le domicile des gens, sur le soi qui travaille.
Une société de marchés est-elle hégémonique15 ? Le capitalisme est une forme de société de marché orientée par la propriété privée de capitaux et le rendement de ces capitaux. Plus ceux-ci sont élevés, plus les écarts seraient marqués au sein de la société qui les tolère. Tout marché est objet de régulations sociales. Un des problèmes est de cerner le sens des régulations pour saisir de quel côté elles penchent, de qui elles prennent soin, qui elles protègent. Le marché peut s’avérer une expérience d’injustice et d’inégalité.
Si l’hypothèse d’une société de marchés à plus ou moins haut rendement se vérifie, le rapport social (par exemple, propriétaire/locataire et d’autres aussi) serait vécu comme une transaction économique, sous le regard d’une rentabilité économique, sans options pour en sortir. Face à la marchandisation imprégnée de plus en plus dans les liens sociaux, l’intérêt individuel calculateur du sujet local domine, faisant disparaître d’autres aspects du lien social. Ce serait ainsi que la raison gestionnaire empiète sur les relations sociales et occupe une position dominante dans la société.
Passons au deuxième site : la (dé)marchandisation du monde vécu.
En 2017, j’ai rallié le communautaire de mon quartier. Même si j’avais croisé des entreprises d’insertion et le chantier d’économie sociale à l’occasion d’une recherche subventionnée sur les travailleurs vieillissants entre 2003 et 2005, le communautaire continuait de m’apparaitre comme une assise du mouvement. Or, ma participation à un comité de pilotage (2017-2018) et au conseil d’administration de la Table (2019-2021) de même que la lecture d’articles de Marie-Andrée Couillard et de Francine Saillant, attestent d’une institutionnalisation de l’ensemble organisationnel communautaire16.
Mon hésitation entre mouvement et institution ouvre le paradoxe du communautaire17. Voyons les éléments de ce paradoxe dans le cadre du cas étudié. À grands traits, ces éléments seraient, d’une part une raison gestionnaire qui s’incruste dans les rouages communautaires avec des effets sur la société (sur les liens sociaux), et d’autre part, des initiatives qui débordent cette raison, s’en détournent pour susciter des collectifs (atomes de société ?)18 allant à l’encontre d’une marchandisation des liens sociaux. Une disposition humanitaire interviendrait pour démarchandiser des objets, des liens sociaux.
Le communautaire a été échafaudé sous l’impulsion du mouvement social. L’émergence du champ communautaire a été le fait de gens du quartier appuyés par un député provincial et par des intervenants du CLSC, lui aussi émergeant dans les années 197019. Ce champ a été constitué dans un vide laissé ouvert par l’effondrement paroissial et un resserrement sur la parenté restreinte au détriment de la parenté étendue. Peu ou pas rémunérés, les gens du communautaire (des femmes en grande majorité) participaient à cette innovation où l’entraide et la démocratie étaient au fondement.
Le champ (Organismes et Table de concertation) a été installé dans un espace intermédiaire, à l’écart de l’État pour palier aux maisonnées en manque de ressources matérielles et symboliques pour se maintenir dans les structures inégalitaires de marchés interconnectés. À la différence du CLSC que l’État a intégré, le communautaire est un montage organisationnel plus fragile. Des conventions et du financement lient ce champ et l’appareil étatique, au provincial comme au municipal. Un organisme philanthropique, Centraide, avance aussi du financement, ce qui le lie aussi au communautaire.
La gestion des organismes sociaux requiert du travail non-salarié qui jouxte avec le travail salarié dans le mode de production de services sociaux. Depuis 20 ans, les emplois communautaires salariés se sont stabilisés et sont devenus une voie de transit vers l’emploi mieux rémunéré des fonctions publiques. Ils sont souvent comblés par des gens qui n’habitent pas le quartier. L’emploi dépend d’un financement aléatoire et le taux de roulement est élevé. Cette organisation du travail permet de réduire le coût de la reproduction sociale.
Il y a plus. Dans le champ communautaire, on tendrait à gérer le problème social. Le mode de subvention, accordant du financement à la vulnérabilité des gens, assurerait une gestion de la pauvreté, donc le maintien des inégalités. Il ne s’agit pas de stigmatiser le communautaire dans un mauvais rôle ou comme mauvais joueur, mais d’indiquer qu’il opère des interventions susceptibles de reproduire et non transformer le régime en place. Les organismes et la Table de concertation sont régis par la loi sur les compagnies et rendent des comptes.
Le développement d’organismes par services ciblés à des populations spécifiques pourrait aussi induire de la privatisation, de la marchandisation en tarifant les services offerts. Des entretiens ethnographiques suggèrent cette possibilité. On progresserait dans ce sens, non pour y inscrire tous les organismes communautaires et les services offerts, mais pour aligner certains services, notamment en haussant le coût de l’accès par la population ciblée. Cela dit, il n’en demeure pas moins qu’un quartier comme Ahuntsic est bien pourvu de tels services pour soutenir les familles.
Le champ communautaire est aussi pris dans des situations de propriété immobilière, parfois épineuses. À la fois locataire et locateur, la Table de concertation est enchevêtrée dans des relations de propriété, des disputes de loyer, des menaces d’éviction, des problèmes d’entretien, des abolitions de postes et des moyens de contestation qui la positionnent dans la transaction économique. Pour assurer l’appareil organisationnel, on fait appel à la raison gestionnaire et l’analyse coût/bénéfice.
Pourtant, et tel est l’autre côté du paradoxe : dans ce communautaire-là, associé avec des bibliothèques ou des écoles, dans des assemblées et sur des comités, on observe une culture à même laquelle des personnes, en collectifs, ouvrent des espaces publics, pratiquent de nouvelles médiations, mènent de nouvelles luttes. On activerait des intelligences citoyennes et une énonciation démocratique portant sur le rapport social. Une disposition humanitaire prendrait le pas sur le reste. Par exemple en ce qui a trait aux sans-logis et aux mal-logés, des démarches de démarchandisation d’immeubles sont menées à terme.
Comment ceci est possible ? Des personnes sortent de leur maison (logement, parenté), en rencontrent d’autres et entrent en relation dans des espaces publics. Elles parlent ensemble du devenir humain et de formes de vie en vue de transformer les rapports sociaux. Donc, faire société ne serait pas laissé au hasard : des cercles de paroles, des jumelages, des cercles de lecture de même que certains comités et ateliers seraient des moments privilégiés de vie associative et citoyenne. La création d’espaces publics traduirait un faire société.
Le problème soulevé loge entre ces espaces publics, le Capital et l’État. Deux paradigmes touchant la reproduction sociale peuvent être évoqués : 1) La réduction des liens sociaux à des valeurs marchandes et au processus de marchandisation favorise le capitalisme qui s’étend (l’analyse coût/bénéfice et la raison gestionnaire vont en ce sens). 2) Par contre, l’assujettissement du capital à des concepts et des moyens locaux, sociaux, favoriserait un ordre culturel relevant d’une disposition humanitaire (une analyse allant en ce sens serait conduite en termes de rapports sociaux, dans une perspective historico-critique).
Le paradoxe communautaire serait installé sur la faille entre ces deux paradigmes, au croisement de deux cheminements analytiques, à même la relation entre Société, État, Capital. Je préfère ne pas m’avancer trop dans ce sens. Le paradoxe communautaire est observable, mais les moyens de le dépasser ne sont pas tirés au clair. Le tout semble fonctionner comme un régime colonial où le monde vécu des gens est colonisé par la marchandisation. Dans quelle mesure la société peut se décoloniser ou être décolonisée, autrement dit sortir de ce processus qui empiète sur la reproduction sociale ?
Projection : re-problématisation de la reproduction sociale et recherche d’équipement
Tout au long des quatre années du terrain, la reproduction sociale des rapports sociaux a été au centre de mes préoccupations, même si elle n’était pas présupposée en tant que telle au départ. S’il y a lieu de reprendre à neuf le problème de la reproduction sociale, alors ce qui a trait à la maison et au soi, au communautaire et à la localité, à l’héritage et à la transmission, sera à revoir sous l’angle de la mutation anthropologique en cours20.
Comment poursuivre mon trajet laborieux, mon itinéraire de terrain, mon cheminement analytique ? La recherche pourrait répartir des conditions d’habitabilité humaine et de bonne vie, sans penser que les jeux sont faits et en sachant que le contemporain est ce qu’il faut assembler ensemble. Tout ne serait pas joué. Reproblématiser la reproduction sociale voudrait dire élaborer une problématique de l’habitabilité locale contemporaine.
A priori, l’habitabilité locale recouvre ce qui a trait aux ancrages territoriaux, institutions sociopolitiques et repères symboliques qui font sens depuis le sujet. Curieuse pratique d’évoquer en fin de texte, l’habitabilité sans l’avoir balisée. Mon travail des dernières années a porté sur la maison, le communautaire et la localité. Il coulait de source de repositionner ces termes dans une construction qui les connecte avec la culture.
Élaborer une problématique, suppose de problématiser localement (dans mon cas, Ahuntsic), dans le cadre d’un État-nation qui, même incomplet considérant sa position dans le Canada et le monde, fait du sens : le Québec. La recherche à même la matière sociale d’une localité urbaine serait conduite dans l’optique d’une reconceptualisation de la culture en incluant l’objet « habitabilité21 ».
Si nous n’avons pas grand-chose de plus que la société (comme le suggérait Maranda), les formes de vie en société, que nous construisons localement, ou plus exactement que nous devenons ensemble localement, sont un point focal sur le terrain. En optant pour étudier la culture d’habitabilité qui se déploie dans une localité urbaine, il est envisagé de se pencher sur un rituel (le Cercle de paroles) et un chantier citoyen émergeant.
1 Anthropologue (1930-2015). Dans le prolongement du structuralisme de Claude Lévi-Strauss, il a travaillé sur la formule canonique et le cube sémiographique, des moyens analytiques applicables aux mythes.
2 Cet article reprend la problématique de Robert Lowie sur les principes de regroupement en société (Primitive Society paru en 1920 et Social Organization paru en 1948) et de Maurice Godelier sur les fondements sociaux (Au fondement des sociétés humaines, paru en 2007). Je n’entends pas élargir leurs questions, mais relancer leur proposition, sans perdre de vue le travail de Jacques Donzelot relatif aux mêmes préoccupations (Faire société, avec Catherine Mével et Anne Wyvekens, paru en 2003).
3 Il y a plusieurs fils conducteurs pour appréhender les grandes mutations anthropologiques. Au cours du néolithique, homo sapiens invente deux écritures (celle des mots, celle des nombres) et déploie une vaste intelligence syntaxique, arithmétique. La mutation contemporaine, quant à elle, est caractérisée par l’invention de l’écriture du code (informatique) et le déploiement d’une intelligence dite artificielle.
4 À partir d’écrits produits en anthropologie, j’ai lu sur les Urus de Chipaya en Haute-Bolivie, ce qui m’a mené au régime inca et à la colonisation espagnole. Sur les sociétés iroquoises au Québec en Amérique du Nord-Est et les sociétés touarègues au Niger dans le Sahara sont venues par la suite. Au Québec, sur les Algonquins et les Innus, ceux-ci tout récemment. Les Rapanui et l’aire des sociétés polynésiennes couvrant l’océan Pacifique, de même que les Pawnees et les sociétés des Plaines au Centre de l’Amérique du Nord font aussi partie de ma base comparative.
5 Nous parlons une langue dont nous sommes sujet locuteur en y circonscrivant un langage propre à notre condition sociale, notre éducation, nos actions, lectures et réflexions. Le sujet est individuel et collectif.
6 On trouve cette idée relative aux associations multiples du sujet chez Robert Lowie (dans Primitive Society) et chez Hannah Arendt (dans Condition de l’homme moderne).
7 Les sociétés n’ont comme vecteur ni l’unité, ni l’identité, mais un aménagement de rapports sociaux qui tend à minimiser la casse. Aménager un rapport social ne veut pas dire changer de position dans un rapport qui se maintient. Ça veut dire déhiérarchiser et recadrer le rapport.
8 Alain Testart, 2021, Principes de sociologie générale 1. Rapports sociaux fondamentaux et formes de dépendance, Paris, CNRS Éditions. Testart avance que l’anthropologie, dans sa pratique comparative, peut proposer une sociologie générale des rapports sociaux. Le rapport social renvoie à une forme plus instituée, hiérarchisée, régulée des relations. Comme lui, j’appelle position la place que chacun tient dans un rapport social. La transformation de régime et le système de propriété font aussi partie de son objet de recherche.
9 Adjacentéité de l’anthropologue : à la fois situé, voisin, proche, contre (en face et au contraire). Ce serait un accompagnement qui peut prendre soin du sujet et s’y opposer. Paul Rabinow (1944-2021) a développé cette position de terrain, dépassant ainsi l’observation participante classique en anthropologie sociale.
10 Les bulletins (Au fil d’Ahuntsic, Bordeaux et Cartierville) sont disponibles sur le site de la Société d’Histoire d’Ahuntsic-Cartierville (SHAC) et à la bibliothèque d’Ahuntsic.
11 Ces notions sont envisagées depuis une anthropologie critique de la modernité. La maison est à la fois résidence, habitation et institution. La forme de vie éclaire un ensemble de pratiques indicatives du devenir du sujet humain. L’espace public renvoie à la rencontre autonome entre humains désignant le politique à l’œuvre, cet espace entre les humains dont il est question chez Hannah Arendt. La production symbolique de la localité est observée dans ses fragments épars, dans les liens qui y sont créés.
12 À Montréal, les tables de concertation sont des instances regroupant des organismes communautaires de divers secteurs et réseaux d’intervention (services familiaux, santé mentale, intégration sociale, etc.), organismes qui œuvrent à rendre meilleures les conditions de vie des gens. Les tables peuvent prendre des formes différentes selon des orientations locales. Solidarité Ahuntsic regroupe près de 70 organismes en plus des instances gouvernementales qui interviennent localement et de citoyens participants. Au Québec, une « Table » renvoie à des associations et des rencontres entre perspectives différentes, le plus souvent consensuelles, mais plurielles, touchant à la reproduction sociale dans une localité.
13 L’anthropologie du contemporain favorise cette approche à la fois exploratoire et comparative qui consiste à travailler sur plus d’un site de recherche pour étayer l’étude de cas.
14 Pour élargir le propos sur le logement : Louis Gaudreau, 2020, Le promoteur, la banque et le rentier, Lux.
15 Les propos d’Axel Honneth sont susceptibles d’éclairer cette perspective. Par exemple, l’entretien intitulé Capitalisme, critique et liberté sociale, paru dans la Revue du MAUSS 2018/1 no. 51.
16 Anthropologues qui ont étudié le communautaire au Québec, l’une sous l’angle des organismes de femmes, l’autre sous celui des réfugiés.
17 Le paradoxe, comme le rapport social, est un terme pour conduire l’analyse.
18 En d’autres termes, une structure élémentaire de société, non identique à la parenté. L’atome de société est un système de relations qu’on peut concevoir et observer. Il s’organiserait à même la société.
19 Centre local de services communautaires. Pour une étude historico-critique de cette institution issue du mouvement social : Anne Plourde, 2021, Le capitalisme, c’est mauvais pour la santé, Écosociété.
20 Avec Bruno Latour, il faut se demander si on ne devrait pas plutôt parler de mutation cosmologique. À ce propos les entretiens qu’il a donnés entre janvier et mars 2022, notamment à La grande Librairie sur TV5 sont éclairants.
21 Un terrain asphalté est inhabitable alors qu’un terrain jardiné soutient l’habitabilité humaine. Un logement insalubre est inhabitable alors qu’une cuisine collective favorise l’habitabilité. L’éviction est un processus d’exclusion d’une habitation alors que la coopération peut construire une habitation.
* Anthropologue.
** Une version préliminaire (abrégée) de cet article a fait l’objet d’une communication à l’occasion du Cercle de paroles organisé par Concertation-Femme et la Bibliothèque d’Ahuntsic le 23 février 2022. Au préalable, la communication avait été commentée par Lucie Bernier, Maysoun Faouri et Sylvie Payette qui organisent les Cercles. Je les remercie de la pertinence de leurs suggestions en soulignant que mes propos n’engagent que moi. Les personnes participant à ce Cercle ont contribué à l’avancement de l’article. Je les en remercie.