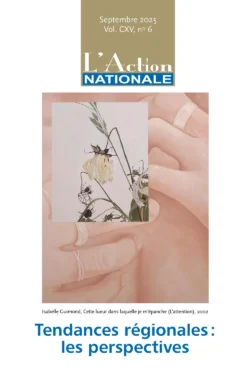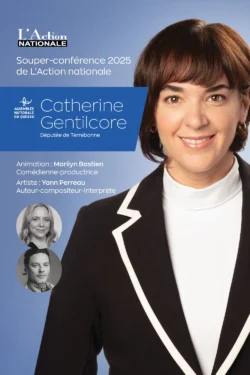Professeur des Universités, Université de Lorraine (Nancy).
J’aurais aimé être là, il y a cinquante ans, quand de Gaulle a crié « Vive le Québec libre ! » C’était quelque chose d’inattendu et de puissant comme une vague monumentale qui annonçait un vrai déferlement. D’ailleurs, l’homme d’État était arrivé par l’océan pour débarquer à Québec, le dimanche 23 juillet. Il avait traversé l’Atlantique puis remonté le fleuve en croiseur, le Colbert. Il venait de loin, il avait pris son temps : une vague de fond. […] J’aurais aimé être là, ce lundi soir, à Montréal, il y a cinquante ans, et je réalise que j’y ai toujours été. […] Un demi-siècle plus tard, mon père me dit que la vague, aussi puissante fût-elle, a fini par atteindre le rivage ; comme toutes les vagues, elle s’est brisée en écume.
Éric Plamondon
Le Monde,
Dimanche 23 – lundi 24 juillet 2017, p. 29
Étudier l’histoire des relations entre la France et le Québec aux XXe et XXIe siècles conduit inévitablement à analyser la manière avec laquelle les chefs d’État français se sont intéressés à la Belle Province.
Lors de son déplacement au Canada, dans le cadre d’une réunion de l’Internationale socialiste à Vancouver du 3 au 5 novembre 1978, François Mitterrand, lors d’une escale au Québec, avait été reçu par Jacques-Yvan Morin. Au cours du repas offert dans un salon du Château Frontenac, le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation nationale du Québec avait été frappé par le manque d’intérêt du premier secrétaire du parti socialiste français pour l’histoire du Québec et sa culture.
Quant au président Macron, il a attiré l’attention des journalistes présents à la réunion du sommet du G7, les 7 et 8 juin 2018, au Manoir Richelieu situé sur la côte nord du Saint-Laurent à Charlevoix, au Québec, en s’exprimant en anglais lors de la conférence de presse finale, au grand désarroi des journalistes québécois présents. Il s’est vu remettre un prix par quatre associations de défense et de promotion de la langue française : « Le prix d’Indignité linguistique de la satirique Académie de la carpette anglaise a été décerné fin 2022 au président français pour son acharnement à promouvoir la domination de l’anglais en France1 ».
Il en va différemment avec Jacques Chirac qui, dès les années 1970, s’était montré sympathique au mouvement souverainiste québécois et avait toujours œuvré à la reconnaissance internationale du Québec. En compagnie du premier ministre du Québec, Robert Bourassa, Jacques Chirac avait contribué à relancer l’élan des relations franco-québécoises en 1975, en signant un accord mettant l’accent sur les efforts de francisation entrepris par le gouvernement libéral et la mise sur pied de programmes de coopération dans divers domaines. Jacques Chirac avait eu l’occasion de réaffirmer cette coopération lors du sommet de la francophonie à Québec, le 31 août 1987. Il est clair que cette relation privilégiée avec la France avait trouvé sa source dans le voyage historique du général de Gaulle au Québec en juillet 1967.
À quand remonte l’intérêt de Charles de Gaulle pour le Québec ? Pour certains, à 1960, où, par le biais d’une visite officielle aux États-Unis, il retrouve le Canada ; pour d’autres, comme Jean Lacouture, au 1er août 19402 lorsqu’il fait appel à la solidarité des « Canadiens français ». Non, dès sa jeunesse, Charles de Gaulle fait montre d’une très grande passion pour l’histoire de la France en Amérique. Fils d’un enseignant très cultivé – son père enseigne le français, le latin, le grec et l’histoire – au collège de l’Immaculée Conception, au 389, rue de Vaugirard à Paris, avant d’en devenir le préfet des études3, Charles de Gaulle a été élevé dans une culture faisant une large place à la religion catholique et au patriotisme français.
Cet intérêt se trouve vérifié dès 1913, lorsqu’après avoir été affecté en tant que sous-lieutenant, au 33e régiment d’infanterie d’Arras, régiment qui s’est illustré à Austerlitz, Wagram ou à la Moskova, Charles de Gaulle, décide de prononcer une conférence à la demande de son chef, le colonel Pétain. Le thème retenu par de Gaulle, « Du Patriotisme », lui permet d’évoquer la personnalité de trois héros de l’histoire de France, Jeanne d’Arc, du Guesclin et Montcalm, devant une cinquantaine d’officiers subalternes4. Marine Lefèvre pose une question essentielle : « Combien de Français pouvaient ou auraient choisi dans les années 1910 de nommer un homme de la nouvelle France5 ? ».
En 1917, de Gaulle revient dans ses écrits indirectement sur le Québec. Dans un chapitre intitulé « De la direction supérieure de la guerre », il montre « le défaut du gouvernement à conduire la guerre » : « C’est la faiblesse du gouvernement de Louis XV qui, ne sachant pas imprimer à la guerre le caractère général qu’elle devait y avoir, nous fit perdre […] le Canada […] malgré les talents de Montcalm6 ».
Le 1er février 1921, de Gaulle est affecté à l’École militaire de Saint-Cyr comme professeur adjoint d’histoire militaire. Le cours qu’il doit traiter couvre la période de 1795 à 1918. À défaut de traiter l’histoire du Canada français, ce cours permet de suivre l’intérêt du général pour l’histoire7. « Le fils du professeur de Gaulle est un maître que l’on écoute. […] En 1921, à Saint-Cyr, raconte le général Nérot, nous avions trois professeurs d’histoire. […] Mais c’est de Gaulle qui nous impressionnait le plus. Chacune de ses conférences [une douzaine en tout] était, à proprement parler, un événement8 ».
Dans la famille de Gaulle, on reparle du Québec en 1938.
Cette année-là, le collège Stanislas [de Paris] où étudie Philippe de Gaulle, le futur amiral, ouvre un établissement à Montréal. Pour célébrer l’événement, l’école organise un « prix académique interclasses », réplique du concours général des lycées où cet établissement privé n’est pas admis9. Les dix meilleurs élèves de chacune des six classes de rhétorique sont admis à concourir. Les élèves doivent composer sur l’épreuve suivante : « Décrivez et expliquez pourquoi deux cents ans après le traité de Paris, les Canadiens français demeurent attachés à la langue française10 ». À la distribution des prix, on lit la meilleure copie et « l’élève de Gaulle [Philippe] » monte sur l’estrade sous un tonnerre d’applaudissements. Une question se pose immédiatement : le fils du général a-t-il travaillé tout seul ? « Mon Père n’est en rien intervenu dans mon succès11 », répond Philippe de Gaulle avant de préciser : « Mais il est juste de dire que les questions relatives au Canada français étaient depuis longtemps dans le contexte culturel familial et scolaire : j’en avais donc évidemment entendu parler par mon Père ». Les douze pages de la composition récompensée ont été brochées dans la reliure du volume offert par l’association des anciens élèves au lauréat du prix académique. Deux ans plus tard, le père du futur amiral a été condamné par un tribunal français à la confiscation de ses biens, en plus d’une condamnation à mort. Lorsque la famille de Gaulle revient à Colombey à la Libération, la maison a été vidée et la copie a disparu12.
Par la suite, de Gaulle a l’occasion de venir au Canada à trois reprises, en 1944, en 1945 et en 1960. Mais à chaque fois, il s’agissait de participer à des réunions de travail, pas de rencontrer le peuple québécois.
Les choses changent en 1966. L’état d’esprit du général à cette époque est bien résumé dans l’annotation qu’il appose à une demande de son ambassadeur à Ottawa d’associer la France à la célébration du centenaire de la Confédération canadienne : « Nous n’avons à féliciter ni les Canadiens ni nous-mêmes, de la création d’un “État” fondé sur une défaite d’autrefois. […] Au demeurant, cet ensemble est devenu bien précaire13 ». En somme de Gaulle veut bien aller au Québec, mais pas à Ottawa.
À la mi-septembre 1966, dans le contexte de l’exposition universelle de Montréal « Expo 67 », l’Élysée reçoit deux invitations, l’une d’Ottawa, signée par le gouverneur général Georges Vanier, l’autre de Québec, signée par le nouveau premier ministre Daniel Johnson, dont le relais en France est Jean Chapdelaine, délégué général du Québec à Paris. Selon ce dernier, qui rencontre début décembre 1966 le secrétaire général de l’Élysée, Étienne Burin des Roziers, de Gaulle pourrait venir au Québec en juillet 1967. Chapdelaine évoque alors devant son interlocuteur « son projet d’une remontée du Saint-Laurent en croiseur, ce qui amènerait le général à Québec ». Jean Chapdelaine rencontre Charles de Gaulle à deux reprises, les 11 et 13 février 1967, ce qui montre le sérieux de l’affaire14.
Le 29 mars 1967, de retour de Cherbourg après le lancement du sous-marin Le Redoutable, Pierre Messmer, ministre de la Défense, est assis dans la Caravelle à côté du Général. Messmer l’interroge : « Alors, mon général, vous vous rendrez au Québec ?. Oui, répond de Gaulle : Je n’irai pas au Québec pour faire du tourisme. Si j’y vais, ce sera pour faire de l’Histoire15 ».
Au mois de mai, le général semble encore hésiter lorsqu’il reçoit à Paris le premier ministre du Québec Daniel Johnson. Celui-ci sait convaincre de Gaulle : « Mon général, le Québec a besoin de vous. […] C’est maintenant ou jamais16 ».
Le 23 juin, Charles de Gaulle reçoit à déjeuner à l’Élysée, Madame Pauline Vanier à laquelle il présente ses condoléances après la disparition de son mari, Georges Vanier, ancien gouverneur général du Canada. À la fin du repas, Madame Vanier lui demande ce qu’il compte dire aux Québécois dans un mois. Le général développe alors ses idées sur « l’avènement d’un peuple qui, dans tous les domaines, veut disposer de lui-même et prendre en main ses destinées17 ». Stupéfaite, Madame Vanier peine à trouver ses mots pour exprimer son désarroi devant de tels propos. À l’issue du repas, les collaborateurs du général la font conduire chez le ministre Alain Peyrefitte. Celui-ci lui précise que si de Gaulle a décidé d’apporter son soutien à la cause québécoise, personne ne pourra le faire changer d’avis : « Le Général est un bloc de granit » lui dit-il18.
Le 15 juillet 1967 à Brest, de Gaulle embarque à bord du croiseur Colbert à destination du Québec. « Tout a été pensé de manière à faire de ce voyage un symbole. […] De Gaulle a choisi le croiseur Colbert […] du nom de celui qui a organisé l’administration de la Nouvelle-France », précise Alain Peyrefitte19. Au député Xavier Deniau, venu le saluer sur le quai, il déclare : « On va m’entendre, là-bas. Ça va faire des vagues ». Trois jours plus tôt, il a rencontré son gendre, le général de Boissieu : « Je compte frapper un grand coup. Ça bardera. Mais il le faut. C’est la dernière occasion de réparer la lâcheté de la France20 ».
La traversée de l’Atlantique dure cinq jours et le croiseur Colbert doit affronter la tempête. De Gaulle sort peu de sa cabine. Dans son bureau, le général prépare et corrige ses discours. Il rêve aussi à Paul-Henry de Belvèze, commandant de la Capricieuse.
En 1855, les troupes de l’Angleterre victorienne s’associent à celles de Napoléon III pour soutenir la cause de l’Empire ottoman contre les Russes, lors de la guerre de Crimée. La France, pour la première fois depuis la signature du traité de Paris en 1763, peut donc envoyer un de ses navires dans le Saint-Laurent. De Belvèze reçoit l’ordre de remonter le golfe du Saint-Laurent à titre de « commandant des forces françaises dans les eaux de Terre-Neuve21 ». Le 13 juillet 1855, l’accueil de la Nouvelle-France allait être un triomphe. Mais laissons parler le commandant : « Partout, les populations accouraient à la côte, saluant la corvette de leurs hourras et de salves de mousqueteries ». Cependant, le commandant gagna peu de choses à cette mission. Les « transports » dont la population locale submergea cet officier eurent pour effet de le compromettre22 ».
De retour à Toulon, il fut mis à la retraite en 1861. Dès lors, on sent le commandant attristé : « Après une injustice si persistante, écrit-il le 24 mars 1861, je suis tenté de m’appliquer un mot de je ne sais plus quel auteur : quand je m’examine, je suis humble ; quand je me compare, je deviens fier et orgueilleux23 ». En tant qu’officier de marine, de Belvèze est astreint à l’obligation de réserve. De Belvèze n’a rien dit. De Gaulle s’en souviendra !
Selon Alain Peyrefitte, « sur le Colbert, de Gaulle profite d’un moment avec son chef d’état-major particulier, le vice-amiral d’escadre Jean Philippon, pour lui confier qu’une fois au Québec, il fera un grand coup d’éclat24 ».
Que diriez-vous si je leur criais « Vive le Québec libre » ? propose le général. Oh, vous n’allez pas faire ça, mon général ! répond le vice-amiral. Eh bien, je crois que si, ça dépendra de l’atmosphère25.
Le croiseur Colbert accoste à l’Anse-au-Foulon, le 23 juillet, un dimanche, comme si, en se rendant à la messe en la basilique Sainte-Anne de Beaupré, le Général voulait rendre hommage au clergé catholique qui, pendant deux siècles, avait maintenu l’usage de la langue française au Québec26.
Le lundi 24 juillet, de Gaulle parcourt « Le Chemin du Roy » dont il a tellement entendu parler dans sa jeunesse par son père, chemin ainsi nommé par le Grand Voyer de la Nouvelle-France lors de son inauguration en 1734. Qui a remarqué que Jacques Cartier avait découvert le Canada le 24 juillet 1534 ? Est-ce un hasard si de Gaulle a parcouru ces 270 km entre Québec et Montréal en ce jour anniversaire qui vit Jacques Cartier planter une croix à la pointe de Gaspé : « Le XXIIIe jour dudict moys, [de juillet], nous fismes faire une croix de trente pieds de hault […], sur la poincte de l’entrée dudit hable, soubz le croysillon de laquelle mismes ung escusson en bosse à troyes fleurs de lys, et dessus ung escripteau en boys en grant, en grosse lettre de forme où il y avait “Vive le Roy de France”27 ».
Le capitaine de vaisseau François Flohic, aide de camp du général, a été le témoin privilégié de ce parcours :
La journée du « Chemin du Roy », et sa conclusion par le « Vive le Québec libre » sont l’un plus grands moments de ma vie. Ce jour-là, j’ai vu un peuple, non pas prendre conscience de lui-même puisqu’il ne l’a jamais perdue, mais réaliser brusquement qu’il lui fallait redevenir libre de son avenir. […]. Il poursuit : « Le grief que l’on fait au général de s’être immiscé dans la politique intérieure d’un État ne tient pas à mes yeux28. »
Au moment où le général se présente sur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal, « sur la terrasse arrière du bâtiment, René Lévesque et Yves Michaud sont accroupis devant un téléviseur. […] Robert Bourassa n’est pas loin d’eux. Tout comme l’éditorialiste Claude Ryan et un jeune professeur de droit de trente-six ans, Jacques-Yvan Morin, président des États généraux du Canada français » écrit André Duchesne29.
Quelle sera la réaction du gouvernement fédéral ? Les ministres canadiens du gouvernement d’Ottawa mobilisent le premier ministre Pearson contre de Gaulle. « Le pauvre Pearson est bien embêté, car quelle que soit sa réplique, il voit bien qu’il n’a que des coups à recevoir30 ». Le premier ministre canadien n’était pas favorable à un refus de recevoir le général de Gaulle à Ottawa. André Duchesne précise : « Diplomate de carrière, Lester Pearson était un homme de compromis. Il avait appris, à travers des décennies de vie diplomatique, qu’on est toujours mieux de conserver des portes de sortie ou de conversation plutôt que de claquer la porte dans quelque domaine que ce soit31 ». Pour Christophe Tardieu, « Pearson […] voit dans l’expulsion de nombreux désavantages. Le premier d’entre eux est qu’Ottawa a voulu faire de l’Exposition universelle de Montréal un événement de première importance, une grande opération de communication pour célébrer le centième anniversaire de la Constitution du Canada. Expulser comme un malpropre le plus illustre de ses visiteurs ne serait pas la meilleure publicité pour cette opération majeure de relations publiques32 » […] « Enfin, l’expulsion de De Gaulle bouleverserait un Québec déjà en ébullition et susciterait des mouvements dont on ne sait jamais s’il est possible de les maîtriser33 ». Le premier ministre penche pour la prudence. Il a compris que si de Gaulle devait « quitter le pays après y avoir été forcé, les Québécois ne comprendraient pas et Ottawa en subirait les conséquences34 ». Et pour bien montrer qu’il n’est pas question d’annuler la visite du général de Gaulle à Ottawa, Lester Pearson, dans une déclaration publiée le mardi 25 juillet en fin d’après-midi, précise : « Certaines déclarations [du général de Gaulle] sont inacceptables. […] Le gouvernement du Canada dans le passé comme maintenant a toujours eu le vif désir de renforcer cette amitié [avec la France]. J’espère que mes entretiens avec le général de Gaulle, plus tard cette semaine, montreront qu’il partage ce désir35 ».
André Passeron, l’envoyé spécial du Monde chargé de couvrir le voyage du général de Gaulle, a bien résumé la situation : « Dans le texte du communiqué publié par le cabinet d’Ottawa, le terme “inacceptable” a été jugé lui-même inacceptable [par de Gaulle], et l’annonce faite par M. Pearson que le général s’entretiendrait avec lui des paroles qu’il venait de prononcer a été prise pour une sommation à venir s’expliquer, à laquelle il ne pouvait être question de se soumettre36 ».
Tard dans la nuit de mardi 25 à mercredi 26 juillet, de Gaulle rassemble ses plus proches conseillers qui donnent leur avis. « Finalement [le général] met fin aux échanges et se range derrière une opinion : la sienne. Charles de Gaulle n’ira pas à Ottawa37 ». En réalité, ajoute Jean Lacouture, « de Gaulle n’avait aucune envie d’aller à Ottawa. Il a saisi le premier prétexte – d’ailleurs suffisant !, pour s’épargner cette visite qui ne pouvait aller sans guérilla protocolaire ni amertumes ressassées38 ». En réalité, le général faisait en quelque sorte le voyage que le roi Louis XV souhaitait réaliser si la France n’avait pas abandonné la Nouvelle-France en 1763. Or, Louis XV n’aurait pu se rendre à Ottawa, une ville qui n’existait pas. Par ailleurs, pouvait-on imaginer le général participer à une réception à Rideau Hall, résidence du chef de l’État canadien à Ottawa, alors que pour la deuxième fois, il venait de refuser l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun ?
Le mercredi 26 juillet, à 16 h 22, l’avion du président de la République s’envole pour la France. De Gaulle jubile. En cette année de la célébration du centenaire de la confédération canadienne, il a réussi à éviter l’étape d’Ottawa. Dans cette effervescence, Jean-Daniel Jurgensen, directeur du service Amérique du Quai d’Orsay, s’adresse à de Gaulle : « Mon général, vous avez payé la dette de Louis XV39 ». Dès le 31 juillet 1967, Jacques-Yvan Morin avait donné son interprétation du discours de Montréal dans une note manuscrite40 : « Les Canadiens français savent désormais que leur volonté d’affirmation et d’épanouissement ne constitue pas un recul […] mais au contraire un élan naturel de leur être et une revanche nécessaire du vital sur l’immense mécanique qui les entoure ». Quant à François-Albert Angers, il précise : « En cette année du centenaire, le général de Gaulle a, en définitive, sauvé l’honneur même du Canada français41 ».
Le 24 août 1967, le journal Le Monde publie « Une déclaration d’intellectuels québécois » visant à « expliquer à l’opinion française pourquoi le Québec a fait au président de Gaulle un accueil triomphal ». Parmi la cinquantaine de signataires, figure le nom de Jacques-Yvan Morin :
Nous croyons […], que le Québec doit à ces fins [perpétuer sur le continent américain la présence de la civilisation française], sur tous les plans, posséder lui-même les instruments économiques et juridiques nécessaires et choisir librement sa destinée sociale, culturelle et politique. Dans une situation qui n’est pas sans rappeler sous certains rapports le fait colonial, le progrès social, économique et culturel de la collectivité québécoise dépend entièrement de son émancipation politique. […]
Voilà pourquoi nous avons acclamé le président de Gaulle, dont nous admirons l’énergie et le courage, l’humanisme et la hauteur de vues. Voilà pourquoi nous avons voulu acclamer en sa personne et en ses déclarations la France dont nous sommes issus, la communauté française à laquelle nous entendons appartenir, le Québec même que nous voulons voir devenir « maître chez lui ».
La France, par son gouvernement, vient en quelque sorte de nous redécouvrir et d’aviver notre espoir […]. Nous demandons à la presse française, de même qu’à l’ensemble des dirigeants politique français, de ne pas trahir cet espoir.
Malgré la difficulté de réaliser dans la pratique tous les désirs exprimés, il reste avant tout l’éclatante et vigoureuse affirmation faite par l’un des chefs d’État les plus prestigieux du siècle : le Québec a le droit et Le Devoir de survivre et d’affirmer son caractère distinctif en tant qu’État nord-américain de culture française42.
Près de cinquante ans plus tard, Jacques-Yvan Morin a parfaitement analysé la signification : « De Gaulle n’a pas dit : “Vive le Québec libéré !” Il a dit : “Vive le Québec libre de choisir !”43 ». Dans un article publié à l’occasion du cinquantième anniversaire du discours historique de de Gaulle, Élisabeth Gallat-Morin en évoque la portée : « Lorsque nous allions en France par la suite, pendant au moins un an, nous devions expliquer à nos amis la situation du Québec ; non, nous ne considérions pas la déclaration du Général comme une gaffe diplomatique. Au contraire, il avait voulu contribuer à redresser le sort que la conquête britannique nous avait infligé44 ».
Mais laissons la conclusion à Jacques-Yvan Morin : « Il est extrêmement rare que le monde puisse être saisi d’un problème comme celui du Québec par le geste pacifique d’un seul homme45 ».
1 Courrier international, 5 janvier 2023, Le Devoir, 5 janvier 2023.
2 Jean Lacouture, Charles de Gaulle, Le Souverain 1959-1970, Paris, Éditions du Seuil, p. 509
3 Jean Lacouture, Charles de Gaulle, Le Rebelle, 1890-1944, Paris, Éditions du Seuil, p. 15 et 25
4 Charles de Gaulle, Du Patriotisme, 1913, manuscrit autographe, 9 feuillets, Archives privées, Paris. Charles de Gaulle, 1932, Le Fil de l’épée, catalogue d’exposition, Musée de l’Ordre de la Libération, avril-juin 1983, Paris, Plon, 1983, p. 55.
5 Marine Lefèvre, Charles de Gaulle, du Canada français au Québec, Montréal, Leméac Editeur, 2007, p. 8.
6 Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets, volume I, p. 382.
7 Charles de Gaulle, ibid, p. 524.
8 Jean Lacouture, De Gaulle, Le rebelle, op. cit., p. 113. De Gaulle, Cours d’histoire, Saint-Cyr, 1921, brochure, 192 pages, Musée de Saint-Cyr, Coëtquidan. Le Fil de l’épée, catalogue d’exposition au Musée de l’Ordre de la Libération, avril-juin 1983, Paris Plon, 1983, p. 60.
9 Christophe Tardieu, La Dette de Louis XV, Paris, Les Éditions du Cerf, 2017, p. 266.
10 Anne et Pierre Rouanet, Les Trois Derniers Chagrins du général de Gaulle, Paris, Grasset, 1980, p. 36.
11 Ibid. p. 37.
12 Ibid, p. 39.
13 Jean Lacouture, De Gaulle, Le Souverain, op. cit., p. 513.
14 André Duchesne, La Traversée du Colbert : De Gaulle au Québec en juillet 1967, Montréal, Éditions du Boréal, 2017, p. 26.
15 Alain Peyrefitte, De Gaulle et le Québec, Montréal, Alain Stanké, 2000, p. 54.
16 Anne et Pierre Rouanet, op. cit., 1980, p. 61.
17 Extrait du discours prononcé au Château Frontenac à Québec le 23 juillet au soir, Ibid, p. 98.
18 Alain Peyrefitte, op. cit. p 57.
19 Alain Peyrefitte, op. cit., p. 58.
20 Jean Lacouture, De Gaulle, Le Souverain, op.cit., p. 515.
21 Armand Yon, Le Canada vu de France, 1830-1914, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1975, p. 28.
22 Ibid, p. 34.
23 Ibid, p. 36
24 Alain Peyrefitte, op. cit., p. 65.
25 André Duchesne, op. cit., p. 79. Sur le chemin du retour, l’amiral dit à de Gaulle : « finalement, je pense que vous avez eu raison de dire ça »
26 À 11 heures 30, le Général se rend à la messe en la basilique Sainte-Anne de Beaupré, centre de pèlerinage situé sur la côte nord du Saint-Laurent. Au XVIIe siècle, des marins français, surpris par la tempête, auraient abordé sains et saufs sur le rivage de Beaupré après avoir imploré sainte Anne de les épargner. Pour remercier leur protectrice, Ils élevèrent en son honneur une petite chapelle en bois. Plus grande église du Québec, Sainte-Anne de Beaupré comporte 4 000 sièges. Plus de 1 000 personnes, faute de place, sont restées debout. Fait exceptionnel, le Général communia au cours de l’office. (Cf. Christophe Tardieu, op. cit., p. 28).
27 Jacques Cartier, Relation du premier voyage de Cartier contenant le récit de l’érection d’une croix dans la baie de Gaspé, le 24 juillet 1534, manuscrit, Bibliothèque nationale de France, fol. 65 verso. En 1934, à l’occasion du quatrième centenaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier, Camille Pouliot publie La Grande aventure de Jacques Cartier, (Québec, 1934). Dans l’introduction de l’ouvrage, l’auteur précise que la version de la Relation ainsi publiée, « est la seule authentique, pour avoir été rédigée sous la direction immédiate de Cartier, si même elle n’a pas été écrite et signée par lui ». Cette version fait partie, depuis 1867, de la collection Moreau (cote BnF : 841, 51-68). L’une des plus nombreuses parmi les collections diverses annexées au fonds des manuscrits français de la Bibliothèque nationale de France, elle compte 1 834 volumes et comporte des documents relatifs à l’histoire de France recueillis durant la seconde moitié du XVIIIe siècle par Moreau (1717-1804), avocat et bibliothécaire de Marie-Antoinette.
28 François Flohic, Souvenirs d’Outre-Gaulle, Paris, Plon, 1979, p. 94.
29 André Duchesne, op.cit., p. 164.
30 Christophe Tardieu, op. cit., p. 89.
31 André Duchesne, op.cit., p. 193.
32 Christophe Tardieu, op. cit., p. 89.
33 Ibid., p. 90.
34 Ibid., p. 198.
35 Ibid. p. 201.
36 Le Monde, 28 juillet 1967, p. 2.
37 André Duchesne, op. cit., p. 206.
38 Jean Lacouture, De Gaulle, Le Souverain, op. cit. p. 527.
39 Xavier de la Chevalerie, « Le Voyage du général de Gaulle au Québec en 1967. Témoignage », Espoir, no 112, 1997, p. 13. Jean Jurgensen, normalien, agrégé de lettres en 1941, est membre du comité directeur du mouvement Défense de la France, qui prend rapidement une part importante dans la presse clandestine, avant de devenir directeur du quotidien France Soir. Au titre du Mouvement de Libération Nationale, il devient délégué à l’Assemblée Consultative Provisoire, en 1944. Dans le cadre de ses fonctions, il s’est personnellement engagé dans la défense de la francophonie ainsi que dans la civilisation du Québec, dont il appréciait la devise « Je me souviens ». Il devait recevoir les insignes de Docteur Honoris Causa de l’Université Laval à Québec
40 Fonds Jacques-Yvan Morin, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Montréal.
41 L’Action nationale, octobre 1967, p. 177.
42 « Pourquoi le Québec a fait au président de Gaulle un accueil triomphal », Le Monde, 24 juillet 1967, p. 3. Nous avons reçu un long texte signé par des universitaires, journalistes, syndicalistes, écrivains, artistes et autres citoyens du Québec dont le but était d’expliquer pourquoi le Québec a fait au président de Gaulle un accueil triomphal.
43 Lors d’un entretien avec André Duchesne. Cf. André Duchesne, op. cit., p. 273.
44 Élisabeth Gallat-Morin, « Le Balcon, vu de la terrasse, 50 ans après », Montréal en tête, Revue de la Société historique de Montréal, numéro 68, automne 2017
45 Revue Espoir, 1975.