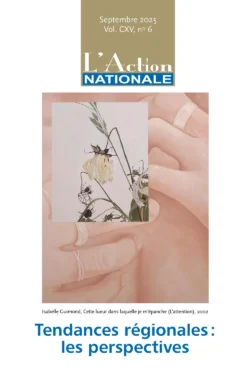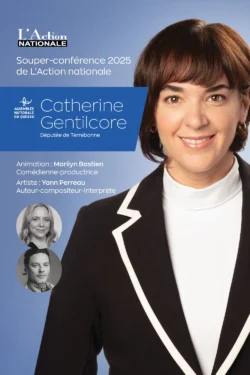Depuis quarante ans et plus, le mode de scrutin électoral du Québec, appelé « scrutin uninominal majoritaire à un tour », est remis en question. On sait que ce scrutin vise à élire un député dans chaque circonscription électorale, à la majorité simple : le vainqueur est celui qui a obtenu le plus de votes, parfois avec aussi peu que 30 % des suffrages.
Le principal projet élaboré pour le remplacer, le « scrutin proportionnel mixte avec compensation régionale », n’a jamais été adopté pour être mis en application, en général parce qu’une majorité de députés du parti gouvernemental avait manifesté ses réserves, voire son opposition.
Le dernier projet envisagé prévoyait l’élection de 80 députés selon le « scrutin uninominal majoritaire à un tour » et la nomination de 45 députés dans les différentes régions du Québec selon une répartition proportionnelle : dans chaque région, à raison de 2 ou 3 ou 4 députés selon le cas, les partis politiques concernés auraient désigné les personnes appelées à siéger à l’Assemblée nationale ; ce projet n’a jamais fait l’objet de débats au parlement québécois.
Mon dessein a pour but de proposer un autre modèle, le mode de « scrutin alternatif », que certains appellent « scrutin préférentiel ».
Parmi les pays qui ont retenu ce mode de scrutin, l’Australie représente l’exemple le plus intéressant. En vigueur dans l’État fédéral depuis plus de cent ans, il l’est aussi dans les États membres de la fédération, avec quelques variantes. Il est aussi en vigueur en Inde et en Irlande pour l’élection présidentielle.
Description
Selon ce mode de scrutin, dans chaque circonscription électorale, le bulletin de vote permet à un électeur d’indiquer en alternance devant le nom de chaque candidat son ordre de préférence en écrivant dans des cases pertinentes les chiffres 1, 2, etc.
Ma proposition limite à trois candidats l’obligation pour l’électeur de préciser ses choix prioritaires ; un bulletin qui n’aurait pas le minimum requis sera rejeté au dépouillement du scrutin. Mais un électeur pourra, s’il le désire, exprimer ses intentions pour plus de trois candidats, sans que son bulletin soit rejeté.
Lors du dépouillement des résultats, sera déclaré élu d’une circonscription le candidat qui a obtenu 50 % ou plus des premiers choix identiques des électeurs.
Sinon, on passera au deuxième tour : le nom du candidat ayant obtenu le moins de premiers choix sera retiré et les deuxièmes choix exprimés sur les bulletins du candidat écarté seront redistribués entre les autres candidats désignés.
Si aucun candidat n’obtenait 50 % des votes au deuxième tour, on retirera le nom de celui ayant obtenu le moins de votes (l’avant-dernier candidat sur la liste de départ) et on procèdera au troisième tour par une nouvelle redistribution des choix. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un candidat obtienne 50 % ou plus des votes et soit déclaré élu.
Lorsque le deuxième choix d’un électeur s’appliquera à un candidat dont le nom a été retiré, c’est le troisième choix qui sera transféré au candidat identifié. Il pourra arriver que ce troisième choix soit aussi celui d’un autre candidat dont le nom a été retiré ; dans ce cas, le bulletin de cet électeur sera rejeté lors du dépouillement, à moins que celui-ci ait indiqué un quatrième choix.
Simulation
Pour illustrer ce mode scrutin, j’ai procédé à une simulation effectuée à partir des résultats de l’élection générale du 3 octobre 2022. Pour mémoire, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait obtenu 40,98 % des suffrages valides ; Québec solidaire (QS), 15,43 % ; le Parti québécois (PQ), 14,61 % ; le Parti libéral du Québec (PLQ), 14,37 % ; le Parti conservateur du Québec (PCQ), 12,91 % ; le Parti vert du Québec (PVQ), 0,76 % ; le Parti canadien du Québec (PCaQ), 0,32 % ; l’ensemble des autres petites formations, 0,56 %.
Je suis conscient que ces résultats auraient été différents si le mode de « scrutin alternatif » avait été en vigueur. Il est certain aussi que les électeurs d’une circonscription qui ont voté en premier choix pour le même candidat n’auraient pas nécessairement retenu un même candidat en deuxième choix ni en troisième ; par contre il est probable qu’ils auraient retenu les noms de candidats d’un mouvement politique apparenté.
Quoi qu’il en soit, le présent exercice permet d’éclairer une application de ce mode de scrutin.
Mon analyse indique que, dans 46 circonscriptions électorales, les premiers choix des électeurs auraient été exprimés à 50 % et plus des suffrages en faveur des candidats déclarés élus en 2022 et répartis comme suit :
CAQ : 34 ; PLQ : 8 : QS : 3 ; PQ : 1.
Reste à poursuivre l’analyse et distribuer les deuxième et troisième choix des électeurs dans les 79 autres circonscriptions.
Selon mon hypothèse de travail, les électeurs d’un premier groupe auraient appuyé les candidats des partis politiques suivants : le PQ, QS et le PVQ dont les programmes présentaient des similitudes sur plusieurs points ; à ce premier groupe, j’ajoute la CAQ, bien que plusieurs électeurs du second groupe auraient pu l’inclure dans leur choix. Les électeurs de ce second groupe auraient appuyé les partis politiques suivants : le PLQ, le PCQ et le PCaQ pour des raisons identiques, et parfois la CAQ.
Il demeure possible qu’un électeur d’un groupe ou de l’autre aurait préféré retenir en troisième choix un candidat d’une petite formation peu susceptible d’être élu et éviter ainsi de voter pour le candidat d’un parti concurrent ; autrement dit, d’annuler son vote, selon l’expression consacrée.
En seconde hypothèse, les électeurs des petites formations politiques auraient retenu comme deuxième et troisième choix les candidats des partis apparentés au premier groupe ou ceux apparentés au deuxième groupe, selon leurs convictions.
Il va sans dire que ces hypothèses demeurent sujettes à caution. Elles n’ont d’autre but que d’expliquer sur quelle base j’ai élaboré ma simulation. À partir de ces hypothèses, mon analyse indique que, dans 72 circonscriptions, les résultats de 2022 auraient été confirmés et les candidats élus députés auraient été répartis ainsi :
CAQ 55 ; PLQ : 6 ; QS : 8 ; PQ : 2.
Restent huit circonscriptions où ma simulation se traduit par un changement de vainqueurs par rapport à ceux déclarés en 2022 : 5 candidats de la CAQ auraient été élus députés à la place de candidats du PLQ ; 2 de QS à la place de candidats du PLQ ; 1 du PQ à la place d’un candidat de la CAQ.
Pour bien saisir ma démarche, voici les données détaillées de mon exercice dans deux circonscriptions, à titre d’exemple.
Mille-Îles
|
PARTI |
1er tour |
2e tour |
3e tour |
4e tour |
5e tour |
|
PLQ |
9 522 |
9 522 |
12 627 |
12 627 |
12 627 |
|
CAQ |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
9 097 |
16 783 |
|
QS |
3 789 |
4 135 |
4 135 |
7 686 |
– |
|
PQ |
3 551 |
3 551 |
3 551 |
– |
– |
|
PCQ |
3 105 |
3 105 |
– |
– |
– |
|
PVQ |
346 |
– |
– |
– |
– |
|
Total |
29 410 |
29 410 |
Selon ce scénario, la candidate de la CAQ aurait été élue avec 57,07 % des suffrages, à la place de la candidate du PLQ.
Rimouski
|
PARTI |
1er tour |
2e tour |
3e tour |
4e tour |
5e tour |
6e tour |
|
CAQ |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
16 319 |
16 319 |
|
PQ |
9 440 |
9 440 |
9 440 |
9 440 |
9 440 |
16 641 |
|
QS |
7 042 |
7 097 |
7 201 |
7 201 |
7 201 |
– |
|
PCQ |
1 566 |
1 566 |
1 566 |
2 558 |
– |
– |
|
PLQ |
992 |
992 |
992 |
– |
– |
– |
|
Climat Qc |
104 |
104 |
– |
– |
– |
– |
|
Démoc. Dir. |
55 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Total |
32 960 |
32 960 |
Ce scénario suppose que tous les électeurs du PCQ, outre leur deuxième choix en faveur du PLQ, auraient indiqué comme troisième choix la CAQ, ce qui est peu probable ; il s’agit d’un maximum. Le candidat du PQ aurait donc été élu avec au moins 50,49% des suffrages, à place de la candidate de la CAQ.
Si on additionne les effets de mes trois exercices, la comparaison entre les résultats officiels de 2022 et ceux de ma simulation se présente ainsi :
Bilan selon les résultats officiels :
CAQ : 90 ; PLQ : 21 ; QS : 11 ; PQ : 3 ; total : 125.
Bilan selon ma simulation :
CAQ : 94 ; PLQ : 14 ; QS : 13 ; PQ : 4 ; total : 125.
J’insiste pour rappeler que ma simulation demeure une étude théorique et ne prétend en aucune façon présenter les résultats de 2002 si la mode de « scrutin alternatif » avait été en vigueur. Il s’agit d’un exercice pédagogique.
Conclusion
Le mode de « scrutin alternatif » se traduit par plusieurs avantages.
1 – Tous les vainqueurs d’une élection générale remportent les suffrages par une majorité de 50 % ou plus, contrairement aux deux modes de scrutin présentés au début de cet article. La légitimité des députés comme représentants des citoyens est d’autant plus grande, comme est bonifié le reflet de leur contribution au processus législatif.
2 – Tous les élus l’emportent dans des circonscriptions électorales et constituent une seule classe de députés, contrairement au mode de « scrutin proportionnel avec compensation régionale » où on retrouve des députés de circonscription élus par les citoyens et des députés de région désignés par des partis politiques. Sont maintenues les relations de tous les députés avec les habitants de leur circonscription, relations directes auxquelles les Québécois sont habitués.
3 – Ce mode de scrutin permet de réduire les possibilités de division des votes entre plusieurs tendances d’un même courant idéologique et encourage la collaboration entre les partis politiques concernés. C’est ainsi qu’en Australie un parti politique d’une tendance donnée transmet généralement à ses électeurs connus des propositions pour les deuxième et troisième choix qu’ils devraient indiquer sur leur bulletin de vote pour éviter de favoriser l’élection d’un adversaire d’un autre courant idéologique.
4 – De son côté, un électeur peut décider de voter pour le candidat d’un parti dont le programme correspond le mieux à ses convictions politiques, sans risquer de « perdre son vote » si ce candidat a peu de chance d’être élu. Par son deuxième ou son troisième choix, il favorisera le candidat d’un parti plus susceptible de remporter l’élection.
5 – Dans le même esprit, multiplier les votes en faveur des candidats d’un petit parti présente l’avantage d’accroître les contributions de l’État au financement public des partis concernés. On sait que la Loi électorale du Québec assure le remboursement de la moitié des dépenses électorales d’un parti, ou, dans une circonscription, la moitié de celles d’un candidat, si les résultats sont supérieurs au seuil minimal légal. De plus, un petit parti verra augmenter l’allocation annuelle que l’État verse aux formations politiques reconnues au prorata des résultats de la dernière élection générale. Si le mode de « scrutin alternatif » était introduit, il faudrait préciser dans cette loi que les résultats considérés sont ceux du premier tour.
La résistance, pour ne pas dire l’opposition, des parlementaires de l’Assemblée nationale, anciens et actuels, au remplacement du « scrutin uninominal majoritaire à un tour » par un « scrutin proportionnel mixte avec compensation régionale » porte sur deux aspects jugés négativement :
- l’abolition de 25 circonscriptions électorales sur les 125 actuelles, avec pour conséquence l’extension démesurée de l’étendue de celles des régions rurales, particulièrement de celles des régions périphériques du Québec, moins peuplées que celles de la vallée du Saint-Laurent ;
- la création de deux classes de députés, avec la probabilité que les 25 députés des régions désignés par les partis politiques soient choisis par les « apparatchiks » de leur direction et non pas par les militants de leur base.
Ces deux critiques perdent leur pertinence avec l’introduction du « scrutin alternatif » qui apporte en plus des bénéfices indéniables par rapport au mode de scrutin actuel.
D’aucuns estimeront que le scrutin alternatif n’atténue que légèrement la distorsion entre le pourcentage des votes et le pourcentage des sièges obtenus par chaque parti politique. Si un mode de scrutin avec une composante proportionnelle modérée comme en Allemagne ou une répartition proportionnelle intégrale comme en Israël vise à corriger partiellement ou totalement cette distorsion, je ne suis pas convaincu que ces modes de scrutin accentuent le caractère démocratique d’un régime politique. Mais ceci est un autre débat qui mériterait d’être tenu.
* Politologue.