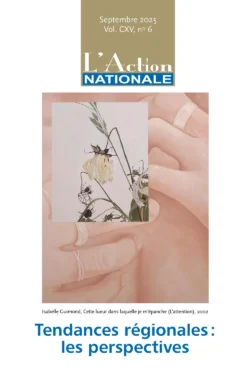Titre complet : Un cas de la bourgeoisie de Victoriaville. Mixité et alliances matrimoniales au sein des élites au XIXe siècle
L’histoire sociale révèle l’importance des réseaux de sociabilité dans la création et la cohésion d’un noyau élitaire autour duquel gravitent les notables. Le lien familial qu’il soit de parenté directe ou par alliance constitue l’un des principaux facteurs de cette cohésion. Quand on observe et étudie le maillage des gens d’affaires avec leur milieu, on ne peut s’empêcher de remarquer que celui-ci se fait majoritairement entre gens de bonne société et de même classe. Un mariage entre les enfants composant l’élite ne peut que renforcer le pouvoir de ceux-ci.
De plus, et contrairement à ce que nous pourrions penser, il est en effet fréquent qu’un membre de l’élite d’origine francophone puisse épouser quelqu’un de l’élite anglophone.
Les rapports entre anglophones et francophones au sein des élites sont fréquents et loin d’être aussi conflictuels que ne l’a laissé entendre l’historiographie. Les deux communautés se côtoient fréquemment lors de réceptions et d’activités sportives et leurs enfants s’unissent dans les liens sacrés du mariage1.
Afin de comprendre les mécanismes de promotion sociale qui mènent à la notabilité ou de saisir la cohésion du groupe des notables, il nous apparaît important de connaître les liens et les réseaux de parenté. Maude-Emmanuelle Lambert nous dit notamment dans son mémoire de maîtrise en histoire de l’Université Laval que l’insertion matrimoniale entre autres dans les réseaux de relations et de pouvoir peut jouer un rôle déterminant. Elle cite d’ailleurs en exemple le cas d’un membre de l’élite de Rimouski.
Le réseau social de Joseph St-Laurent a été façonné par des relations d’affaires, mais aussi par les alliances matrimoniales qu’ont contractées ses fils et ses filles. Le prestige social qu’il a acquis au sein de la communauté rimouskoise lui a sûrement permis de « bien marier » ses fils et ses filles à des membres de l’élite locale. Ainsi, à la fin de sa vie, Joseph St-Laurent peut compter dans son entourage plusieurs notables et Rimouskois influents2.
Dans le cas qui nous préoccupe, examinons le parcours de quelques enfants de Paul Tourigny afin de pouvoir suivre leur ascension sociale au sein de l’élite de Victoriaville. Ce que l’on sait de l’histoire est que M. Paul Tourigny fut, dès les années 1880, un important acteur du développement économique de Victoriaville. Il fut à la fois maire de Victoriaville, député provincial du comté, marchand important, spéculateur foncier, industriel et homme d’affaire avisé. Il réussit au fil des ans à se constituer une véritable fortune et décéda en 1926 d’une longue maladie.
Ainsi, nous verrons rapidement que chaque enfant a su respecter sa condition sociale en mariant quelqu’un de la même classe sociale. Les élites se rassemblent entre elles. Rappelons-nous que le concept d’élite renvoie à l’idée de domination et de distinctif, mais aussi d’excellence, de prestige et de pouvoir.
MARIAGE DES ENFANTS DE PAUL TOURIGNY
|
ENFANT |
CONJOINT (E) |
PROFESSION |
|
Corinne |
Rodolphe Pépin |
Médecin |
|
Laure |
Joseph Nathaniel Poirier |
Notaire |
|
Arthur |
Alphonsine Fréchette |
Fille d’un commerçant |
|
Anne Esther |
François Moise Pelletier |
Médecin |
|
Berthe |
J.P.Henri Massicotte |
Médecin |
|
Conrad |
Mary Graindler |
Fille d’un entrepreneur |
|
Roger |
Florence Bonner |
Fille d’un ingénieur |
À la lecture de ce tableau, nous ne pouvons que constater l’existence d’importants liens matrimoniaux. Tous les enfants sont reliés par alliance (beau-frère, gendre) à au moins un autre membre du groupe. Cette situation révèle une certaine proximité entre les différents acteurs de la petite bourgeoisie francophone. En effet, il est avantageux pour un homme influent de marier sa fille à l’un des siens, alors que le mariage peut faciliter l’accès d’un jeune homme à la notabilité notamment par l’intégration au sein d’un réseau d’affaires. Il est donc clair que le choix de l’époux ou de l’épouse résulte, dans une certaine mesure, de la volonté de sa famille et de son réseau social. Les jeunes célibataires de l’élite baignent toujours dans les mêmes réseaux qui leur présentent les candidats acceptables pour leur statut social. À cet égard, les enfants de Paul Tourigny ne font pas exception à la règle puisqu’ils sont restés regroupés au sein de la même classe sociale.
Il est de plus intéressant d’observer qu’un des garçons de Paul Tourigny était membre du clergé en étant prêtre. Il faut se rappeler qu’au début des années 1900, la venue d’un de ses enfants au sein d’une congrégation religieuse renforçait la respectabilité sociale de la famille. Lysandre Saint-Pierre nous mentionne d’ailleurs à cet effet dans son mémoire de maîtrise en études québécoises, ce qui suit :
L’honorabilité que l’élite retire de ses bonnes relations avec le clergé accroît sa distinction sociale et sa légitimité de s’imposer comme modèle à suivre pour le reste de la population3.
Combien de familles québécoises s’honoraient d’avoir un ou plusieurs membres des leurs dans les différentes communautés religieuses du Québec, cela était bien vu de donner un de ses enfants au Bon Dieu.
Il est intéressant de constater que tous les enfants ont marié des personnes du même rang social. Les professions libérales sont nettement représentées avec notamment trois médecins et un notaire. Les hommes ont également épousé pour la plupart des filles de commerçant ou d’entrepreneur. La conjointe de Conrad est d’ailleurs d’origine allemande et son grand-père était entrepreneur et propriétaire d’un moulin.
Le recensement de 1861 fait aussi mention de nombreux autres moulins. On retrouve notamment trois moulins à farine, trois moulins à scie, un moulin à carder et un moulin à fouler. Parmi les entrepreneurs, signalons Allan McDonald, Charles Provencher, Amable Beaudet, Cyrille Grindler et Antoine Michel4.
Il semblerait qu’à l’exemple de son frère Conrad, qui a épousé une jeune fille d’origine allemande, Roger ait également épousé une jeune femme possiblement d’origine anglaise, venant de la municipalité de Richmond dans les Cantons de l’Est. Nous avons vu que son père était ingénieur mécanicien et nous savons de plus que Richmond était une jonction importante pour le trafic ferroviaire puisque deux compagnies y opéraient, soit la St. Lawrence and Atlantic Railway, en 1852, et la Quebec and Richmond Railway, en 1854. Beaucoup plus tard, en 1921, c’est la Grand Trunk Railway qui prend la relève.
Bien loin d’être une exception, les mariages mixtes (entre Canadiens français et Britanniques) sont courants au sein des élites à Québec au XIXe siècle. … La plupart des grandes familles comptent au moins un mariage mixte en leur sein. … Donc, peut-on encore parler d’élites distinctes alors que la plupart d’entre elles comptent des notables issus d’autres origines dans leur famille5.
Dans le cas de mariages ethniques à l’époque du XIXe siècle, l’évêque autorisait le mariage à condition que le (ou la mariée) de religion non catholique ne puisse empêcher l’autre conjoint et les enfants à venir lors de l’union à pratiquer leur foi. Il ne faut pas oublier les élites – tant anglophones que francophones – sont toutes animées d’un même désir de distinction sociale. Cela leur permet non seulement d’afficher leur rang dans leurs activités quotidiennes, mais aussi d’inscrire ces rapports de domination dans le subconscient collectif.
Il faut aussi tenir compte que les réseaux de sociabilité et de parentèle sont également très importants quand vient le temps, pour les enfants, de trouver un partenaire de vie. Ils choisissent des partis acceptables en regard de leur statut social. Le bon mariage est une marque de distinction et un moment important de la reproduction sociale.
1 TREMBLAY, Alex, La mixité culturelle au sein des élites québécoises au XIXe siècle : l’exemple de la famille Marchand, 1791-1900, mémoire de maîtrise en histoire, Université Laval, Québec, 2014, page 1.
2 LAMBERT, Maude-Emmanuelle, La petite bourgeoisie francophone en milieu périphérique : parcours historiques d’une famille de marchands généraux de Rimouski, sur trois générations (1855-1945), mémoire de maîtrise en histoire, Université Laval, 2005, page 48
3 SAINT-PIERRE, Lysandre, « Fais donc comme les autres » : formation d’une culture élitaire dans une petite ville en industrialisation, Joliette, 1860-1910, mémoire de maîtrise en études québécoises, Université du Québec à Trois-Rivières, page 174
4 Aperçu historique : Gentilly, Patrimoine Bécancour, http://www.patrimoinebecancour.com/uploads/apercu-historique-gentilly.pdf
5 TREMBLAY LAMARCHE, A. (2015). « Les mariages mixtes à Québec dans les deux derniers tiers du XIXe siècle ». Cap-aux-Diamants, (121), 17–20