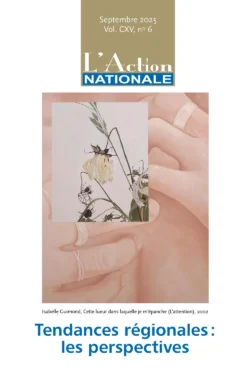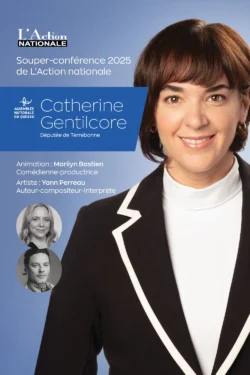René Lévesque occupe toujours une place centrale dans notre histoire nationale. Pour bien mesurer son legs historique, il faut voir à quel point tous tentent de récupérer son héritage. Il est étonnant de voir que même les plus fédéralistes tiennent à s’approprier les fruits des réalisations du fondateur du mouvement Souveraineté-Association et du Parti québécois.
En 2009, en allant au bout de cette logique de récupération, on est allé jusqu’à faire de Lévesque un grand Canadien !
Je cite : le Maclean’s magazine qui décrivait René Lévesque :
Lévesque, nommé l’un des 18 Canadiens extraordinaires par Penguin Books, est le sujet de Canadiens extraordinaires : René Lévesque par Daniel Poliquin. Dans un extrait de Maclean’s, l’auteur écrit comment ce grand homme aux yeux rouges et à la traînée de fumée de cigarette a changé non seulement Québec, mais le Canada1.
Si certains des plus farouches opposants à René Lévesque, même ceux qui l’ont combattu avec hargne, tentent de récupérer son héritage, c’est que son action a littéralement changé le Québec.
Félix Leclerc avait vu juste en disant : « Dorénavant, il fera partie de la courte liste des libérateurs de peuple. » Félix, nous le savons tous, ne parlait pas du peuple canadien, mais bien du peuple québécois.
Des valeurs
Depuis la célébration de son 100e anniversaire de naissance, il y a deux ans maintenant, nous avons eu l’occasion de nous souvenir de la vie de l’homme et de ses réalisations.
S’il y a une chose dont je suis certaine, c’est qu’il aurait été un peu mal à l’aise devant la pluie d’hommages qui lui est rendue. Il aurait certainement préféré qu’on s’attarde davantage aux problèmes du présent, aux difficultés quotidiennes que vivent nos concitoyens et au rôle du Québec dans un monde en pleine mutation.
Je vous propose de le faire aujourd’hui en m’inspirant des valeurs qui l’ont toujours animé, sans présumer des solutions qu’il aurait préconisées.
L’immigration
Les premiers souvenirs que beaucoup de Québécois gardent de René Lévesque remontent à la deuxième moitié des années cinquante, quand il animait l’émission Point de mire. En fait, il a été le premier à nous expliquer les grandes crises qui secouaient le monde, à nous faire comprendre ce qui arrivait dans les pays que seuls nos missionnaires avaient visités.
Quand je regarde l’état monde, je me dis qu’il serait bon qu’un grand vulgarisateur nous trace le portrait des drames qui secouent notre planète.
Avec ses neuf milliards d’habitants, notre monde ne sera plus jamais le même. Les effets des changements climatiques sont de plus en plus concrets. On peut prédire sans grand risque d’erreur que le réchauffement climatique et les événements météo extrêmes qu’il engendre entraîneront des vagues migratoires et des crises humanitaires sans précédent dans l’histoire de l’humanité.
Notre situation géographique ne doit pas faire illusion. Toutes les sociétés seront touchées.
Si nous voulons éviter les graves crises sociales que cela peut entrainer, nous devrons avoir une politique d’intégration des nouveaux arrivants. Celle-ci devrait viser à de permettre à chacun d’apporter une part de sa culture qui nous enrichira, mais aussi de l’inciter à adopter notre langue commune et les valeurs les plus fondamentales qui dessinent le ciment qui nous unit, qui nous permet de vivre ensemble harmonieusement. Je pense ici particulièrement à l’égalité des sexes et à la laïcité de l’État.
Un monde d’incertitudes
Le monde est le foyer de nombreux conflits armés et de zones de tension qui pourraient facilement faire glisser l’humanité dans des guerres aux issus incertaines. Les prétentions de la Corée du Nord, la relation entre Taiwan et la Chine, la volonté de celle-ci de s’emparer de territoires en mer de Chine méridionale jusqu’à proximité des côtes des Philippines, la tension à la frontière entre deux puissances nucléaires, le géant indien et le Pakistan, la guerre au Yémen, le sort des Palestiniens et le climat de haine entre Israël et l’Iran, l’anarchie en Haïti, les situations troubles en Amérique centrale et en Amérique du Sud…
La liste des conflits et des zones de risque n’en finit pas et, avec leur nombre, le risque d’un dérapage majeur s’accroit. Dans Le Devoir, Élisabeth Vellet comparait la situation géopolitique à la tectonique des plaques. L’accumulation des tensions risque de provoquer une catastrophe majeure dont les conséquences humaines et économiques peuvent bouleverser l’ordre du monde.
À cet égard, elle citait le philosophe Antonio Gramsci :
La crise représente cet espace intérimaire où l’ancien monde n’en finit pas de mourir alors que le nouveau peine à naître. Dans cet interrègne sombre, tout ce que l’on sait, c’est qu’on ne sait plus.
Le Québec aurait intérêt à consacrer beaucoup plus d’énergie à ses relations internationales. Les entreprises, les chercheurs universitaires, les médias et l’État devraient accorder davantage d’importance aux dossiers internationaux. Nous n’avons pas le poids pour exercer une influence déterminante dans les grands dossiers internationaux, mais nous avons quelques cartes dans notre jeu et nous pourrions éviter d’être totalement pris au dépourvu faute de ne pas avoir prêté suffisamment d’attention au reste du monde.
Le sens de la démocratie
Au centre des combats qui ont façonné les politiques de M. Lévesque, on trouve sans conteste la défense de la démocratie. Il a changé radicalement les règles du financement des partis politiques et défendu l’importance du droit du peuple à décider de son avenir.
Comment ne pas constater la fragilité de la démocratie dans le monde ? Lors de l’effondrement du mur de Berlin et de la dissolution de l’URSS, comme d’autres, j’ai cru que la démocratie progresserait rapidement et, surtout, durablement. Dans l’ancien bloc de l’Est, mais aussi ailleurs dans le monde. Aujourd’hui, quand on observe attentivement ce qui se passe en Turquie, en Inde, en Russie ou en Chine, comment ne pas nous inquiéter ?
En fait, même à nos portes, chez notre grand voisin américain, le sens des institutions démocratiques est contesté. Et on peut prédire sans risque de se tromper que dans le reste du Canada, là où la majorité des gens se nourrit à même les idéologies américaines et les médias américains, ce qui se passe au sud de notre frontière aura une grande influence.
Face à cette déferlante, le Québec doit renforcer ses institutions démocratiques, s’assurer de la présence de médias forts et indépendants. Il doit aussi renforcer son système d’éducation pour s’assurer que la transmission des savoirs ne soit pas soumise à des dictats idéologiques.
La méfiance face au pouvoir occulte de l’argent
Un autre des traits de caractère de M. Lévesque se traduisait par une méfiance face au pouvoir occulte de l’argent. Ne nous méprenons pas. Il ne mettait pas en cause l’importance pour les entreprises de faire des profits, l’importance de reconnaître le travail et le mérite. Non, ce qui l’inquiétait c’est le pouvoir occulte, la force du lobbying qui influence les politiques et le manque de transparence de nos institutions qui minent la démocratie.
C’est pour assurer cette transparence qu’au début des années quatre-vingt, il a fait adopter la loi sur l’accès aux documents des organismes publics. Et c’est un autre gouvernement du Parti québécois qui, en juin 2002, a fait adopter la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
Au fil des années, on trouve toujours des failles qui permettent d’échapper aux lois. Au chapitre de la transparence, le Québec devrait s’assurer que l’ensemble des ministères et organismes soient beaucoup plus vigilants, qu’ils respectent non seulement la loi, mais son esprit. Il faudrait veiller à ce qu’il n’y ait pas de délais indus dans le traitement des demandes d’information.
Il faudrait aussi clarifier les lois et règlements pour qu’il n’y ait pas de pression occulte de la part des lobbyistes et des entreprises auprès du gouvernement.
Le Québec, plus que d’autres juridictions, pour des raisons historiques et systémiques, a été obligé de défendre ses entreprises et d’en soutenir le développement. Cela requiert des fonds publics importants. En contrepartie, cela exige de la part de l’État une plus grande vigilance et une plus grande transparence. Quelques fois la transparence peut sembler difficile, mais à terme elle est toujours un gage d’honnêteté et de succès.
En passant, il est difficile de comprendre comment la compagnie américaine Boeing a pu obtenir du gouvernement canadien, sans appel d’offres, un contrat de 9 milliards $ pour le renouvellement de sa flotte d’avions de surveillance. Refuser au tandem Bombardier-General Dynamics le droit de soumissionner ou de faire une proposition révèle quelque chose de très inquiétant dans la gestion de l’État fédéral. J’espère qu’un jour, nous connaîtrons tous les dessous de cette histoire. Il y a peut-être là quelque chose de beaucoup plus trouble que le scandale des commandites.
La sensibilité envers ceux qui en arrachent le plus
Une autre des valeurs qui ont guidé M. Lévesque est sa défense de celles et ceux qui en arrachent le plus. Il fuyait les idéologies et les étiquettes, mais il était sensible aux besoins des plus démunis, aux difficultés rencontrées par les personnes qui travaillaient fort pour joindre les deux bouts. Il hésitait toujours à le dire, mais acceptait d’être qualifié de social-démocrate. Le modèle de concertation et de partage de la richesse des pays nordiques l’inspirait.
Grâce aux avancées sociales réalisées dans la foulée de la Révolution tranquille, les écarts de richesse sont sans doute moins importants au Québec que dans le reste du Canada et, évidemment, aux États-Unis. Cependant, la tendance actuelle est inquiétante. Dans un contexte économique où la compétition est exacerbée, nous devons demeurer vigilants.
L’homme des réformes
Je ne sais pas ce que Monsieur Lévesque proposerait aujourd’hui aux Québécoises et aux Québécois, mais je suis certaine d’une chose : aujourd’hui comme hier, il serait un homme de son temps. Les réformes audacieuses qu’il a pilotées il y a un demi-siècle s’inscrivaient dans un moment bien précis de notre histoire. La vision était claire et globale. Il voulait nous permettre de gravir les marches qui nous conduiraient à assumer toutes nos responsabilités comme peuple, d’être en bonne place dans le club des nations progressistes et prospères.
Aujourd’hui, les deux plus grands lieux de l’intervention de l’État, l’éducation et la santé, traversent une période critique. Nous devons évidemment tout mettre en œuvre pour en améliorer la gestion, pour assurer de meilleurs services. C’est l’évidence, mais je crois qu’il faut aller beaucoup plus loin.
Il est temps de convenir des bases d’un nouveau pacte social pour rendre notre système d’éducation plus équitable, pour qu’il soit en mesure de former les nouvelles générations en fonction de ce que sera le monde de demain, pour que chaque enfant ait la chance de développer tout son talent. Je ne crois pas qu’il soit possible d’y parvenir sans une large réflexion que les observateurs appellent une commission Parent 2.0.
Dans le secteur de la santé, il est temps aussi de convenir d’un nouveau pacte. Notre réseau de la santé ne livre pas les promesses qu’on nous a faites. Aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence. Certains soins ne sont pas assurés du tout. D’autres qui devraient être accessibles en tout temps ne le sont pas. Enfin, alors que nous savons que les soins de premières lignes sont déterminants pour la santé, c’est dans des soins toujours plus spécialisés que les ressources se concentrent.
Le système québécois est prisonnier de la loi canadienne. Le gouvernement fédéral a renié ses engagements financiers tout en imposant toujours plus de contraintes. Il n’y aura pas de solution miracle, mais pour nous assurer que notre système de santé repose sur des bases saines, qu’il y ait une adéquation entre les besoins et le financement, il faudra mettre en cause le carcan imposé par l’État fédéral. Le système québécois est prisonnier des diktats d’Ottawa qui a renié ses engagements de financement.
Il faut bien sûr laisser une chance à la réforme en cours, mais nous savons qu’elle ne permettra pas de trouver un nouvel équilibre. Au moment de notre réflexion, il faudra regarder sans tabou les meilleures pratiques dans le monde et convenir d’un pacte que nous serons en mesure de respecter.
Nous pourrions parler aussi de transport collectif, d’environnement, de décarbonation de l’économie. Les chantiers ne manquent pas et nous aurons besoin de toutes les compétences et de toutes nos énergies pour réussir.
Le droit des peuples à prendre le contrôle de leur destin
Cela m’amène à mon dernier sujet, le droit des peuples à contrôler leur destin, le droit des Québécoises et des Québécois à réaliser leur souveraineté politique.
De toutes les valeurs défendues par M. Lévesque, l’émancipation du Québec, dans tous les domaines, a sans doute été la plus importante.
Je me souviens de son expression le 20 mai 1980 où après la campagne de peur menée par le camp du NON, après les promesses fallacieuses de Pierre Trudeau de réformer le fédéralisme2, il a dit : « si j’ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois. »
Je me souviens aussi du 5 novembre 1981, de son expression au moment où il a compris que le Québec avait été trahi par les premiers ministres du ROC, au moment où le gouvernement fédéral et celui des neuf autres provinces se sont entendus pour rapatrier et modifier la constitution canadienne sans l’accord du Québec. Je me souviens de ses paroles : « Le Québec se retrouve aujourd’hui dans une position qui est devenue une tradition fondamentale du régime fédéral canadien tel qu’il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul ».
C’était il y a quarante-deux ans.
Certains clament que l’idée même de souveraineté du Québec est dépassée, qu’elle n’est plus pertinente. Pourtant, aujourd’hui comme hier, le peuple québécois est à la merci d’un parlement qu’il ne contrôle pas. On n’a aucun besoin de son accord pour modifier la constitution, pour nommer les juges à la Cour suprême, pour adopter des lois et des politiques qui vont contre nos intérêts.
L’histoire nous enseigne que, pas plus qu’hier, nous pouvons nous fier aux autres provinces pour faire respecter la répartition des pouvoirs entre l’État fédéral et le Québec.
Pour le ROC, c’est le gouvernement fédéral qui est son premier gouvernement et l’État fédéral est bien conscient de son pouvoir politique, son pouvoir d’isoler le Québec. Récemment, le premier ministre du Canada déclarait : « les citoyens se foutent de quel ordre de gouvernement est responsable de quoi. »
Au moment où le monde vit des transformations profondes, au moment où les choix que nous faisons détermineront notre avenir économique, culturel et social, est-ce que le Québec a vraiment le choix ? Peut-on continuer à laisser à d’autres le pouvoir de choisir notre avenir sans notre accord ?
Il s’en trouve pour dire que nous avons un intérêt à demeurer uni politiquement au Canada pour des raisons économiques. L’affirmation mérite d’être vérifiée. Quand on regarde le PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat des pays occidentaux, ils apparaissent dans cet ordre : Le Luxembourg, l’Irlande, la Norvège, la Suisse, les États-Unis, les Pays-Bas, L’Islande, la Suède l’Allemagne, l’Australie, le Danemark, l’Autriche, le Canada3.
La conclusion évidente de ces données statistiques, c’est que la taille d’un pays ne détermine pas la richesse de ses habitants.
A-t-on intérêt aujourd’hui à demeurer au sein du Canada ?
Les Canadiens ne sont pas nos ennemis, ils sont nos voisins et nous n’avons aucun intérêt social, économique ou culturel à laisser nos voisins décider de notre avenir.
En conclusion
Quand on s’interroge sur l’héritage que nous a laissé M. Lévesque, on peut évidemment évoquer toutes ses réalisations. Elles sont immenses, mais selon moi moins importantes que ses valeurs, que l’esprit d’audace et d’initiative qui l’a habité.
Quand il a laissé l’antenne de télévision pour plonger dans l’action politique, c’était pour permettre au Québec d’aller au-delà de son passé. La quête de la modernité, l’esprit du temps et une vision claire et globale de l’avenir orientaient ses réflexions et son action.
J’espère que nous retrouverons rapidement le courage et la volonté d’être maître de notre destin, le goût de servir le bien commun, l’ambition de permettre au Québec d’être une source d’inspiration pour nos voisins et amis, le désir d’être maîtres chez nous. n
1 https://www.newswire.ca/news-releases/rene-levesque-named-extraordinary-canadian-from-macleans-538560901.html
2 « Je m’adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces. Nous mettons nos têtes en jeu, nous, députés québécois, parce que nous disons aux Québécois de voter Non. Et nous vous disons à vous, des autres provinces, que nous n’accepterons pas ensuite que ce Non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien et que tout peut jeu pour avoir du changement ! »
3 Données du FMI 2017. Liste des pays par PIB (PPA) par habitant – Wikipédia (wikipedia.org)
* Cheffe du Parti québécois (2008-2014) et première ministre du Québec (2012-2014).
** Texte extrait de la conférence prononcée le premier juin 2024 à Chandler lors d’une activité bénéfice visant à appuyer l’Espace René Lévesque.