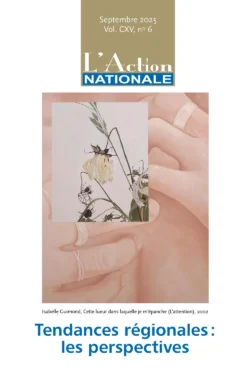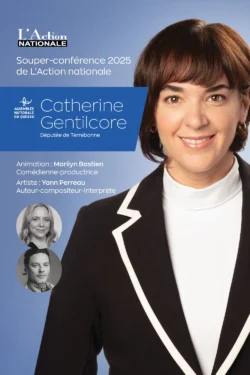L’écriture inclusive privilégie le visible au détriment du lisible. […] Ses doublets, abrégés ou non, en font une graphie complexe qui ne va pas dans le sens du confort de lecture. Ils ne font que rendre « visible » ses intentions idéologiques.
Jadette Laliberté, « L’écriture inclusive peut-elle réussir à s’imposer ? », Argument, vol. 26, no 1, p. 98.
À ce jour, d’innombrables organisations syndicales, organismes, institutions et associations ont joint le camp des militants de l’écriture dite inclusive. Plusieurs cas d’infiltration étonnent, comme celui des communications internes de la Fédération des journalistes du Québec, un syndicat qui rassemble des médias qui ne la mettent pourtant pas en pratique dans leurs publications. Celui aussi de l’Association québécoise de professeur. e. s (sic) de français, de qui ont pourrait s’attendre un peu de circonspection, quand l’OQLF le Multidictionnaire, le Robert, tout comme le correcticiel Antidote, déconseillent unanimement l’emploi du point à d’autres fins que pour… terminer une phrase.
Au nom de la clarté, de la fluidité, de la concision et de l’élégance du propos, il faut dénoncer ces nouveaux usages militants. Cette écriture a notamment ceci de pervers qu’elle inflige aux membres de ces associations des courriels systématiquement truffés de formes non reconnues, donc de… fautes. Faire avaler littéralement de force les couleuvres d’une nouvelle façon d’écrire et de lire le français qui contrevient à plusieurs règles grammaticales, orthographiques, esthétiques ou morphologiques en vigueur coince chaque membre entre l’arbre et l’écorce. Il doit dès lors choisir entre son amour de la clarté et de la concision du français et son adhésion à des associations, qu’il finance pourtant par ses cotisations.
Le plus inquiétant est que cette refondation de la langue se fait la plupart du temps sans consultation réelle et transparente de la base. Elle percole par les plus hautes instances. Au contraire : son modus operandi est le même que celui des cages à homards. Ce n’est même pas le supplice de la goutte, c’est beaucoup plus intense et rapide que ça. À la FPJQ, le comité des communications l’a décrété, mis en pratique puis… a attendu de voir si des membres réunis en AG réagissaient. Or, rien de plus gênant que de jouer au trouble-fête et, surtout, de passer pour une « personne en situation de réactionnariat » comme on pourrait le dire lourdement en novlangue épicène, qui chérit tant les périphrases souvent maladroites, toujours étourdissantes.
Comme prévu, personne n’a osé réagir, et le consensus mou et silencieux a prévalu à la FPJQ.
Des formations complaisantes et orientées
Dans de nombreuses organisations, quand un « processus » est mis en place, il commence et se termine bien souvent par des formations complaisantes et orientées données par des militants qui ne présentent qu’un seul côté de la médaille. Le petit membre ordinaire, non préparé à monter au créneau, n’a pas eu le temps de se ressaisir et de structurer un contre-discours convaincant. Alors quand une formatrice militante financée par nos impôts, après avoir ému l’assemblée en rappelant avec fierté son coming out lesbien passé, affirme : « Le masculin neutre, c’est cancelled », (anecdote réelle) personne ne s’étonnera que personne ne proteste (le terme vague personne étant le petit chéri préféré des inclusivistes, qui en criblent leurs textes avec une affligeante désinvolture, et une parfaite inconscience).
Puis peu à peu, ce premier seuil franchi, les chercheurs de consensus, ceux qui ne veulent pas faire de vagues et, surtout, qui craignent comme la peste d’être associés au camp des conservateurs, se greffent au noyau des militants.
Dans un univers dominé par l’éveil constant aux sources infinies de violence multiforme où on s’épuise à départager sans nuances les victimes d’un côté et les bourreaux de l’autre, l’inoffensif genre non marqué est présenté comme une source d’agression perpétuelle et intolérable. À ce compte, refuser l’écriture inclusive vous range dans le camp des bourreaux avant même que vous ayez pris la parole.
Il est pour le moins paradoxal que le camp même qui se bat contre la binarité « oppressive » du monde soit lui-même si manichéen : d’un côté, le clan des vertueux ; de l’autre, celui des intolérants. Parce que ne nous y trompons pas, c’est bel et bien l’avatar linguistique de l’hydre du wokisme qui se manifeste avec fracas dans la langue. Quand vous coupez une de ses neuf têtes, elle repousse, et tout est à recommencer.
Un arsenal discursif qui appauvrit le français
Déclarer la guerre ouverte au genre non marqué (ou genre neutre masculin) est lourd de conséquences sur la langue française ; ce rejet ne se fait pas sans heurts. Il s’ensuit fatalement que chaque page devient criblée de « stratégies discursives variées », soit les doublets complets ou abrégés, les lourdes périphrases et les termes épicènes, cet arsenal militant ne visant qu’à abattre le « sexisme » présumé de langue française.
Le dernier avis de l’OQLF est fort inquiétant parce qu’il met en danger la clarté et la concision de la langue française. Soulignons au passage que cet organisme financé par nos impôts entretient une ambiguïté suspecte par rapport à la nature même de son rôle. Il agit comme un organisme qui se borne à décrire l’usage, et se vante même de s’y coller au plus près. Or, l’avis Rédiger épicène pour des écrits plus inclusifs va beaucoup plus loin, puisqu’on ne compte déjà plus les organismes et associations qui s’y conforment comme s’il s’agissait d’un ordre auquel l’on doit obtempérer, d’une parole divine. Dans combien de milieux croit-on que l’OQLF est un organisme qui établit la norme, qui sépare le bon grain de l’ivraie, qui tranche les questions les plus délicates ? Or, ses propres linguistes s’en défendent souvent ouvertement, ce qui leur permet de s’en laver les mains en disant que si l’usage évolue, il faudra fatalement le suivre. Ainsi, l’OQLF Ponce Pilate affiche une fausse modestie en prétendant suivre l’usage quand il sait pertinemment bien que dans les faits, ses avis sont soigneusement suivis, rigoureusement respectés. Sinon, pourquoi diable en produire ? En réalité, l’OQLF fait bel et bien autorité, bien qu’elle s’en défende, parce que les locuteurs que nous sommes ont besoin de balises claires pour communiquer avec clarté et efficacité. D’une norme qui s’assume comme telle, quoi. D’ailleurs, l’Office ne se gêne pas pour prendre position pendant ses formations sur le langage épicène : les participants auront par exemple l’insigne plaisir de voir ses linguistes lever le nez avec dédain à chaque mention du genre non marqué, coupable d’une faute originelle, celle d’être alignée sur le masculin.
Il s’agit ici de montrer que le compromis bancal proposé par l’OQLF (mais qui finit par s’imposer dans les politiques internes) finit au contraire, à l’usage, par nuire à la lecture. Ses partisans ont beau nous seriner en affirmant qu’on s’habitue à ces « procédés variés », rien à faire : l’agacement, au fil des pages, croît même avec l’usage.
Considérons donc un à un ces procédés de neutralisation que l’OQLF présente comme la panacée à tous les périls masculinistes.
Une écriture clivante
Le recours au genre non marqué recèle une conception universaliste de l’usage de la langue : « Cette conception met en avant ce qui rassemble plutôt que ce qui divise et, en l›occurrence, ce qui est commun aux hommes et aux femmes, en tant qu’humains, plutôt que ce en quoi ils se différencient1. » Cette grande ligne de clivage déchire entre elles les féministes universalistes des différentialistes. Ces dernières disent que tout ce qui n’est pas exhibé est discriminé ; les premières affirment au contraire que la neutralité garantit toute égalité véritable.
Commençons par régler le cas des doublets complets, que l’OQLF adore et appelle de tous ses vœux. L’organisme ne semble jamais s’être farci la prose redondante des textes qui multiplient les doublons binaires comme étudiants et étudiantes, citoyens et citoyennes ou immigrantes et immigrants. Cet insupportable bégaiement fait constamment ressortir le sexe biologique des principaux concernés, ce qui est particulièrement agaçant dans tous les énoncés où cette question est hors de propos. À ce compte, c’est le référent qui en prend pour son rhume. On vous informe que « des gens ont manifesté » ? On ajoutera en prime, pour rien, qu’il s’agissait de femmes et d’hommes en parlant de « manifestantes et de manifestants ». On feint d’ignorer que la chose est tellement évidente qu’elle n’est nullement digne de mention. Un tel dédoublement est par surcroît contraire à l’esprit même de l’inclusivité : à tout étiqueter, à tout séparer, à tout diviser et à tout sexuer, on exclut forcément. C’est d’ailleurs le cas avec les non binaires, que ces doublets éjectent… Pourtant, le genre non marqué tant honni les a toujours inclus. Qu’on le veuille ou non, à cet égard comme à bien d’autres, « il » est carrément avant-gardiste…
Sauter dans les bras du « bégaiement » ou du « hoquet » que constitue ce dédoublement des mots pour mieux se dédouaner de rejeter l’encombrant et piégé point médian, c’est tout de même « légitimer le principe de l’écriture dite inclusive et de ses postulats activistes à l’effet que le français serait machiste, sexiste, patriarcal bref, inhospitalier aux femmes 2» et qu’il urge d’y remédier.
Si vous croyez que les doublets constituent un moindre mal, sachez qu’ils opèrent bel et bien une brèche majeure, et constituent une victoire patente des inclusivistes.
« C’est la fin de la neutralité idéologique du locuteur », déplore Sami Biasconi dans Malaise dans la langue française. On ne le juge désormais plus vraiment pour le contenu de son discours, mais pour son adhésion à l’idéologie diversitaire, pour son engagement militant. Comprendre le propos d’un énoncé n’est plus l’objectif central : il importe seulement de montrer au lecteur qu’on a visibilisé le féminin en entretenant le mensonge que cela rend concrètement visibles les femmes.
Continuons avec les formulations neutres, dont font partie les périphrases, qui consistent en l’art de dire en plusieurs mots ce qu’on pourrait énoncer en un seul, à tordre et à remodeler les phrases. Écrire, par exemple, « personnes avec statut de résidence permanente » pour éviter le simple « résidents permanents », c’est prendre des détours inutiles. Pourquoi s’obstiner à marteler lourdement « les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants » quand le lecteur ne cherche qu’à savoir qu’on parle simplement de tous les arrivants, tous sexes confondus ? Ce qu’on pourrait exprimer avec concision en deux mots, on le fait en sept ! Et « personnes en situation d’itinérance » ? Ce genre d’euphémisme cherche à cacher la triste réalité que des gens pauvres vivent dans la rue. Le lecteur se trouve confronté à d’incessantes répétitions de termes imprécis et vides, « personne » n’ajoutant rien en substance à la question qui nous intéresse, comme ici le statut des immigrants. À force de se faire rappeler par l’auteur qu’on parle bien là de personnes, et non d’animaux ou d’invertébrés, le lecteur finit par se demander pour qui on le prend… Serait-ce pour plus bête qu’il ne l’est ?
L’OQLF, dans sa belle largesse de stratégies et de procédés variés, promeut aussi les termes épicènes, ces termes neutres, non genrés. Préférer le personnel à employés, personne âgée à aîné, camarade à ami, instrumentiste à musicien, adepte à partisan, jeune à étudiant, c’est leur nec plus ultra. Ici – et cela est terrible – on fait disparaître par un claquement de doigts tout un lexique plus usité ou concret. Le terme instrumentiste, par exemple, associe le musicien à son instrument et non pas à la musique qu’il produit, ce que musicien excelle à faire.
Comment l’OQLF peut-il être devenu si aveuglé par l’idéologie pour ne pas voir que tous ces procédés ont pour effet, justement, de neutraliser la langue, de la rendre impersonnelle, incolore, inodore. Insipide, quoi. C’est là cautionner un crime de lèse langue française.
Conséquence : le lecteur sera de plus en plus condamné à assister à un détournement de sens aussi continu que superflu.
Ajoutons pour compléter ce portrait fascinant le pire de tous les fléaux, à savoir le point, médian ou non, que l’OQLF a la décence de déconseiller. Tout comme la parenthèse, le tiret ou la barre oblique, le point a l’effet pervers d’exclure visiblement l’élément féminin, sa séparation des syllabes qui le précèdent le ravalant au rang de suffixe flottant dans le vide. Illustrons : le terme tronqué « participant. e. s » ravale le féminin au rang de « e » coincé entre deux points. Non mais ! Le féminin mérite mieux que des moignons de mots. Imaginez l’inverse : « participante.pant. s ». Ouache ! Présenter comme un progrès l’invention de mots tronqués, hachurés et démembrés est un comble. Simone de Beauvoir n’a pas eu besoin de recourir à toute cette quincaillerie pour permettre aux femmes de faire des pas de… géantes.
Un château de cartes bâti sur un mensonge
Les défenseurs de l’idée que le masculin neutre est sexiste par essence ont bâti leur édifice argumentatif sur un mensonge en affirmant qu’il correspond au sexe masculin. Or, « aucune équation parfaite entre genre grammatical et sexe biologique n’existe.3 » Le masculin grammatical, ou neutre, tout comme le féminin grammatical d’ailleurs, repose sur des conventions arbitraires. Plusieurs mots qui incluent les hommes sont bel et bien féminins, et pas les moindres : personne, population ou recrue, pour ne nommer que ceux-là. À quoi bon les rendre masculins, sinon pour se couvrir de ridicule ? Pourtant, certains de nos inclusifs en sont rendus à tenter d’imposer le féminin une individue, ou à remplacer, tenez-vous bien, « hommage » par « femmage » quand il concerne la gent féminine4…
Une telle réécriture de la langue ne peut être qu’idéologique. Certains, à la suite d’Orwell, parlent de la « novlangue spécifique » du régime diversitaire, véritable « filtre de la pensée ». Adhérer à l’inclusivisme grammatical constitue même le « signe ostentatoire du ralliement à ses dogmes5. » Cette « exigence de visibilité » donne un formidable coup d’estoc à l’idéal français « d’indifférence aux différences », ou de discrétion à leur égard6. En l’adoptant, « on fait acte de soumission et on “signale” qu’on a rejoint le camp du bien, celui des réformateurs et des partisans de la théorie du genre7. » Difficile d’imaginer imposture plus totale qui transfigure la neutralité grammaticale en engagement militant constant.
L’écriture dite inclusive, en somme, constitue la pointe de l’iceberg à la fois de l’idéologie féministe « différentialiste » et de la théorie du genre. C’est la passerelle qui permet à ces dernières de s’imprégner le plus profondément qui soit au cœur de l’usage des locuteurs du français, et qui les oblige surtout à garder constamment à l’esprit ces préoccupations. Ce sont plusieurs petits vers grouillants dans toutes les pommes !
Le neutre, lui, reconnait qu’il reste du commun entre les deux sexes, qu’ils sont (ré) conciliables et qu’il faut éviter qu’hommes et femmes soient condamnés à se regarder à jamais en chiens de faïence8 !
Cette intrusion du discours diversitaire au cœur de notre langue commune doit cesser. Il n’y a pas à trancher entre la langue française et le français. Les deux genres ont déjà leur place au soleil.
Plutôt tôt que tard, les langues devront se délier, envers et contre tous les risques de passer pour des empêcheurs de tourner en rond. Non, les défenseurs du neutre masculin de sont pas des « phobes » quelque chose, mais des gens qui se bornent à déplorer que cette écriture ne fait que renforcer la perception que le français est une langue compliquée, difficile à maîtriser.
Enlaidir et alourdir le français est incompatible avec sa survie même. C’est sans doute ce que voulait dire Hélène Carrère d’Encausse, de l’Académie française, quand elle qualifiait de « péril mortel » le danger que cette idéologie fait peser sur le français.
La langue doit aspirer à la précision, à la clarté, à l’efficacité, pas à une neutralité artificielle et ampoulée, et encore moins à la promotion d’une idéologie, quelle qu’elle soit. L’écriture dite inclusive est clairement de nature idéologique et est défendue par des militants qui n’ont comme seuls mérites que leur acharnement et l’efficacité de leurs tentatives d’infiltration.
Ce chantage linguistique émotif et idéologique doit cesser. La langue française n’est pas un bar ouvert où chacun prend ce qui lui plaît, mais un bien collectif dont les idéologies à la mode, même drapées de la plus haute vertu, ne doivent pas enrayer le fonctionnement.
1 Nathalie Heinich, « Retour sur le repos du neutre », dans Sami Biasoni, Malaise dans la langue française, éd. du Cerf, Paris, 2022, p. 211.
2 Bérénice Levet, « Ce que le néoféminisme fait à la langue », dans ibid., p. 127.
3 Ibid., p. 130.
4 Idem.
5 Mathieu Bock-Côté, « Fonction politique de l’écriture inclusive », dans ibid., p. 119.
6 Ibid., p. 126
7 Jean-François Braunstein, « Écriture “inclusive” et théorie du genre », dans ibid., p. 169.
8 Bérénice Levet, op. cit., p. 133.
* Professeur de llittérature au collégial.