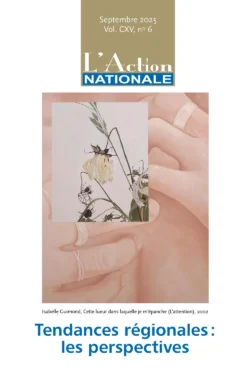Denis Monière
avec la collaboration de Catherine Bertho Lavenir
Voyage au bout de l’indépendance. Ludger Duvernay et les Patriotes exilés aux États-Unis (1837-1842)
Montréal, L’Action nationale éditeur, 2024, 234 pages
Les Patriotes qui se sont exilés aux États-Unis après les affrontements de l’automne 1837, ont été perçus en général par les historiens comme des têtes brulées et des jusqu’au-boutistes. C’est à ces radicaux de 1838 que Monière s’est interessé. Après la défaite de la bataille de St-Charles dans la vallée du Richelieu du 25 novembre 1837, la tête des chefs est mise à prix et les premiers exilés dont Ludger Duvernay fuient à Swanton au Vermont. Le 6 décembre, une première incursion armée des réfugiés a lieu à Moore´s Corner. Une semaine plus tard, à la bataille de St-Eustache, les Patriotes sont défaits, Olivier Chénier perd la vie et l’armée britannique brûle le village de Saint-Benoit. C’est alors qu’environ 500 patriotes se réfugient aux États-Unis pour continuer la lutte de libération nationale.
Le 27 décembre, une assemblée en faveur des Patriotes où O’Callighan intervient se tient à New York et l’effigie de Papineau est ovationnée. Dès le début de janvier 1838, un groupe se réunit à Middlebury pour préparer une invasion armée, alors que Papineau et O’Callaghan s’opposent à une action militaire précipitée et préfèrent l’action diplomatique.
Monière réussit à nous décrire ces combattants de 1838 dont le mouvement offensif diffère largement de la résistance du groupe de 1837. Il nous décrit les misères de l’exil, leur isolement, leurs dissensions, leurs déceptions et finalement l’obligation de se résigner à la nouvelle idéologie réformiste d’Etienne Parent et de LaFontaine.
Ce qui m’a surpris d’abord dans ce récit, c’est qu’il présente le leader Duvernay comme un franc-maçon jouant le rôle de rassembleur. Mis sur cette piste par Léon Z. Patenaude, l’auteur explique les indices qui l’amènent à cette conclusion. Par exemple, la Société « Aide toi et le ciel t’aidera » qu’il avait fondée en 1834 était la réplique d’une société semblable créée en France par un franc-maçon, François Guizot. L’idée de l’entraide mutuelle qui présida à la création de l’Association Saint-Jean-Baptiste le 9 juin 1843 avait aussi des ressemblances avec les buts de la franc-maçonnerie. Et la devise de la SSJB de Montréal, de « rendre le peuple meilleur » correspondait à ce même esprit. C’est sans compter l’appartenance de Duvernay à la loge des Frères chasseurs qui imitait le fonctionnement des loges maçonniques. Monière consacre tout un chapitre à cette société secrète, la loge des Frères chasseurs fondée en février 1838 par Duvernay après l’invasion ratée à Caldwell’s Manor. Il en fut le dirigeant jusqu’à son déclin en 1839. L’influence maçonnique est aussi attestée par le fait que les volontaires américains recrutés pour soutenir la cause appartenaient à des loges maçonniques. Duvernay soutenait alors la logique insurrectionnelle dans Le patriote canadien.
Monière critique dans cet ouvrage (p. 104) la thèse très fragile de l’historien Julien Mauduit qui présente le projet des Patriotes exilés de 1838 aux États-Unis comme celui d’un projet d’union des forces politiques républicaines du Haut et du Bas Canada pour une révolution canadienne des deux colonies, avec un drapeau comportant deux étoiles pour les deux colonies.
Cet ouvrage s’appuie sur une abondante correspondance de Duvernay, soit 759 lettres provenant de 230 correspondants rendus accessibles sous format numérique grâce à Georges Aubin et à l’ouvrage qu’il a publié avec Jonathan Lemire intitulé Ludger Duvernay : Lettres d’exil, 1837-1842 (VLB éditeur, 2015). Denis Monière explique que contrairement à celui de l’Irlande, le mouvement anticolonialiste indépendantiste et républicain du Bas-Canada a été éradiqué de la scène politique pour plus d’un siècle. Cet inachèvement du mouvement d’émancipation s’expliquerait ainsi : « une société qui est décapitée deux fois de ses élites politiques et qui est forcée par la domination d’une puissance étrangère de confier le leadership social à une classe rétrograde et asservie aux intérêts d’une autre nation subit des préjudices historiques difficiles à surmonter » (p. 19). Après l’union imposée, ce fut la soumission à la fois au clergé et au régime d’oppression canadien. L’Église loyaliste a rendu difficile un retour de l’indépendantisme. Il aura fallu une longue marche vers la laïcité d’abord.
L’auteur décrit bien ces exilés qui sont prêts à repartir en guerre et espèrent en vain l’appui des autorités américaines. Un chapitre décrit l’attitude des Américains envers la révolution canadienne. Même si le président Van Buren demande aux Américains de respecter le traité de neutralité avec l’Angleterre, il y eut un soutien populaire à la cause patriote.
Duvernay se déplace cherchant du travail : Swanton, Saint-Albans au Vermont, puis Rouses Point dans l’État de New York. Il s’installera finalement à Burlington au Vermont, au carrefour des activités des Patriotes. L’exilé est un homme seul, il vit dans la pauvreté, loin de sa femme et ses enfants. Cette solitude amène certains à rechercher des aventures sentimentales avec des Américaines. Monière ne se gêne pas de rapporter certains témoignages sur la vie privée qui laissent échapper des secrets d’alcôves. Mais l’espoir fait vivre l’exilé. Déçu du manque d’appui, Duvernay rêvera de reprendre son métier d’imprimeur au service de la cause patriote. Et c’est parce qu’ils ont besoin d’un journal que les chefs modérés du mouvement l’aideront à redevenir imprimeur. Duvernay réussit à se faire accepter des deux groupes, des modérés comme des radicaux ; le seul reproche qu’on lui adressera fut d’être trop conciliant avec la religion.
L’historienne Catherine Bertho Lavenir consacre un chapitre aux femmes de Patriotes face au choix politique des maris. Reine Harnois, l’épouse de Ludger Duvernay, mère de cinq enfants et sa sœur Marguerite ne restent pas à l’écart de l’engagement des Patriotes. Les deux sœurs Harnois soutiennent l’engagement politique de Duvernay en lui donnant des ressources matérielles et l’appui moral. Elles doivent faire vivre les cinq enfants du couple. Elles inciteront Duvernay à ne pas se joindre à l’action militaire au Canada en février 1838. L’auteure historienne conclut : « Elles circonscrivent donc clairement sa liberté de choix.[…] sa famille a sans doute pesé sur certains de ses choix puisqu’il prendra ses distances avec l’action armée et se rapprochera de l’Église. Enfin la ligne éditoriale de son journal répondra aux souhaits de modération exprimés dans les lettres des sœurs Harnois » (p. 61).
Un autre chapitre décrit les querelles, calomnies et dissensions chez les exilés. La minorité radicale à l’intérieur du mouvement prend l’ascendant devant l’attentisme des chefs historiques. Le leadership de Papineau est mis en cause dès janvier 1838. Face au groupe partisan de l’action militaire décidé à relancer l’offensive en envahissant le Canada, les partisans de l’action diplomatique, Papineau, O’Callighan et Wolfred Nelson, ne veulent pas relancer l’offensive militaire sans un appui du gouvernement américain alors que Robert Nelson et le Dr Coté récusent l’attentisme. Monière étudie les relations Duvernay-Papineau et aussi celles entre Duvernay et le Dr Côté. Duvernay juge essentielle l’unité des Patriotes et refuse de couper les ponts avec Papineau, comme le propose la tendance radicale du groupe. Monière explique le comportement de Papineau à se montrer discret en ne participant pas directement aux activités des exilés et ne voulant pas que son nom serve à cautionner ces jusqu’au-boutistes : « ce retraitisme a laissé le champ libre à un leadership plus radical qui n’avait pas l’autorité politique, la notoriété et la légitimité historique pour continuer la lutte de libération nationale » (p. 68).
Duvernay a toujours tenté de concilier les deux tendances. Mais la question religieuse sera au cœur d’une querelle entre Duvernay et Coté. Duvernay mettra de l’avant la défense de la langue et de l’origine française comme fondements de la cause nationale, ce qui déroge de la ligne républicaine et au bilinguisme prévu dans la constitution de la république du Bas-Canada » (p. 72). Ce qui fait dire à Monière que « c’est donc à Burlington que se sont amorcés le réalignement au nationalisme canadien-français et la construction d’une nouvelle conscience nationale axée sur la conservation de la langue et de la religion » (p. 73). Il précise que « c’est durant son exil que Duvernay donnera un caractère religieux à l’organisation de la fête du 24 juin qui, avant 1837, ne contenait pas de références à la religion. Il opère ce rapprochement avec le clergé en 1839 et en 1840 dans l’organisation de la fête de la Saint-Jean à Burlington » (p. 75). Un chapitre décrit l’invasion du 28 février et son échec ; il analyse le document de la déclaration d’indépendance lue par Robert Nelson décrivant le projet d’une société républicaine incluant : « la séparation de l’Église et de l’État, la suppression de la dime, l’abolition des redevances seigneuriales, le suffrage universel pour les hommes y compris les Amérindiens, le scrutin secret, l’élection d’une assemblée constituante et l’emploi du français et de l’anglais dans les affaires publiques » (p. 96).
On souligne que cette déclaration ne fut publiée à Montréal que le 20 février 1839 dans le journal L’ami du peuple. Dans un autre chapitre, on décrit la campagne militaire du 3 novembre 1838 et la prise de contrôle de Napierville où les Patriotes du Bas-Canada affronteront les Habits rouges de Colborne : « 850 combattants de l’indépendance ont été emprisonnés, dont 108 traduits en Cour martiale. Neuf détenus furent acquittés, 99 condamnés à mort. Finalement 12 furent pendus en décembre 1838 et février 1839. 58 des 99 condamnés à mort ont vu leur sentence commuée en déportation en Australie le 27 septembre 1839 » (p. 125). Finalement, l’ouvrage aborde le retour d’exil de Duvernay, qui reprendra son métier d’imprimeur à La Minerve « qui suit à la lettre la politique de collaboration défendue par LaFontaine » (p. 186).
Dans sa conclusion, Monière explique bien comment ces quatre années de lutte révolutionnaire ont amené Duvernay à renoncer au projet d’indépendance : « le combat ne portera plus sur le changement du régime politique, mais sur la conservation de la culture » (p. 187). Dans un appendice, on retrouve une liste des Patriotes exilés et leur lieu de résidence ; des textes relatifs à la rébellion et une chronologie des événements de 1837 à 1843.

Voyage au bout de l’indépendance
Voyage au bout de l’indépendance
Luger Duvernay et les patriotes exilés aux États-Unis (1837-1842)
Octobre 2024
En couverture Daniel Gagné Noces d’octobre Éditorial Détournement, dépendance et dépossession – Robert Laplante Articles L’inventeur du mot courriel – Sylvio Le Blanc Le Québec effacé du guide touristique Bonjour Montréal – Pierre-Paul Sénéchal Un enseignant est-il un expert en pédagogie? – Serge Cantin De l’obligation des juges de respecter strictement leurs devoirs de réserve […]