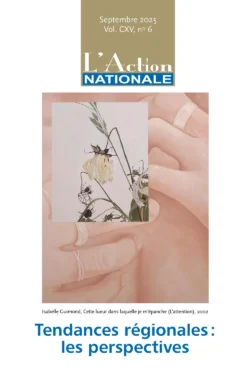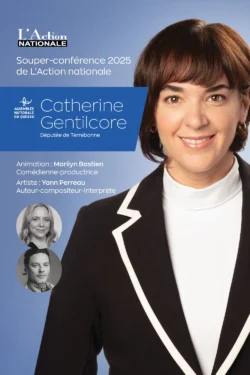Le Québec a, depuis 1968, un ministère de l’Immigration et, grâce aux accords conclus depuis lors avec le gouvernement fédéral, il gère une partie de l’immigration permanente (essentiellement les immigrants dits « économiques ») et de l’immigration temporaire. Lorsque le Québec deviendra indépendant, il bénéficiera donc d’une certaine expérience en matière de gestion de l’immigration internationale. Cette expérience sera très utile, car le passage de ce ministère provincial de l’immigration au ministère d’un État indépendant représente bien plus qu’un saut quantitatif, il constitue aussi un saut qualitatif. En effet, plutôt que de réagir et de tenter de s’adapter à des décisions prises à Ottawa, il appartiendra alors au gouvernement québécois de définir l’ensemble des objectifs qu’il entend poursuivre pour défendre les seuls intérêts du Québec.
Comme nous le discuterons dans la première partie de cet article, les objectifs possibles d’une politique d’immigration sont nombreux et relèvent d’une problématique complexe. Ils impliquent par exemple que l’on ait défini en amont une politique de population. Parmi tous ces objectifs possibles, il y aura ensuite lieu de choisir ceux que le gouvernement d’un Québec souverain devrait poursuivre. C’est ce choix que, très humblement, nous tenterons d’esquisser dans une deuxième étape. La définition des objectifs d’une politique d’immigration implique finalement une série de mesures à prendre pour leur réalisation. Ces mesures couvrent un grand nombre de domaines, de la surveillance des frontières à la francisation des immigrants et à leur intégration économique et sociale. La troisième partie de cet article sera consacrée à un bref survol de ces diverses mesures.
1. Les objectifs possibles d’une politique d’immigration
Toute politique d’immigration poursuit, indirectement ou directement, implicitement ou explicitement, des objectifs d’ordre démographique, économique, socioculturel et humanitaire.
1.a Les objectifs démographiques
En prenant des mesures portant sur le nombre et le profil des immigrants, toute politique d’immigration exprime, souvent sans le dire ouvertement, une vision sur l’avenir souhaité du nombre d’habitants. Mais plutôt que de lancer des chiffres d’immigrants en réagissant à ceux lancés par un gouvernement extérieur (en l’occurrence celui établi à Ottawa), le gouvernement d’un Québec souverain aura la possibilité de définir une politique de population, dont la politique d’immigration n’est en définitive qu’une composante parmi d’autres. Plus précisément, une des premières tâches de ce gouvernement devrait donc être de réfléchir à l’évolution future du nombre de personnes que l’on souhaite établies sur son territoire. Ce nombre ne dépend pas seulement de l’immigration, mais également de la fécondité et de la mortalité.
La première question est donc de déterminer dans quelle mesure le gouvernement de ce pays souverain pourrait influencer le comportement reproductif et le « comportement » de mortalité sa population. En ce qui concerne la fécondité, on sait que pour qu’une population puisse renouveler son effectif, il faut qu’en moyenne chaque femme donne naissance à 2,1 enfants. Or, depuis 1971, soit depuis plus d’un demi-siècle, l’indice de fécondité a toujours été inférieur à ce seuil de renouvellement. Cet indice avait baissé jusqu’à 1,4 enfant par femme dans les années 1980, niveau auquel il s’établit actuellement (l’indice est légèrement supérieur à celui du reste du Canada, où il dépasse à peine 1,3).
Pendant longtemps cette sous-fécondité n’a guère influencé le nombre de naissances, parce que si chaque femme donnait naissance à moins d’enfants, cela était compensé par le nombre important de femmes en âge d’avoir des enfants (les femmes nées pendant le baby-boom des années d’après-guerre). L’apport des immigrantes doit également être pris en compte. Même si celles-ci ont en général une fécondité plus élevée que les non-immigrantes, leur contribution à la fécondité québécoise dans son ensemble est restée longtemps relativement faible, mais avec la baisse des naissances parmi les femmes nées au pays, et avec la forte hausse de l’immigration au cours des trois dernières décennies, leur part dans le total des naissances au Québec a fortement augmenté : la part des naissances issues d’au moins un parent né à l’extérieur du Canada est passée de 13 % en 1980 à 37 % en 2023, et celle des naissances issues de deux parents nés à l’étranger est passée de 7 % à 25 % (ISQ, 2024 : 40).
L’indice de fécondité de 1,4 observé actuellement implique un déficit des naissances d’environ 35 000, c’est-à-dire qu’il faudrait enregistrer plus de 35 000 naissances supplémentaires pour que le comportement de fécondité de la population québécoise puisse assurer le renouvellement de son effectif, et ce chiffre augmentera fort probablement, puisque le vieillissement de la population fera croître le déficit des naissances.
Il semble exclu qu’après plus d’un demi-siècle de sous-fécondité, le comportement de reproduction manifesté par la population québécoise se modifie subitement pour rejoindre le seuil de renouvellement. À l’instar de la quasi-totalité des sociétés dites développées, le Québec semble avoir adopté de façon durable une échelle des valeurs et un comportement reproductif qui impliquent en moyenne moins de deux enfants par femme. Sur l’île de Montréal, l’indice de fécondité est rendu à 1,2 enfant par femme (1,1 pour les francophones). Le record canadien de sous-fécondité est détenu par la Colombie-Britannique, avec 1,0 enfant par femme (moins de 1,0 à Vancouver et Victoria). Certains pays européens font également preuve d’une très faible fécondité : en 2022, moins de 1,1 à Malte, moins de 1,2 en Espagne, 1,2 en Italie, 1,3 en Pologne. On remarquera qu’il s’agit de pays de tradition catholique, comme le Québec. La moyenne enregistrée pour l’ensemble de la population de l’Union européenne s’élève à 1,45 enfant par femme. Il ne faut guère compter sur une politique nataliste pour faire remonter ces chiffres : l’expérience (au Québec comme ailleurs) a démontré qu’une politique nataliste ne peut avoir que des effets minimes et temporaires (l’exemple des « bébés bonus » du gouvernement Bourassa est éloquent à cet égard).
Le deuxième facteur qui détermine l’évolution du nombre d’habitants d’un pays est la mortalité. Il est évident qu’agir sur la mortalité, par le biais de la lutte contre la maladie, en développant la recherche médicale et en développant les conditions dans lesquelles les patients sont traités, devra être une des priorités d’un Québec souverain, tout comme il doit être une des priorités de tout pays, qu’il soit souverain ou non. Cela ne se discute même pas, et à cet égard le Québec doit impérativement poursuivre sur sa lancée. On sous-estime parfois les progrès remarquables réalisés par le Québec à cet égard.
En 1951, l’espérance de vie d’un nouveau-né québécois était de 66,4 ans, celle d’une nouveau-née atteignait 70,9 ans. Quarante ans plus, tard, soit en 1991, les chiffres étaient respectivement de 73,6 et 80,6 ans, ce qui implique que l’espérance de vie avait augmenté en moyenne d’un an tous les cinq ans (tous les 5,6 ans pour les hommes, tous les 4,1 ans pour les femmes). En 2023, cette espérance de vie s’élevait à 80,7 ans pour les hommes et à 84,3 ans pour les femmes. Au cours des 32 dernières années, l’augmentation s’est donc fortement ralentie pour les femmes (un gain d’un an tous les 8,6 ans) mais s’est accélérée pour les hommes (un gain d’un an tous les 4,5 ans). Gagner un an d’espérance de vie en moins de 5 ans (pour les femmes en 1951-1991 et pour les hommes en 1991-2023) est une prouesse qui mérite d’être soulignée. Cela a permis au Québec, qui était en 1951 la province canadienne la plus défavorisée en matière de mortalité, à bénéficier maintenant d’une espérance de vie supérieure à celle du reste du Canada (un écart de 1,7 an pour les hommes, de 0,6 an pour les femmes).
On observe donc que dans une première étape (1951-1991), les femmes ont réalisé des gains plus rapidement que les hommes, mais que par la suite l’évolution a été inverse, à tel point que depuis 1991 les gains ont été deux fois moins rapides pour les femmes. D’une manière générale, tous sexes confondus, la hausse de l’espérance de vie a été nettement plus lente entre 1991 et 2023 qu’entre 1951 et 1991 (un gain d’un an tous les 6,6 ans contre un gain d’un an tous les 4,8 ans). La raison fondamentale de ce ralentissement se trouve dans les progrès réalisés en matière de lutte contre la mortalité infantile. À cet égard, le Québec vient de loin. Encore en 1960, 3 % des nouveau-nés décédaient dans l’année qui suivait leur naissance, mais depuis 1999 ce pourcentage fluctue entre 0,4 % et 0,5 %.
Cette baisse très importante de la mortalité infantile explique une grande partie de la hausse considérable de l’espérance de vie décrite précédemment, tout comme elle explique pourquoi cette dernière hausse a ralenti de façon marquée au cours des dernières décennies (l’épidémie de covid a évidemment contribué à ce ralentissement, mais très peu, et de façon temporaire, entre 2020 et 2022). L’impact d’une baisse de la mortalité infantile sur l’évolution de l’espérance de vie est très fort, parce que les gains que l’on peut faire sont nécessairement plus élevés lorsque l’on meurt à un âge jeune que si l’on meurt à un âge avancé. Par exemple, dans les conditions actuelles de mortalité la survie d’un nouveau-né implique environ 80 années supplémentaires de vie, alors que le décès d’un octogénaire permet de gagner à peine quelques années. Les succès dans la lutte contre la mortalité infantile expliquent donc aussi pourquoi l’on ne peut plus espérer aujourd’hui gagner beaucoup en termes d’espérance de vie : vivre plus longtemps signifie – par définition – que l’on meurt à des âges plus avancés, et donc que les gains d’espérance de vie sont nécessairement plus faibles.
On pourrait résumer en quelques mots l’évolution démographique du Québec en disant que, des trois facteurs qui déterminent cette évolution, c’est d’abord (et ce pendant des siècles) la surfécondité qui a permis la survie du pays, et que lorsque cette surfécondité a commencé à s’essouffler, les gains en matière de lutte contre la mortalité (particulièrement ceux réalisés pour la mortalité infantile) ont pris le relais. Aujourd’hui, les gains en matière de mortalité sont devenus très limités, de telle sorte que l’accroissement naturel de la population est devenu négatif. En effet, le nombre de naissances (qui poursuit sa tendance à la baisse) est maintenant inférieur au nombre de décès (en hausse, suite au vieillissement de la population, lui-même conséquence du déclin de la fécondité). La chute de l’accroissement naturel a été particulièrement rapide : 29 000 en 2011, 23 000 en 2016, 2300 en 2022, 400 en 2023, et -1150 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (dernière donnée disponible). Après le rôle déterminant de la fécondité (jusque dans les années 1960) et des gains en matière de lutte contre la mortalité, nous sommes donc arrivés à une troisième phase, où l’évolution démographique est dominée par la troisième composante, la migration.
Cette troisième phase débute alors que le Québec essaie de gérer les conséquences d’un vieillissement démographique accéléré, une conséquence directe de la baisse de la fécondité et de la mortalité. Entre 1901 et 1961, l’âge moyen de la population québécoise était passé de 25,3 à 27,9 ans, soit une augmentation de 2,6 ans en 60 ans. Au cours des 60 ans qui ont suivi (entre 1961 et 2021), l’âge moyen est passé de 27,9 à 42,6 ans, soit une augmentation de 14,7 ans, donc un gain près de 6 fois plus important. Pour rencontrer les nombreux défis qu’implique un tel vieillissement démographique, notamment pour le système de santé, pour le régime des retraites, pour la structure par âge de la main-d’oeuvre, certains préconisent le recours à l’immigration.
Puisque l’âge moyen des immigrants (environ 30 ans au Québec) est nettement moindre que celui de la population d’accueil (près de 43 ans), il est évident que l’immigration fait rajeunir la population. Ce rajeunissement est cependant très faible. Un petit calcul rapide permet de démontrer cela. Supposons une population composée de 100 personnes dont l’âge moyen s’élève à 42,6 ans (celui observé actuellement au Québec). Cette population accueille chaque année un immigrant (ce qui correspond à un taux d’immigration de 1 %, un taux supérieur à celui enregistré au Québec) et cet immigrant est âgé de 30 ans. Après immigration, l’âge moyen s’établit alors à (100 x 42,6) + (1×30) = 4290 : 101 = 42,5 ans. Ainsi, même avec un taux d’immigration élevé (qui impliquerait l’arrivée annuelle de 90 000 immigrants permanents au Québec, au lieu des quelque 53 000 accueillis en 2023), l’âge moyen ne baisse que d’un peu plus d’un mois grâce à cette immigration. Il faudrait évidemment nuancer ce résultat, en tenant compte de la fécondité des immigrants, mais comme celle-ci est à peine plus élevée que celle de la population d’accueil (1,6 contre 1,4), la conclusion demeure la même : l’immigration ne permet que de ralentir très faiblement le vieillissement démographique.
En outre, l’impact de l’immigration sur le vieillissement de la population d’âge actif est même négatif. En effet, une personne née au pays arrive normalement sur le marché du travail aux alentours de 20 ans, alors que l’âge moyen auquel un immigrant rejoint la population active s’élève à plus de 30 ans. L’immigration fait donc vieillir la population d’âge actif. Il en résulte que l’impact sur les régimes de retraite risque lui aussi d’être négatif, puisque les immigrants disposent de moins d’années pour financer leur retraite.
De ce rapide aperçu du comportement de fécondité et de mortalité des Québécois, on peut conclure (1) qu’il est vain de construire une politique de population en recourant à des mesures visant à influencer le comportement de fécondité, et (2) qu’il faut certes continuer à développer des mesures visant à réduire la mortalité, mais qu’il faut accepter que les gains en matière d’espérance de vie (surtout en termes d’années de vie en bonne santé) seront désormais limités. Il ne reste donc que l’immigration comme domaine d’intervention permettant d’agir de façon efficace et marquée sur l’évolution démographique d’un Québec souverain, et puisque l’immigration est aujourd’hui le seul facteur de croissance démographique (l’accroissement naturel étant maintenant négatif), une politique d’immigration est devenue cruciale pour l’avenir du Québec.
Encore faut-il s’entendre sur le nombre d’habitants que l’on souhaite atteindre dans ce Québec souverain, ce qui implique qu’avant de définir une politique d’immigration, l’on ait adopté une politique de population. Pour ce faire, une des priorités d’un Québec souverain devrait être de créer – enfin ! – un ministère de la Population. La question primordiale est en effet de déterminer si ce nouveau Québec a intérêt à promouvoir la croissance démographique, ou s’il doit plutôt tenter de maintenir stable le nombre de ses habitants, ou encore s’il juge préférable de gérer une lente décroissance de l’effectif de sa population. La réponse à cette question dépend évidemment des objectifs socio-économiques et politiques que ce Québec souverain entendra poursuivre. À cet égard, nous ne pouvons que soumettre, très humblement, quelques considérations.
1.b Les objectifs économiques et politiques
Il n’y a aucun lien entre le nombre d’habitants et le bien-être économique, qu’en première approximation on peut estimer à partir du produit intérieur brut par habitant. Selon le classement de la Banque mondiale, en 2022 parmi les 20 pays ayant le PIB par habitant le plus élevé, ne figurent que deux « grands pays » (définis comme étant ceux dont la population dépasse 20 millions), soit les États-Unis (9e) et l’Allemagne (18e) ; le Canada est au 23e rang. Si le Québec était un pays souverain, il apparaîtrait au 24e rang dans ce classement, loin devant la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Il ne faut pas avoir une population nombreuse pour être riche, bien au contraire. Dans ces conditions, promouvoir l’immigration pour permettre au Québec de poursuivre une croissance démographique qui assurerait un plus grand bien-être économique est difficilement justifiable.
On pourrait cependant soutenir que l’immigration représente par elle-même une source de croissance économique, et certains (particulièrement dans les milieux patronaux) ne se privent pas de recourir à cet argument. Or, celui-ci est totalement non fondé. Ses défenseurs se contentent en effet de mesurer l’impact de l’immigration sur le produit intérieur brut (PIB), et ils constatent évidemment que cet impact est positif : plus il y a d’immigrants, plus le PIB augmente. Un tel résultat n’est rien d’autre qu’un pléonasme : par définition, si l’on ajoute des facteurs de production, celle-ci ne peut qu’augmenter (à moins qu’aucun immigrant ne travaille…). Ce qui importe n’est pas le PIB, mais le PIB par habitant, et la théorie économique aussi bien que les études empiriques montrent que l’impact de l’immigration sur le PIB par habitant est nul, voire négatif.
Quelle que soit la période analysée, quelle que soit la méthode d’estimation utilisée, quel que soit le pays concerné, les résultats sont les mêmes : l’immigration n’a qu’un effet très marginal sur le PIB par habitant. Une étude approfondie de plusieurs économistes des universités de Waterloo et de Carleton (Doyle et al, 2023) va même plus loin, et conclut que l’immigration a causé un appauvrissement de la population canadienne. Tout récemment, le Conference Board of Canada (en décembre 2024) et le Bureau du directeur parlementaire du budget (BDPB) (en janvier 2025), après avoir « découvert » et longuement développé cette lapalissade selon laquelle une augmentation (une baisse) de l’immigration fait augmenter (baisser) la production (le PIB), doivent bien admettre (de manière incidente, rapidement, presque furtivement) que la baisse du nombre d’immigrants annoncée par le gouvernement fédéral pour les années 2025-2027 entraînera une hausse du PIB par habitant. Selon le BDPB, une baisse (entre 2025 et 2027) de 8 % du nombre d’immigrants permanents et de 20 % du nombre de résidents temporaires conduirait à une hausse de 1,4 % du PIB par habitant dès 2027.
L’expérience québécoise permet de renforcer la conclusion selon laquelle l’immigration n’a généralement qu’un impact marginal sur l’enrichissement de la population. Le Québec a en effet connu, au cours du dernier demi-siècle, un véritable « miracle » économique (voir le titre du livre de Mario Polèse publié en 2021). La remarquable expansion économique réalisée par le Québec s’est manifestée essentiellement pendant les années 1960 à 1990, alors que le nombre d’immigrants était relativement faible (si l’on fait abstraction de quelques années de crises internationales aiguës ayant entraîné un afflux important de réfugiés). Ce n’est qu’une fois cette expansion solidement établie que le nombre d’immigrants a commencé à augmenter de manière significative. En d’autres termes, l’immigration n’a pas été la cause du miracle économique québécois, mais elle en est la conséquence.
Ce n’est certes pas un hasard si, au Québec comme dans le reste du Canada et aux États-Unis, ce sont le plus souvent les syndicats et les immigrants déjà installés au pays qui sont les plus réticents à une augmentation de l’immigration, alors que le patronat plaide immanquablement pour une telle augmentation. De part et d’autre, on a très bien compris que l’immigration freine l’augmentation des salaires. Le comportement des syndicats et des anciens immigrants lors des dernières élections présidentielles aux États-Unis a été révélateur à cet égard.
Il est une catégorie d’immigrants dont nous n’avons jusqu’à présent pas parlé, parce que jusqu’à récemment ils étaient peu nombreux. Il s’agit des résidents non permanents, c’est-à-dire des immigrants qui sont admis avec un permis de séjour temporaire. Jusqu’en 2015 leur nombre était très faible, mais était monté à 64 000 en 2019, pour retomber à zéro suite à la pandémie de covid. Dès que les restrictions causées par cette pandémie ont été levées, on a enregistré une véritable explosion des flux d’immigration temporaire (174 000 en 2023), de telle sorte que le stock (le nombre total de résidents temporaires résidant au Québec) s’élevait (au 1er octobre 2024) à 615 000.
On justifie souvent cette immigration temporaire par la nécessité de combler rapidement les pénuries de main-d’oeuvre dans certains secteurs d’activité. Cet argument est discutable, car comment alors expliquer ce soudain besoin de travailleurs qui, avant 2015, ne se manifestait guère. Le recours au vieillissement démographique pour expliquer ce besoin soudain est tout aussi discutable, car ce vieillissement est un processus très lent, qui se déroule depuis des décennies. En outre, quelle que soit la raison invoquée pour justifier cette immigration temporaire, il nous faut accepter que toute immigration, qu’elle soit temporaire ou permanente, crée à son tour de nouveaux besoins. Toute migration implique (du moins partiellement) le déplacement de facteurs de production, mais en même temps elle entraîne un déplacement de la consommation : certains immigrants travaillent, mais tous consomment, et cette consommation supplémentaire crée de nouveaux besoins de main-d’oeuvre. On se retrouve ainsi dans une spirale cumulative, dont il est très difficile de sortir, et qui explique en grande partie la hausse du nombre d’immigrants temporaires. Comme l’a démontré Pierre Fortin (2024 : 22) : « L’immigration a surtout contribué à modifier la répartition de la pénurie entre secteurs de l’économie et n’a pas produit de réduction globale significative de la rareté de la main-d’oeuvre. Elle paraît au contraire l’avoir aggravée ».
L’expérience passée et celle des autres pays démontrent donc que la croissance économique n’est guère liée au niveau d’immigration et d’une manière générale au nombre d’habitants. Il n’en va évidemment pas de même en matière de relations internationales : les pays les plus populeux ont en général un « pouvoir international » plus important.
1.c Les objectifs culturels et linguistiques
Le Québec est sans conteste une des sociétés les plus accueillantes au monde (du moins parmi les pays dits développés) : son taux d’immigration, c’est-à-dire le nombre d’immigrants divisé par le nombre d’habitants, est nettement supérieur à celui des États-Unis et de la plupart des pays européens. Les Québécois ont bien compris que cette ouverture à « L’Autre » est une source d’enrichissement culturel. Au cours du dernier demi-siècle, nous avons pu bénéficier, grâce à l’immigration, d’une diversité remarquable d’activités culturelles dites « ethniques », que ce soit en matière de publications littéraires, de cinéma, de théâtre, ou encore de gastronomie. Cette diversité culturelle est cependant inégalement répartie sur le territoire : elle est beaucoup plus présente à Montréal, où est concentrée la grande majorité des immigrants, et dont le caractère cosmopolite s’affiche de plus en plus, alors qu’en « région » elle est moins développée (quoique rapidement croissante, même en dehors des grands centres urbains).
Cet enrichissement culturel a cependant certaines implications que d’aucuns peuvent considérer comme préoccupantes. Dans certains cas, une diversité culturelle trop étendue peut menacer la cohésion sociale. Le Québec d’aujourd’hui s’est construit autour d’une échelle des valeurs qui accorde une place importante à la laïcité, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la démocratie, à la règle de droit. Jusqu’à présent, et contrairement à plusieurs autres sociétés d’immigration, la cohésion sociale autour de ces valeurs n’a guère été ébranlée au Québec, mais il faut rester vigilant. Une des explications de cette solide cohésion se trouve dans la sélection des immigrants. Lorsque, comme cela est le cas en Europe, les frontières sont poreuses et que la sélection des immigrants est minime, voire inexistante, il devient très difficile de maintenir une forte solidarité autour de certaines valeurs communes. Le Québec (tout comme le Canada) bénéficie à cet égard d’un double avantage, à la fois géographique et politique.
L’atout géographique est évident : le Québec est protégé par un océan à l’est, par le « gendarme » états-unien au sud, et par sa « nordicité ». L’atout politique est celui que procure le système de sélection « par points » utilisé lors de l’admission d’une large part des immigrants. Jusqu’en 1967, les immigrants du Canada (et donc ceux du Québec) étaient admis sur la base d’un système de quotas par pays : les ressortissants de pays « préférés » (le Royaume-Uni, certains pays du Commonwealth, la France) étaient admis quasiment de façon automatique, sans limites, alors que ceux des autres pays étaient presque toujours refusés. Le système par points en vigueur depuis lors permet de sélectionner la plupart des immigrants permanents selon certains critères considérés significatifs pour leur intégration à la société d’accueil : l’âge, l’état matrimonial, la composition familiale, la scolarisation (niveau et domaine), la connaissance des langues officielles, une offre d’emploi validée, l’expérience professionnelle, l’« adaptabilité », l’autonomie financière (éliminatoire). Avec de tels critères, on tente de maximiser la probabilité que l’immigrant s’intègre rapidement à la société qui l’accueille, et donc ne mette pas en danger la cohésion sociale du pays.
Depuis quelques années, ce système par points est remis en cause par l’explosion de l’immigration temporaire (le nombre annuel des résidents non permanents est maintenant plus du double de celui des immigrants permanents). En effet, cette immigration temporaire introduit en réalité une nouvelle procédure d’immigration, une procédure en deux étapes : on arrive avec un permis de séjour « temporaire », et après quelques années on demande un visa d’immigrant permanent. Ces immigrants temporaires se retrouvent dans une problématique migratoire particulière, que nous traiterons ultérieurement (voir les points d, e et f de la section 2).
Parmi les objectifs culturels, il en est un qui présente une pertinence particulière pour le Québec, à savoir l’objectif linguistique. Il importe en effet d’éviter que l’arrivée des immigrants internationaux ne renforce la tendance indéniable à la baisse de la langue française, tant dans l’espace public que dans l’espace privé. Certes, l’avenir du français est assuré en dehors de la région montréalaise, du moins dans un avenir prévisible. Avec plus de 90 % de francophones, et grâce à l’application de facto de la loi du sol (dans l’espace public, l’utilisation du français est quasiment obligatoire), les immigrants non francophones qui s’établissent « en région » doivent presque toujours (Gatineau étant la principale exception) recourir au français lorsqu’ils passent de l’espace privé à l’espace public. Mais il en va tout autrement dans la région de Montréal.
En effet, sur l’île de Montréal, le pourcentage de francophones (définis selon la langue utilisée au sein du ménage) est continuellement en baisse depuis 1971, de telle sorte que les francophones sont sur le point d’y être minoritaires (le pourcentage est passé de 61,2 % en 1971 à 51,5 % en 2021). Et depuis 2001, l’anglais y est en hausse (il est passé de 25 % à 27 % en 2021). En outre, cette baisse du français conjuguée à une hausse de l’anglais s’est maintenant étendue à la Couronne autour de l’île. Même si l’évolution est donc très nette pour la langue utilisée dans l’espace privé, elle ne semble guère avoir influencé le comportement linguistique dans l’espace public, du moins si l’on en croit les résultats d’une étude récemment publiée par l’Office québécois de la langue française (OQLF, 2024). Il est cependant difficile de connaître la langue utilisée par les individus lorsqu’ils quittent la maison, car il faut alors recourir à des enquêtes, avec tous les aléas et limites inhérents aux données obtenues par celles-ci. Selon l’étude de l’OQLF (graphique B, page 47), le pourcentage d’utilisation du français sur l’île de Montréal dans six types de services serait resté stable entre 2016 et 2022, et se situerait entre 64 % et 79 %, selon le type de services. Pour les services les plus significatifs, parce qu’offrant une plus grande liberté de choix linguistique, à savoir les services commerciaux, le pourcentage varie autour de 68 % (pour les services offerts par le gouvernement fédéral, il est de 64 %).
Dans ce contexte, quel peut être l’impact de l’immigration internationale sur l’évolution linguistique de la région montréalaise ? Pour répondre à cette question, trop souvent on utilise des données portant sur la connaissance des langues. Ces données sont basées sur la déclaration (après auto-évaluation) des répondants au recensement, et tendent à surestimer les capacités linguistiques de ces derniers. En outre, elles n’ont guère de signification en termes de comportement réel (ce n’est pas parce qu’on déclare « connaître » une langue qu’on la parle dans la vie quotidienne). Le critère pertinent est la langue d’usage à la maison. Nous disposons de données pour la région métropolitaine (RMR) de Montréal : selon le recensement de 2021, 33 % des immigrants récemment arrivés (en l’occurrence, entre 2016 et 2021) avaient le français comme langue d’usage à la maison (pour les résidents non permanents, ce pourcentage est de 35 %). Or, toujours selon ce même indicateur, la part des francophones dans la population totale de la RMR était de 64 %.
Les immigrants récents sont donc deux fois moins « francophones » que la population d’accueil. Il ne faut pas être démographe pour comprendre que l’immigration renforce la tendance au déclin de la langue française dans la région montréalaise. Cet impact négatif est cependant limité. En effet, les flux annuels d’immigration représentent moins de 1 % de la population, et ce n’est pas en modifiant le profil linguistique de ces flux que l’on peut affecter profondément la composition linguistique de l’ensemble de la population. C’est le comportement démographique et linguistique des autres 99 % qui importe, et ce comportement est dominé, comme nous l’avons souligné, par la très basse fécondité des francophones.
Un rapport récent de Statistique Canada préparé à la demande de l’OQLF (Houle et Corbeil, 2021) fournit une démonstration éloquente de l’impact marginal qu’exerce l’immigration sur la tendance au déclin du poids démographique des francophones. Dans ce rapport, les auteurs ont calculé dans quelle mesure l’évolution linguistique future serait affectée par certaines modifications dans la composition des flux d’immigration. La conclusion principale de ces simulations est très claire : quel que soit l’indicateur linguistique utilisé pour définir le groupe francophone, même des mesures extrêmes (tous les immigrants économiques proviennent de pays francophones, tous connaissent le français, tous ont le français comme première langue officielle parlée, et la moitié de tous les immigrants s’établissent « en région »), même de telles mesures totalement utopiques ne permettent pas de renverser la tendance de long terme au déclin du français, elles ne peuvent que freiner cette tendance.
Une autre manière d’évaluer l’impact d’un phénomène est de supposer qu’il n’existe pas. Dans les prévisions démolinguistiques que Statistique Canada a publiées en 2017, les auteurs ont calculé l’évolution du poids démographique des francophones au Québec en l’absence de toute immigration internationale dès 2017. Les résultats de cette simulation montrent que dans ce cas le pourcentage de francophones continuerait de baisser significativement tout au long de la période de prévision (2017-2036), et ce quel que soit l’indicateur linguistique utilisé. Nous avions d’ailleurs obtenu le même résultat dans nos prévisions démolinguistiques réalisées pour l’OQLF.
Devant de tels constats, on ne peut manquer de s’interroger sur la signification du débat portant sur la francisation des immigrants, et d’une manière plus générale, sur l’impact que peuvent exercer les immigrants sur l’évolution linguistique du Québec. On ne peut mettre sur le dos des immigrants le déclin du français, tout comme on ne peut leur reprocher de ne pas renverser la tendance au déclin. Nous ne pouvons nous empêcher de reprendre une tirade que nous répétons depuis des décennies, à savoir que l’on en demande beaucoup à nos immigrants : on leur demande de remplacer les enfants que nous n’avons pas eus, on leur demande d’avoir les enfants que nous ne voulons plus avoir, on leur demande d’exercer les emplois que nous ne voulons ou ne pouvons pas exercer, on leur demande d’aller en région alors que nous ne voulons pas y aller, et on leur demande de se franciser au plus vite, alors que notre propre comportement linguistique est plutôt laxiste.
1.d Les objectifs humanitaires
Les conflits armés, les guerres civiles, les catastrophes naturelles, avec ce que ces tragédies impliquent en termes de déplacements forcés de population, se multiplient. Le Québec a toujours été généreux dans son accueil de personnes en détresse, tout comme il a largement ouvert ses portes au regroupement des familles. Un Québec indépendant devra cependant définir explicitement une politique d’« immigration humanitaire », plutôt que de réagir aux soubresauts politiques ou naturels de la planète, et aux décisions prises à Ottawa en la matière. Il appartient en effet au Québec et non au « reste du Canada » de décider dans quelle mesure et comment il entend être « humanitaire ».
Il importe avant tout d’avoir une vue d’ensemble, et d’évaluer la place de l’immigration humanitaire par rapport aux autres composantes des flux d’immigration. Parmi les 67 000 immigrants permanents qui seront admis au Québec en 2025, on constate que l’immigration humanitaire (7200 réfugiés et 10 600 dans le regroupement familial) représente plus quart du total et plus de la moitié des seuls immigrants dits « économiques ». À cela il faut ajouter les demandeurs d’asile, qui représentent une part importante (environ le tiers) des immigrants temporaires. Au vu de ces chiffres, on peut difficilement soutenir que le Québec manque d’« humanité » dans sa politique d’immigration.
Nous sommes portés à aller même plus loin. Puisque, comme nous l’avons souligné dans les pages précédentes, il n’y a guère de raisons démographiques, économiques, politiques et linguistiques pour promouvoir l’immigration, celle-ci devrait avant tout être basée sur des considérations humanitaires.
2. Les objectifs pertinents pour un Québec indépendant
Parmi les objectifs possibles d’une politique d’immigration, quels seraient donc ceux que devrait poursuivre un Québec indépendant ? Avant de tenter de répondre à cette question, il importe de s’entendre sur deux principes politiques fondamentaux : la nécessité d’éviter les chocs et celle de tenir compte du contexte dans lequel doit être appliquée toute politique d’immigration.
Le Québec subit encore aujourd’hui (quoique de moins en moins) les conséquences du choc démographique causé par la chute très rapide de la fécondité dans les années 1960, lorsqu’en 10 ans l’indice de fécondité est passé de 4 à 2 enfants par femme. Et depuis 2015, et particulièrement depuis 2022, le Québec connaît un nouveau choc démographique, cette fois dû à l’explosion de l’immigration non permanente, avec un nombre d’immigrants détenteurs d’un permis de séjour temporaire 2,5 fois plus élevé que celui d’immigrants permanents. On ne répond pas à un choc par un autre choc. La démographie d’un pays (tout comme son économie) supporte très mal des changements profonds et subits, elle requiert des évolutions lentes et progressives. Pour répondre au choc démographique actuel, il faudra une politique d’immigration marquée par une transition « en douceur ».
Le second principe politique à prendre en considération porte sur la nécessité de tenir compte des conditions « du moment ». Si le Québec devenait souverain en 2025, nous disposerions de suffisamment d’informations sur le contexte démographique, économique, géopolitique, culturel, linguistique, etc., pour être capables de définir une politique d’immigration qui soit pertinente. Mais s’il faut attendre une autre génération, disons l’année 2050, pour voir naître un Québec souverain, on ne peut prétendre esquisser aujourd’hui une telle politique alors que l’on ne peut connaître les conditions générales dans lesquelles celle-ci devrait s’appliquer. Toute prévision de long terme, même lorsqu’il s’agit du comportement démographique, cependant considéré plutôt stable, est toujours périlleuse et doit être acceptée avec une extrême prudence. Qui avait prévu l’effondrement de la fécondité au cours des années 1960 ? Qui avait prévu l’explosion de l’immigration temporaire au cours des dernières années ?
La prise en compte de ces deux principes fondamentaux nous conduit à soumettre les propositions suivantes.
- Que le Québec devienne un pays souverain aujourd’hui ou grâce à la génération qui nous suit, le premier défi démographique qu’il aura à rencontrer est celui de définir son « poids » démographique : ce Québec souverain entend-il poursuivre une politique de croissance démographique, ou vise-t-il plutôt une stabilité dans le nombre de ses habitants, voire une baisse de ce nombre ? En d’autres termes, avant de définir une politique d’immigration, il devra par priorité définir une politique de population.
- Jusqu’à présent, la définition d’une politique d’immigration peut sembler être limitée à un jeu qui consiste à lancer des chiffres basés sur le passé ou sur une décision externe : le nombre d’immigrants s’élevait à x l’année dernière, doit-il être de x+y ou x-y l’année prochaine ? Le gouvernement fédéral a décidé qu’il y aurait x immigrants l’an prochain au Canada, quel pourcentage z de ces x immigrants le Québec doit-il accueillir ? Il s’agit certes ici d’une présentation caricaturale, mais qui vise à poser une question fondamentale, celle de la justification du chiffre x d’immigrants hérité du passé ou du gouvernement fédéral. En d’autres termes, ce Québec souverain devra par priorité remettre en cause toutes les cibles chiffrées des politiques d’immigration précédentes, et tenter de dégager des objectifs quantifiés (selon les catégories, les critères de sélection, les capacités d’accueil, les régions, etc.) qui répondent aux défis démographiques, économiques, culturels, etc., à court, à moyen et à long terme, du Québec. Cela n’est évidemment pas une mince affaire, et exigera la collaboration de tous les acteurs sociaux.
- Quelle que soit l’année où le Québec devienne un pays souverain, il fera face à un accroissement naturel négatif, un déficit des naissances sur les décès qui ne peut que s’accroître avec le temps. Nous avions précédemment (Termote, 2022) pu estimer à environ 58 000 le nombre d’immigrants que le Québec devrait accueillir annuellement pour maintenir une très faible croissance démographique. Aujourd’hui, suite à l’augmentation plus rapide que prévu du déficit des naissances, ce nombre d’immigrants « compensatoires » devrait croître. En d’autres termes, si un Québec souverain voulait éviter une décroissance de son nombre d’habitants, il faudrait qu’il accueille un nombre croissant d’immigrants (une croissance de quelques milliers chaque année).
- Encore faut-il préciser de quelle immigration il s’agit. Suite à l’explosion du nombre d’immigrants temporaires que connait le Québec depuis 2017 et surtout depuis 2022, il importe en effet de réfléchir à l’avenir de ce type de migration. Pendant des décennies, le nombre de résidents non permanents (RNP) séjournant au Québec était resté stable, légèrement en dessous de 100 000, mais en 7 ans (de 2017 à 2024) il a sextuplé (il s’élevait à 615 000 en 2024), une hausse exponentielle due essentiellement à la croissance du nombre de travailleurs étrangers temporaires (40 % du total en 2024) et de celui des demandeurs d’asile (30 % du total des RNP). Un Québec indépendant ne pourra pas effacer en quelques années une telle explosion. Sans doute pourra-t-il agir sur le nombre de demandeurs d’asile, dont la gestion dépend actuellement du gouvernement fédéral, mais baisser significativement le nombre de travailleurs temporaires sera beaucoup plus difficile, car nombre d’entre eux occupent des emplois que l’on ne peut pas abolir du jour au lendemain.
- La politique d’immigration d’un Québec indépendant devra donc avoir comme objectif de sortir de cette spirale exponentielle dans laquelle est entraînée l’immigration temporaire (une partie seulement des RNP travaillent, mais tous consomment, et cette consommation supplémentaire entretient le besoin de créer de nouveaux emplois, et ainsi de suite…). Nous connaissons actuellement une dynamique migratoire caractérisée par le remplacement progressif des immigrants permanents (dont le nombre est en baisse) par un nombre très élevé et croissant d’immigrants temporaires. Il importe de retrouver au plus vite un certain équilibre entre ces deux types d’immigration, car plus on attend, plus il sera difficile de sortir de cette spirale cumulative que connaît l’immigration temporaire.
- Ces deux types d’immigration obéissent actuellement à des règles différentes : l’immigration permanente est dans une large mesure gérée par le Québec et sa composition déterminée (du moins partiellement) par un système de sélection par points, alors que l’immigration temporaire est pour l’essentiel définie par le gouvernement fédéral, avec un processus de sélection très différent, souvent rudimentaire, lorsqu’une telle sélection existe. En outre, ce double système permet à plusieurs immigrants temporaires d’obtenir la résidence permanente (en 2023, 32 % des nouveaux immigrants permanents étaient des immigrants temporaires). On se retrouve ainsi avec une immigration permanente à deux vitesses : à côté de ceux qui obtiennent la permanence selon la procédure traditionnelle en une étape, il y en a de plus en plus qui l’obtiennent en passant par le statut d’immigrant temporaire. Un Québec indépendant devra non seulement réduire le nombre d’immigrants temporaires, mais également réduire les possibilités de passage vers la permanence.
- Puisqu’il a été démontré et re-démontré que l’impact de l’immigration sur la richesse des habitants du pays d’immigration est nul (voire négatif), et qu’il en est de même pour l’impact démographique (sauf évidemment en ce qui concerne l’effet sur le nombre d’habitants, si l’on considère que l’objectif est la croissance de l’effectif de la population), par contre dans le cas du Québec l’impact culturel et linguistique n’est pas négligeable, du moins dans la région de Montréal. Si un Québec souverain adoptait en matière linguistique le principe de la territorialisation, qui implique que la langue utilisée dans l’espace public sur tout le territoire est uniquement la langue officielle du Québec, soit le français (sauf exception pour la minorité historique de langue anglaise), cela assurerait évidemment la pérennité du français. Un immigrant au Québec se retrouverait donc dans la même situation linguistique qu’un immigrant établi dans les autres sociétés d’immigration, qui toutes appliquent de facto le droit du sol : dès qu’une personne quitte son domicile, elle doit nécessairement utiliser la langue de la majorité de la population du pays où elle réside (dans certains pays, ce droit du sol est d’ailleurs consacré par la loi).
- Dans une société où cohabitent deux langues, comme cela est le cas au Québec (du moins dans la région montréalaise), appliquer dans l’espace public le principe de territorialisation linguistique implique nécessairement privilégier une langue au détriment de la seconde. À cet égard, une citation d’un éminent linguiste belge nous semble appropriée : « Dans notre pays, mettre les deux langues sur le même pied équivaut à mettre les pieds sur la même langue ». On ne peut mettre sur le même pied deux langues inégales, en l’occurrence au Québec d’une part l’anglais, devenu la lingua franca de la planète et la langue dominante tout atour du Québec, et d’autre part le français, de moins en moins une langue universelle et déjà minoritaire (en termes de langue maternelle) sur l’île de Montréal.
- S’il est un objectif pertinent pour toute politique d’immigration, l’accueil humanitaire est certes le plus incontestable. Un Québec souverain devra poursuivre sa longue tradition d’être une terre d’accueil pour les réfugiés, les demandeurs d’asile, la réunification des familles. Étant souverain, il ne dépendra plus d’une autorité externe qui lui dise quand et comment être « humanitaire ». Il pourra désormais déterminer combien de personnes en détresse il recevra chaque année, et sélectionner celles qu’il décide d’accueillir. Cela est particulièrement important en matière d’accueil des demandeurs d’asile, dont actuellement plus de la moitié de ceux présents au Canada se retrouvent au Québec, avec ce que cela implique en termes de pression sur l’offre de services.
Mesures à prendre
Les mesures discutées dans cette dernière étape de notre réflexion concernent celles qui sont spécifiquement liées à l’accession à la souveraineté et ne portent donc pas sur celles que devrait prendre de toute manière le Québec, qu’il demeure ou non une province canadienne. Les pages précédentes ont permis de dégager quelques-unes de ces mesures indispensables en tout temps, par exemple : la nécessité d’arrimer l’immigration permanente et l’immigration temporaire, en réduisant fortement l’immigration temporaire et le passage de celle-ci vers la permanence ; la nécessité de simplifier toute la législation en la matière et celle d’obtenir un suivi du parcours des immigrants après leur arrivée ; la nécessité de franciser les immigrants avant leur arrivée et celle de créer une version montréalaise de la politique d’immigration.
Nombre des objectifs présentés ci-dessous ne peuvent pour l’instant être quantifiés, car la détermination précise de la politique d’immigration d’un Québec souverain dépendra des conditions démographiques, socio-économiques et géopolitiques qui prévaudront lors de l’accès à la souveraineté. Cela n’empêche pas de réfléchir dès aujourd’hui à quelques mesures concrètes que devra prendre un Québec souverain en matière d’immigration.
- Devenir un pays souverain signifie être pleinement responsable du contrôle de ses frontières, ce qui est une condition incontournable de toute politique d’immigration, mais qui ne sera pas une mince affaire, car les frontières internationales du Québec ne se limiteront plus aux quelque 800 kilomètres de la frontière avec notre voisin au sud. Les frontières internationales d’un Québec souverain se dérouleront en effet sur plus de 12 000 km, dont 50 % de frontières terrestres, 38 % de frontières maritimes et 12 % de frontières fluviales. Un Québec souverain devra disposer de forces armées suffisantes (y compris d’une gendarmerie qui ne sera plus « royale »…) pour pouvoir « contrôler » adéquatement une si longue frontière.
- Ce « contrôle » migratoire aux frontières internationales d’un Québec souverain portera en réalité sur trois types de migrations : d’abord les anciennes migrations interprovinciales devenues maintenant des migrations internationales, ensuite les migrations de transit réalisées par des migrants internationaux désireux de s’établir au Québec en passant par les actuelles provinces canadiennes contiguës au Québec, et enfin les traditionnelles migrations internationales entre le Québec et le « reste du monde », dont celles avec son voisin du sud.
- Depuis plusieurs années, les migrations entre le Québec et le « reste du Canada » sont quasiment en équilibre (un léger déficit de 2000 personnes en 2024). Il est probable qu’advenant un Québec souverain, ces migrations interprovinciales devenues internationales se solderaient temporairement par un déficit important, dû essentiellement à un nouvel exode des anglophones, ce qui renforcerait évidemment le poids démographique des francophones. S’il n’y avait pas eu un tel exode (observé surtout dans les années qui ont suivi la victoire du Parti québécois aux élections de 1976), le français aurait été minoritaire à Montréal depuis longtemps ! On peut supposer que tout comme dans les années 1980 et 1990, cet exode sera cependant progressivement résorbé, mais au cours des premières années qui suivront l’accession à la souveraineté, il faudra être prêt à gérer les implications de cette émigration.
- Outre ces anciennes migrations interprovinciales devenues internationales, il faudra gérer les migrations internationales traditionnelles, entre le Québec et le reste du monde. Parmi celles-ci, les relations migratoires avec États-Unis mériteront une attention particulière, puisque le Québec sera alors responsable du contrôle de sa frontière avec son voisin du sud. Il faudra également veiller à « contrôler » l’immigration de ceux qui transiteront par les anciennes provinces contiguës avant de tenter de s’établir au Québec, ce qui ne sera guère aisé. Pour gérer ce double problème frontalier (les 800 km de frontière avec les États-Unis et les milliers de kilomètres de frontières avec les anciennes provinces contiguës, dont le tracé est d’ailleurs incertain et sujet à litiges), des accords internationaux avec toutes les parties concernées devront être négociés.
- Le Québec dispose depuis plus d’un demi-siècle d’une large expérience en matière de gestion de l’immigration, grâce à l’existence (depuis 1968) d’un ministère de l’Immigration, qui ne gère cependant qu’une partie de cette immigration. Supposons, pour donner un ordre de grandeur, que le Québec actuel soit responsable de la moitié de l’immigration et que devenu souverain, la « surcharge » des responsabilités fasse doubler la charge totale (cette surcharge dépendra des nouveaux objectifs de la politique d’immigration et donc des conditions générales dans lesquelles sera réalisée la souveraineté). Dans ce cas, le Québec peut compter sur l’expertise des quelque 2000 employés de l’actuel ministère de l’Immigration (MIFI), et devrait pouvoir « rapatrier » une partie des fonctionnaires de l’IRCC (le ministère fédéral responsable de l’immigration). Ce dernier dispose actuellement de 13 000 employés, mais ce nombre sera réduit à 10 000 en 2025-2028. Si un Québec souverain parvenait à en obtenir 2000 (soit 20 %), cela lui permettrait donc de doubler le nombre de ses fonctionnaires chargés de gérer son immigration, en correspondance avec le doublement de sa charge.
- Mais il faudra aller plus loin, car bénéficier d’un ministère de l’immigration ne suffira plus : il faudra (enfin !) créer un ministère de la Population, dont l’immigration ferait partie. Comme celle-ci constitue maintenant l’unique moteur de la croissance du nombre d’habitants, il deviendra en effet nécessaire de déterminer quel avenir démographique entend poursuivre ce Québec souverain. À cet effet, ce nouveau ministère devra conjuguer une politique de soutien aux familles (volet fécondité), une politique de la santé (volet mortalité) et une politique de l’immigration, une conjonction qui permette d’atteindre l’objectif démographique choisi (hausse, baisse ou stabilité du nombre d’habitants).
- Il ne suffit pas d’accueillir des immigrants, encore faut-il s’assurer de leur intégration socio-économique. Définir une politique d’immigration implique donc nécessairement l’examen de la capacité d’accueil. Jusqu’à présent, la détermination de celle-ci était difficile sinon vaine, car fonction d’un très grand nombre de variables « externes » (comment par exemple évaluer la capacité d’accueil « linguistique » alors que le nombre d’immigrants non francophones est largement déterminé par le gouvernement fédéral ?). Un Québec souverain devra remettre en cause toutes les définitions actuelles de la capacité d’accueil, en réexaminant chacun des critères utilisés et en les repondérant.
- Il nous semble incontournable d’associer la souveraineté du Québec à la pérennité de la langue française. À cet effet, une des premières mesures à prendre sera non seulement de défendre les frontières, mais aussi de défendre l’identité culturelle et linguistique de la population résidant à l’intérieur de ces frontières. Une telle défense implique l’adoption du principe de territorialisation linguistique : dans l’espace public, la seule langue en vigueur est la langue officielle du Québec, à savoir le français. Ce principe est en vigueur de facto dans toutes les sociétés d’immigration, et l’appliquer au Québec ne serait rien de plus que consacrer un principe universel. À cause de la présence d’une minorité anglophone importante dans la région de Montréal, des exceptions devraient cependant être prévues, du moins pour la population anglophone dite historique.
Références bibliographiques
Bureau du directeur parlementaire du budget, 2025. Évaluation de l’incidence du Plan des niveaux d’immigration 2025-2027. Ottawa.
Conference Board of Canada, 2024. Shift in Immigration Goes Too Far. Ottawa.
Doyle, M. et al, 2023. The economics of Canadian immigration levels. Canadian Labour Economics Forum, Waterloo (Ontario), University of Waterloo.
Fortin, P., 2024. L’immigration permet-elle d’atténuer la pénurie de main-d’oeuvre ? Canadian Labour Economics Forum, Waterloo (Ontario), University of Waterloo.
Houle, R. et J.-P. Corbeil, 2021. Scénarios de projection de certaines caractéristiques linguistiques de la population du Québec (2011-2036). Montréal, Office québécois de la langue française.
Institut de la statistique du Québec, 2024. Le bilan démographique du Québec. Édition 2024. Québec.
Office québécois de la langue française, 2024. Langue de l’espace public au Québec en 2022. Montréal.
Polèse, M., 2021. Le miracle québécois. Montréal, Boréal.
Statistique Canada, 2017. Projections linguistiques pour le Canada (2011 à 2036). Ottawa.
Termote, M., 2022. L’immigration et la pérennité du français au Québec. Montréal, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
* Professeur associé, Département de démographie, Université de Montréal.