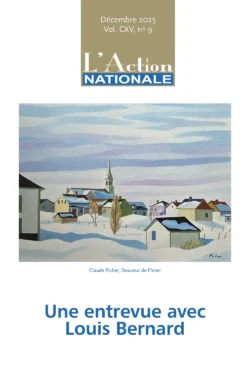Pourquoi parler défense dans le projet souverainiste ? Qu’apporterait la souveraineté en cette matière ? Contrairement à bien d’autres domaines d’activité (tels que la culture, l’économie ou l’immigration), le projet d’accession du Québec au statut d’État souverain ne vise pas (plus), dans le champ des affaires de sécurité militaire, à corriger une injustice perçue ou réelle à l’endroit de la société québécoise. Et, à l’exception des promoteurs d’une approche « pacifiste » que nous aborderons plus loin, l’accession à la souveraineté n’est, en ce domaine, que rarement présentée comme une occasion de faire les choses différemment, en améliorant ce qui se fait déjà à l’échelle canadienne ou en le faisant d’une manière qui correspond mieux aux spécificités de la société québécoise.
Formuler les grandes lignes d’une politique de défense est plutôt un passage obligé pour les ténors souverainistes, pour des raisons de légitimité, de reconnaissance et d’attentes à l’endroit du nouvel État, qui doit se présenter comme étant conscient de ses responsabilités nationales et internationales. Mais cette démarche, qui suscite peu d’écho au sein de la population, ne présente qu’un intérêt très limité comme argument électoral ou référendaire. L’exercice est aussi difficile à faire, car, en ce domaine, tout est à faire et le gouvernement Québec n’a aucune expérience en la matière. Le sujet fait aussi sourire, donnant lieu à des images qui semblent à une caricature ou à un oxymore, comme celle d’un char Léopard ou d’un avion F-35 frappé de cocardes à fleurs de lys, ou encore à des railleries grossières1. Pourtant, bien des sociétés avec une population comparable, comme Israël ou la Suisse, ne font pas figure de « nain militaire », et des États moins populeux s’en tirent aussi bien, comme la Finlande ou la Norvège.
L’objet de ce texte est de faire le point sur la réflexion touchant à la politique de défense d’un Québec souverain et d’identifier les principaux enjeux qui seraient liés à l’obligation, pour Québec, d’accepter des responsabilités dans ce domaine jusque-là assumé par le gouvernement fédéral.
Le rapport entre souveraineté et défense : deux écoles de pensée
L’élaboration d’une politique de défense suppose de répondre préalablement à deux questions fondamentales: l’État entend-il se doter de forces armées ? Et souhaite-t-il se joindre à des alliances militaires?
Les réponses découlent d’un grand nombre de facteurs : évaluation des menaces, attentes du gouvernement et de la population à l’égard des forces armées, définition de l’intérêt national, valeurs dominantes de la société, ressources disponibles, ou encore attitude des autres gouvernements, notamment ceux du Canada et des États-Unis d’Amérique.
Bien qu’il mobilise relativement peu de gens et se répand rarement à l’extérieur de certains cercles très restreints, un débat divise les intervenants qui s’intéressent aux questions liées à la défense d’un Québec souverain2. Un premier groupe, inspiré d’une approche critique, pacifiste et antimilitariste de la défense, rejette ou, à tout le moins, soulève des questions sur la pertinence de constituer des forces armées et de participer aux alliances. Les dépenses consacrées à la défense sont perçues comme un gaspillage ou pire, comme un soutien à une institution dont la principale fonction est de maintenir un ordre social, économique et politique fondamentalement injuste. Les alliances, quant à elles, sont bien souvent considérées comme une forme d’assujettissement des États plus faibles aux grandes puissances et comme une cause importante des guerres. La paix et la sécurité, dans son sens le plus profond, passent par une abolition tant des forces armées que des alliances. Dans cette perspective, l’accession à la souveraineté est vue comme une occasion pour opérer un changement de cap radical : le Québec devrait, au mieux, se doter de « forces de défense territoriale » ou d’une « garde nationale » destinée à opérer au pays ou à contribuer à des opérations de paix, sinon renoncer carrément à toute forme d’organisation militaire, ainsi qu’adopter une position de neutralité assumée.
Bien qu’historiquement marginal, le mouvement pacifiste québécois a exercé une influence relativement importante dans la réflexion sur la défense d’un Québec souverain. En premier lieu, les liens étroits entre l’aile sociale-démocrate du Parti québécois et plusieurs les mouvements sociaux (féministes, ouvriers, étudiants et autres) souvent porteurs d’un discours pacifiste, favorisent l’adoption de positions en ce sens. Les groupes pacifistes atteignent probablement leur zénith au cours des années 1970-1980, à la faveur de la guerre du Vietnam et, plus tard, de la crise des euromissiles3. En second lieu, bon nombre de têtes d’affiche du PQ, René Lévesque le premier, partagent ces idées. Enfin, en troisième lieu, il n’y a, du moins avant 1975, que très peu de gens pour soutenir une position différente. Il faudra deux ans de discussion et beaucoup d’efforts aux dirigeants du parti chargés de penser les relations internationales du futur État pour convaincre les membres d’adopter une posture prévoyant la constitution d’une force armée et la participation aux alliances.
La formulation d’un politique teintée de pacifisme peut, sous bien des aspects, faire sens. Ainsi, la société québécoise, comme celle du Canada dans son ensemble, n’a pas connu, depuis l’échec de la révolte des Patriotes (1837-1838) et celle des Métis du Manitoba (1885), d’épisode de violence à grande échelle pouvant rappeler la nécessité d’entretenir des forces armées. Les guerres auxquelles les soldats provenant du Québec ont participé sont lointaines et ont souvent été éclipsées par des crises internes, comme celles liées à la conscription (1918 et 1942-1944) ou la Crise d’Octobre (1970). Plus encore, le projet souverainiste n’est pas motivé par des craintes concernant la sécurité physique de la population. À bien des égards, la société québécoise se rapproche de ce que Ole Weaver a appelé, dans un tout autre contexte, une « communauté d’asécurité », soit une société dont « les échanges, les institutions et le sentiment d’appartenance sont motivés par d’autres aspirations » que la recherche de la sécurité et de la paix4.
Comme pour une bonne partie de la population canadienne, les souverainistes tendent à associer la sécurité du Québec à la stabilité globale du système international, et donc à se percevoir comme des « citoyens du monde ». Par ailleurs, l’adoption de postures pacifistes semble être un réflexe commun aux « petites nations », comme l’Irlande ou l’Écosse. Le terme « petites nations » désigne ici non pas tant des sociétés composées d’une faible population ou d’un territoire de petite taille, mais plutôt un état d’esprit qui se caractérise par un sentiment d’insécurité identitaire et culturel, et par une crainte d’être assimilé et de disparaitre5. Ces États, soucieux d’afficher leur différence, sont peu enclins à recourir à la guerre (dans lesquels ils ont tout à perdre) et généralement incapables ou réticents à investir dans les forces armées6. Certains tenants d’une position pacifiste estiment au demeurant que la société québécoise a une « tradition antimilitariste7 », ce qui rendrait leurs propositions attrayantes pour la société civile. Enfin, les plus cyniques pourraient dire, en s’inspirant de la formule que l’historien Desmond Morton avait appliquée à la situation stratégique du Canada, que, dans un pays trop grand pour être efficacement défendu et qui par ailleurs ne fait pas face à des menaces militaires immédiates, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence d’entretenir de coûteuses forces armées.
À partir du milieu des années 1970 émerge une seconde perspective de la défense d’un Québec souverain. Celle-ci, plus traditionnelle et qui se veut pragmatique, propose de doter le Québec d’une politique qui aurait toutes les apparences de ce que fait le Canada. Elle donnerait lieu à la création d’une modeste force armée professionnelle et prendrait les mesures pour devenir membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ainsi que pour contribuer au fonctionnement du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (le NORAD). L’idée émane d’abord de certains souverainistes particulièrement intéressés par les relations internationales, comme Claude Morin, Louise Beaudoin ou Bernard Landry et sera appuyée au fil du temps par la plupart des chercheurs consultés sur le sujet.
Plusieurs arguments militent en faveur d’une telle approche. Ainsi, elle permet aux représentants québécois de présenter le nouvel État comme responsable et désireux de contribuer activement à sa propre sécurité, ainsi qu’aux efforts multilatéraux pour assurer la stabilité du système international. Ses tenants font aussi valoir que la création de forces armées répondrait à des besoins nationaux bien réels non seulement de défense militaire proprement dite, mais aussi de sécurité civile. Quant à l’opinion publique, si elle affiche ce qui semble être de l’indifférence, elle a néanmoins évolué depuis quelques décennies.
Le mythe du « Québec pacifiste » a volé en éclat, même si la société civile demeure méfiante face aux interventions militaires qui semblent servir d’abord les intérêts d’une grande puissance comme les États-Unis – ce qui expliquerait la très forte opposition à la participation du Canada à la coalition menée par les États-Unis contre l’Irak en mars 2003. Toutefois, de manière générale, la société québécoise affiche une préférence à l’égard d’une posture « internationaliste », au sens de la politique pratiquée par le Canada après la Seconde Guerre mondiale, et qui préconise une participation active aux institutions internationales, comme l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’OTAN, aux missions de paix ou aux interventions qui, comme au Kosovo en 1999, vise à protéger une population opprimée8. La société québécoise francophone semble aussi s’être lentement réconciliée, depuis le début des années 1990, avec les Forces canadiennes, si bien que la profession militaire est mieux perçue, et que l’armée n’est plus considérée comme une institution d’assimilation ou de persécution des francophones9. Par ailleurs, la société québécoise semble accepter avec moins de réticences la croissance des dépenses militaires au Canada10, une attitude stimulée par l’invasion de l’Ukraine en février 202211 et, peut-être, les menaces de Donald Trump. Il s’agit là d’autant d’indices qui laissent entrevoir que la société civile serait disposée à doter un Québec indépendant d’une armée.
La classe politique québécoise semble aussi plus consciente des enjeux de défense, et ne se cache plus derrière la répartition des compétences entre les paliers de gouvernements pour se tenir loin de ce domaine d’activité. Ainsi, l’arrivée à Ottawa des députés du Bloc québécois, qui seront confrontés à ces questions (surtout lorsqu’ils forment l’opposition officielle, de 1993 à 1997), a obligé les souverainistes à prendre position sur plusieurs enjeux de défense et donc à préciser leur pensée, que ce soit en ce qui a trait au NORAD, à l’acquisition de certains équipements ou aux déploiements des troupes à l’étranger12. Par ailleurs, plusieurs premiers ministres du Québec n’ont pas hésité pas à s’exprimer sur des enjeux liés à la guerre et à la paix. Comme le rappellent Justin Massie et Marjolaine Lamontagne, « Bernard Landry s’est opposé à la guerre contre l’Irak ; Jean Charest s’est exprimé en faveur de la guerre en Afghanistan ; et Pauline Marois s’est dite favorable à une participation canadienne à l’intervention militaire de la France au Mali13. » À cette liste pourrait s’ajouter Philippe Couillard, qui a mainte fois exprimé son soutien aux militaires canadiens déployés à l’étranger, et François Legault, qui a affiché son soutien aux Ukrainiens en butte à l’agression russe.
Enfin, le gouvernement du Québec n’a pas hésité pas à investir dans un champ de compétences connexes à celui de la défense, soit celui de la sécurité, entendue ici plus dans son sens constabulaire que de protection civile. Ce rôle a longtemps été incarné par la Sûreté du Québec, créée en 1870, qui assume essentiellement des tâches de police. Après les attentats du 11 septembre 2001 cependant, le gouvernement du Québec entreprend la formulation d’une politique de sécurité beaucoup plus élaborée, qui comporte un prolongement international significatif, et qui accorde une grande importance à la sécurité frontalière (provoquant ainsi des rivalités avec les institutions fédérales chargées de cette tâche, comme l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada). Ce thème est prégnant dans les politiques internationales du Québec de 2006 et de 2017, ainsi que dans la Stratégie du Québec à l’égard des États-Unis de 201014.
Seule province à s’être donné une telle politique, cette particularité du Québec pourrait bien être motivée par des considérations stratégiques (soit de rassurer les États-Unis, qui constituent le principal point de chute des exportations québécoises) et identitaires (une volonté d’élaborer des politiques conformes aux « valeurs québécoises » et occuper au maximum les champs de compétences dévolus aux provinces)15.
La réflexion au Parti québécois
La position du Parti québécois (PQ) sur les grandes lignes de la politique de défense d’un Québec indépendant oscille, depuis 1968, entre ces deux pôles. Ce mouvement de balancier semble correspondre à la situation du Parti québécois à l’Assemblée nationale. En effet, si la position pacifiste est surtout observable lorsque le PQ est dans l’opposition, la conception pragmatique s’impose lorsqu’il prend le pouvoir et prépare un référendum sur l’accession à l’indépendance, comme ce fut le cas en 1978-1980 et 1992-1995.
Ce mouvement d’une position à l’autre reflète certainement une forme d’opportunisme politique, en fonction des auditoires visés. Le discours critique semble en effet s’adresser plus aux militants proches de la tradition sociale-démocrate du parti. La position plus traditionnelle est susceptible de plaire tant à un électorat plus vaste qui doit être rassuré par le fait que, sur la question de la défense, la souveraineté n’aura pas de grandes conséquences, qu’aux interlocuteurs internationaux mesurant le degré de responsabilité du nouvel État.
En l’absence d’échéance référendaire, il se dit peu de choses sur le sujet. En 2025, le PQ, siégeant dans l’opposition mais pouvant se permettre de rêver à revenir aux affaires, propose un programme qui adopte un ton prudent sur le sujet.
Le Parti Québécois aspire à : faire valoir la voix du Québec au sein des organisations internationales en tant qu’État indépendant ; […] intégrer les organismes de défense et les organisations internationales auxquels nous participons actuellement ; […] doter le Québec d’une garde nationale, qui aura pour mandats principaux le maintien de la paix et l’aide aux populations civiles en détresse, en plus de soutenir la société et nos alliés lors d’événements extraordinaires ; assurer le respect de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que la sécurité de nos infrastructures essentielles, comme nos centrales électriques16.
Dans son étude sur la politique étrangère, Daniel Turp trace également les grandes lignes du volet de sécurité internationale qu’elle devra comporter, et dont devra inévitablement tenir compte la politique de défense.
En sa nouvelle qualité d’État indépendant et du fait de son admission à l’Organisation des Nations unies (ONU), le Québec s’identifie comme un État pacifique et accepte d’agir conformément aux buts et principes de la Charte des Nations unies. Parmi ces buts, on retrouve celles du maintien de la paix et de la sécurité internationales. S’agissant des principes, on retrouve celui de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies et de donner à l’ONU pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
Dans l’ensemble des forums internationaux auxquels il aura dorénavant accès en sa qualité d’État indépendant, le Québec se voudra un promoteur exemplaire de la paix et de la sécurité internationales. Et passant de la parole aux actes, il tiendra à participer aux opérations de maintien, de consolidation et d’imposition de la paix initiées par l’ONU, mais également par d’autres institutions internationales comme l’Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). La nouvelle politique de défense d’un nouvel État québécois indépendant devra également tenir dûment compte de la présente orientation générale et prévoir que les nouvelles Forces de défense québécoises (FDQ) puissent compter sur des effectifs permettant de contribuer aux missions de paix17.
Il s’agit d’une position minimaliste, surtout lorsqu’on la compare à ce qui a été proposé à la veille du référendum de 1995, de loin la position la plus élaborée et la mieux étayée de l’histoire du mouvement souverainiste en ce domaine.
Au printemps 1995, le gouvernement commande une quarantaine d’études sur la « restructuration », c’est-à-dire la prise en charge des champs de compétences fédérales par Québec. Trois de ces recherches portent sur la défense d’un Québec souverain. La première porte sur l’environnement national et international dans lequel devra évoluer un Québec souverain18 ; la seconde fait l’inventaire des ressources et des infrastructures en territoire québécois des Forces armées canadiennes (FAC)19 ; enfin, la troisième propose quatre scénarios pour l’élaboration d’une politique de défense québécoise20.
Aussi poussées soient-elles, ces études reposent sur de nombreux et fragiles postulats. Par exemple, les « quatre scénarios » d’une politique de défense étaient fondés en grande partie sur l’évaluation des ressources militaires présentes en territoire québécois en 1995. Or, rien ne pouvait garantir que le matériel et, surtout, les effectifs recensés seraient effectivement disponibles au lendemain d’un « Oui » majoritaire. Plusieurs critiques ont d’ailleurs été formulées en ce sens21.
La question portant sur la participation aux alliances et aux missions internationales sont vidées par le libellé du Projet de loi sur l’avenir du Québec qui allait être soumis au référendum d’octobre 1995. Il reflétait le choix bien arrêté du gouvernement en cette matière. L’article 17 du projet de loi stipulait que :
Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour que le Québec continue de participer aux alliances de défense dont le Canada est membre. Cette participation doit cependant être compatible avec la volonté du Québec d’accorder la priorité au maintien de la paix dans le monde sous l’égide de l’Organisation des Nations unies.
Les quatre scénarios de la troisième étude sur la défense ont donc été formulés de façon à respecter le libellé de cet article. Ils se résument comme suit (le produit intérieur brut [PIB] du Québec était d’environ 175 milliards $ en 1994-199522) :
- Une défense sans force armée, soit une force de défense du territoire et d’appui aux opérations d’aide humanitaire (budget annuel de 840 millions de dollars, soit 0,5 % du PIB de l’époque) ;
- Une force armée légère, soit une petite force terrestre et un embryon de force aérienne (budget : un milliard de dollars, soit 0,6 du PIB) ;
- Une force armée restructurée (scénario qui correspond aux ressources fédérales en territoire québécois), soit une force terrestre significative, appuyée d’une petite force aérienne et d’un semblant de marine (1,8 milliard de dollars, soit environ 1 % du PIB) ;
- Une force armée accrue, scénario qui consiste à accroître substantiellement les ressources dans la défense par rapport aux dépenses fédérales en territoire québécois (jusqu’à 2,3 milliards de dollars, soit 1,3 % du PIB).
En 1995, le Canada consacre 9,2 milliards au budget de la défense, soit environ 1,55 % de son PIB de l’époque23.
Le mandat des chercheurs spécifie, à cet égard, les éléments suivants :
- maintien des engagements par l’adhésion au Traité de Washington [i.e. l’Alliance atlantique] ;
- présence dans les institutions politiques et militaires de coopération et de consultation (notamment le Groupe de planification Canada–États-Unis) ;
- contribution financière et humaine au fonctionnement de l’OTAN ;
- aucune troupe affectée en permanence à l’extérieur du Québec24.
Tous ces scénarios prévoient l’adhésion du Québec aux Nations unies, à l’OTAN et au NORAD. Dans les scénarios 1 à 3, la participation aux instances militaires et politiques de l’Alliance atlantique demeurait purement symbolique. Seul le quatrième scénario prévoyait de mettre un groupe bataillon à la disposition de l’OTAN en cas d’urgence. En aucun cas, il n’était prévu de contribuer à la défense maritime de l’Atlantique Nord. La participation d’une éventuelle aviation du Québec aux opérations du NORAD était également laissée en suspens, tant était incertain le sort des appareils canadiens déployés sur les bases aériennes situées au Québec. Enfin, un aspect original de ces quatre propositions résidait dans la création d’un « corps civil », appelé « les casques blancs », destiné à assurer des missions d’aide humanitaire.
Comme l’ont cependant noté plusieurs observateurs25, le troisième scénario demeurait le plus probable, ce qui aurait signifié que la politique de défense d’un Québec souverain allait donc ressembler à une version miniature de celle du Canada. Ce résultat n’est pas inattendu, puisque pour la majorité des Québécois francophones, l’organisation de la défense au Canada n’est pas un irritant et encore moins un argument pour quitter la Confédération. Il n’y a pas d’intérêt à réformer en profondeur ce domaine, du moins à court ou moyen terme. De même, dans la mesure où le Québec allait se trouver dans une situation géopolitique semblable à celle du Canada, les orientations militaires de deux États ne peuvent que se ressembler sur un certain nombre de points.
Mais ce choix présente d’autres avantages. Ce scénario étant celui qui demeurait le plus proche de la situation préréférendaire, il est donc le moins susceptible de créer des remous. Il permettrait notamment au gouvernement de réaliser sa promesse de réembaucher tous les Québécois membres des Forces canadiennes. De même, comme le Québec allait hériter de personnels, d’infrastructures et d’équipements des Forces canadiennes, il allait avoir tendance à s’en servir de la même manière, dans une forme élaborée de « dépendance au sentier » (path dependence). Enfin, comme la majorité des militaires québécois allaient provenir des Forces canadiennes, ceux-ci allaient tout naturellement en apporter la culture. Curieusement donc, malgré son inexpérience en la matière, ou peut-être au contraire en raison de cette inexpérience, un Québec souverain sera enclin à reproduire le seul modèle qu’il connait, à savoir l’expérience canadienne.
La dernière partie de ce texte est basée sur l’hypothèse selon laquelle un Québec souverain se doterait d’une politique semblable, mutatis mutandis, à celle du Canada. Ceci signifie la création de forces armées d’une taille proportionnelle à la contribution du Québec aux FAC, et que le nouvel État manifesterait l’intention d’adhérer aux institutions de sécurité internationales dont le Canada est membre (ONU, OTAN, OSCE ainsi que le NORAD et les autres institutions bilatérales pertinentes26, pour ne nommer que les plus importantes). Les pages qui suivent tiennent aussi compte des grandes lignes esquissées dans le Projet national du Parti québécois et dans l’étude de Daniel Turp. Dans l’esprit de ce dernier document, nous emploierons l’expression « Forces de défense du Québec » (FDQ) pour désigner l’institution militaire créée par un Québec souverain.
La finalité d’une politique de défense québécoise : Quelles priorités ? Quelles missions ?
Les intérêts de sécurité du Québec
Ce que l’on pourrait qualifier « d’intérêt national » du Québec en matière de sécurité ressemble fort à celui du Canada. Il peut être résumé par les points suivants. Ainsi, le gouvernement du Québec doit :
- être en mesure d’assurer une surveillance minimale de son territoire et d’y exercer ses fonctions, notamment la prestation de services aux citoyens et le respect des lois ;
- maintenir l’intégrité et la sécurité du territoire ;
- conserver des relations fonctionnelles et amicales avec les États-Unis, ce qui signifie notamment d’éviter que des ennemis des États-Unis ne se servent de son territoire pour opérer en territoire américain, qu’il s’agisse de forces militaires étrangères, de terroristes ou de criminels ;
- protéger ses infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles ;
- contribuer à la stabilité du système international, notamment par la promotion du multilatéralisme, de la primauté du droit, des mécanismes de règlement pacifique des conflits et d’un climat propice aux échanges ;
- se faire reconnaitre comme un membre loyal du camp occidental et de cultiver des relations avec les États européens membres de l’OTAN ;
- promouvoir l’identité et la réputation internationale du Québec.
Les FDQ ne seraient pas les seules responsables de veiller à la défense ou la promotion des intérêts nationaux, mais elles y joueraient cruciales. On notera cependant que, contrairement à la majorité des autres États, les menaces militaires directes sont hautement improbables. En effet, le Québec est, en raison de son isolement géographique, fort peu susceptible de faire l’objet d’une opération militaire de grande ampleur et les seuls dangers en ce domaine serait d’une magnitude telle qu’il ne pourrait s’en prémunir, qu’il s’agisse d’une attaque nucléaire ou d’une opération militaire américaine. En cela, il est dans une situation semblable, voire meilleure, que celle du Canada. Ainsi, même si cette mission est inscrite dans la liste des fonctions des Forces de défense du Québec, il est très peu probable que celles-ci aient effectivement à assumer ce rôle.
Les ressources sur lesquelles d’éventuelles FDQ pourront compter sont bien difficiles à évaluer, tant il y a des facteurs impondérables. Ainsi, combien de Québécois et de Québécoises servant dans la Forces armées canadiennes au moment d’une déclaration d’indépendance accepteront de se joindre aux FDQ ? Et quelles pièces d’équipements militaires le Québec pourra-t-il récupérer ? Il devra, sur ce dernier point, forcément avoir une négociation qui sera incluse dans un vaste calcul du partage des actifs et des passifs.
En ce qui a trait au budget, le calcul peut être une estimation de la contribution du Québec au budget fédéral avant la déclaration d’indépendance, soit un peu moins de 20 %27. Le budget de la Défense étant fixé à 30,5 milliards $ en 2024-2025 (et appelé à croître au cours des années suivantes), on peut estimer que le Québec pourra y consacrer environ 6 milliards de dollars28. Toutefois, ce chiffre pourrait être revu à la baisse si le gouvernement doit faire face à d’autres priorités, ou à la hausse si des projets plus couteux sont retenus, comme ceux de se conformer aux exigences de l’Alliance atlantique (et des États-Unis) en consacrant l’équivalent de 2 % PIB au budget de la défense, ou encore de reconstituer rapidement un embryon de marine et d’aviation (nous y reviendrons).
Les missions nationales
Les FDQ auront à assumer les missions nationales que remplissent Forces armées canadiennes dont, au premier chef, l’assistance aux autorités civiles. On distingue deux types d’activité associés à cette fonction. D’une part, les trois composantes d’une forces armée nationale (terrestre, aérienne et navale) doivent être en mesure de conduire des opérations de secours et d’aide humanitaire. Elles doivent pouvoir mener des opérations de recherche et sauvetage (en région éloignée ou en mer), d’évacuer les populations menacées par des catastrophes naturelles (incendies de forêt, inondation) ou de contribuer à en limiter les impacts. Depuis le milieu des années 1990, les très nombreuses interventions des Forces armées canadiennes lors d’incidents au Québec, qui vont des inondations au Saguenay en 1996 jusqu’au déploiement de militaires dans certains CHSLD (centres hospitaliers de soin de longue durée) grevés par le manque de personnel lors de la pandémie de COVID-19 en 2020, ont grandement contribué à améliorer la perception de l’institution militaire parmi la population, notamment en illustrant l’importance de ces fonctions. Compte tenu des bouleversement engendrés par les changements climatiques, de telles opérations sont inévitablement appelés à se multiplier.
D’autre part, les forces armées doivent pouvoir assister les autorités civiles chargée du maintien de l’ordre, que ce soit lors d’événements rassemblant un très grand nombre de personnes (comme un sommet de chefs de gouvernement) ou de désordres civils d’une ampleur telle que les forces de police s’avèrent insuffisantes. Il va sans dire que les principes et le processus permettant aux autorités de recourir aux ressources des forces armées, de même que les pouvoirs qui peuvent être conférés à celle-ci, doivent être très soigneusement encadrés par la législation. Celle-ci doit, entre autres, insister sur le caractère exceptionnel d’un tel recours et prévoir des mécanismes serrés de reddition de comptes.
Bien qu’il y ait débat sur cette question, il est important de maintenir une distinction entre les services de police et les forces armées. Les premières sont en effet en contact quotidien avec les citoyens et leurs tâches, bien que souvent exigeantes et dangereuses, ne nécessitent que très rarement le recours à des moyens aussi lourds que ceux que possèdent les forces armées. L’une des voies que pourraient vouloir explorer les responsables du nouvel État pour réaliser ces tâches est de s’éloigner du modèle britannique et de se doter d’un « corps intermédiaire », comme une gendarmerie ou une garde nationale. Cette troisième branche, située entre la police et l’armée proprement dite, est généralement chargée des opérations d’assistance aux autorité civiles, laissant aux forces armées les tâches qui relèvent plus des menaces externes et lui laissant le rôle de ressources d’ultime recours, et peut être employée comme auxiliaire tant de la police que des forces armées, selon les besoins. Toutefois, elle peut entrainer des coûts supplémentaires liés à la création d’une organisation distincte.
Une autre institution militaire que le Québec devrait choisir de maintenir en activité est le 2e Groupe-Patrouille des Rangers canadiens, qui comptent 700 membres (dont la grande majorité est issu des Premières Nations et des communautés inuites) et autant de Rangers juniors29. Les Rangers sont des auxiliaires des Forces canadiennes recrutés dans des communautés éloignées des grands centres et organisés en patrouilles de 20 à 30 personnes. Ils sont présents dans une trentaine de communautés disséminées à travers le Québec. Leurs tâches consistent à rapporter tout événement ou activité insolite, à jouer le rôle de premier répondant lors de catastrophe ou d’opération de recherche et sauvetage, et de servir de guide et de mentors aux militaires réguliers lorsque que ceux-ci sont déployés dans une région isolée. Depuis le tournant des années 2000, les Rangers ont aussi une fonction sociale extrêmement importante en encadrant le programme des Rangers juniors. Celui-ci vise à contrer les problèmes socio-économiques frappant particulièrement les jeunes de ces communautés (dépendances, dépression, suicide et autres) en les familiarisant avec la culture et le savoir ancestral, et en particulier avec les techniques de survie sur le territoire.
Le maintien de forces terrestres est aussi rendu essentiel par la nécessité de rassurer les États-Unis sur la capacité du gouvernement du Québec à veiller à éviter que des acteurs hostiles opèrent en sol américain à partir du territoire québécois. Ce principe, appelé « Serment de Kingston », guide implicitement les relations de sécurité entre le Canada et les États-Unis depuis la fin des années 1930 et vise à préserver la souveraineté canadienne contre une « aide » militaire américaine en territoire canadien, aide dirigée contre une menace mettant en péril la sécurité des États-Unis30. C’est le sens de la démarche entamé en 2006 par le gouvernement du Québec évoquée plus haut et qui consistait à ajouter un important volet « sécurité » à la politique internationale du Québec.
Enfin, la mise en place de force armées entraine la création de services de renseignement et de la panoplie d’acteurs capables de faire face aux formes alternatives d’agression, comme la désinformation, l’ingérence, les cyberattaques ou le sabotage d’infrastructures critiques. Une grande partie des agences chargées de lutter contre ces menaces peuvent être civiles, mais les forces armées doivent aussi avoir des capacités en ce sens, ne serait-ce que pour se protéger elles-mêmes.
Si la constitution de forces terrestres québécoises ne pose pas de problème insoluble, il en va différemment pour l’aviation et, surtout, la marine. L’équipement de ces deux branches est particulièrement coûteux et la capacité du gouvernement du Québec à les maintenir va, en partie, dépendre, du moins dans les années qui suivront immédiatement l’accession à la souveraineté, des résultats des négociations avec Ottawa pour conserver une partie des ressources des Forces armées canadiennes.
La branche navale risque d’être le parent pauvre des Forces de défense du Québec, ceci pour deux raisons. D’une part, il y a très peu d’installations de la Marine royale canadienne (MRC) et de la Garde côtière canadienne au Québec : les installations de la Réserve navale du Canada (dont la division NCSM Donnacona), la base de la garde côtière et le Centre de sauvetage maritime à Québec, quelques postes de sauvetage et des centres de communication. Comme pour les autres armes, le transfert d’une partie du matériel canadien au Québec dépendra largement de négociations entre les deux gouvernements. Toutefois, sachant que les navires de patrouille ou de combat peuvent coûter extrêmement cher, le nouvel État pourra avoir d’autres priorités s’il n’en obtient pas du Canada. Plus encore, comme il y a relativement peu de Québécois francophones dans la MRC, la question du personnel d’une éventuelle force maritime québécoise demeure incertaine. Il est fort probable que le Québec s’en tiennent à une garde côtière destinée à opérer dans le Saint-Laurent et son estuaire. La seconde raison est que le tracé des frontières maritimes du Québec demeure encore flou31. Le long de la façade maritime nord (baie James, baie d’Hudson et détroit d’Hudson), la frontière avec le Nunavut est réputée courir le long du rivage, et donc que les eaux et les iles qui s’y trouvent font partie du Nunavut. Quant au golfe du Saint-Laurent, il sera lui-même enclavé par les eaux canadiennes, selon un tracé qui demeure à préciser.
Les engagements internationaux
Depuis le début des années 1980, les différents projets souverainistes portés par le PQ prévoient que le Québec fasse des demandes d’admission ou d’accession aux institutions internationales de sécurité soit, au premier chef, l’ONU, l’OSCE le NORAD et l’OTAN32. Aux lendemains d’une reconnaissance internationale du Québec, une demande d’admission à l’ONU et une participation à l’OSCE ne devraient pas poser de problèmes et se traduirait vraisemblablement par des demandes d’une contribution civile ou militaire à des opérations de paix.
En ce qui a trait à l’OTAN, la démarche d’adhésion sera régit par l’article X du Traité de Washington, qui fixe les modalités par lesquelles un nouvel État peut être convié à y accéder : « Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre État européen susceptible de favoriser le développement de principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord ». Les mots clef ici sont « unanime » et « européen ». D’une part, la candidature québécoise devra faire l’objet de l’assentiment de tous les membres. Le Québec n’étant à l’évidence pas un État européen, la référence au continent contenu dans l’article X devra être ignorée pour que le nouvel État soit admis33, ceci même si cet article a été formulé par les membres fondateurs (dont le Canada et les États-Unis) pour prévenir l’élargissement de l’Alliance hors de la zone de l’Atlantique Nord
En s’engageant à l’égard de l’Alliance, le gouvernement du Québec devra s’engager à consacrer l’équivalent de 2 % de son produit intérieur brut à son budget de la Défense, ce qui pourrait bien en faire rechigner certains. Ainsi, si l’on prend pour base de calcul le PIB du Québec en 2022 soit 551,7 milliards34, alors le budget annuel de la défense devra atteindre les 11 milliards de dollars.
Concernant l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, une révision ou un amendement de cet accord serait nécessaire et devrait se faire en application de l’article III de celui-ci pour que le Québec en devienne partie. Une adhésion au NORAD pourrait aussi être difficile, dans la mesure où le gouvernement américain pourrait être réticent à voir un troisième gouvernement se mêler de la surveillance et de la défense aérospatiale de son territoire. Si les officiers canadiens dépêchés au quartier général de Colorado Spring sont bien acceptés, leurs homologues québécois pourraient susciter une certaine méfiance due à la nouveauté. Par ailleurs, la question de la contribution du Québec à ce commandement pourrait poser problème. Si le nouvel État n’est pas équipé d’appareils capables de mener des missions d’interception, la pertinence de sa participation devient un enjeu, puisqu’il ne possède aucune infrastructure ou ressource essentielle au fonctionnement du NORAD. Les effectifs et appareils basés à Bagotville pourrait être relocalisés en Ontario. Washington pourrait trouver plus simple de négocier une entente permettant aux intercepteurs de l’US Air Force d’opérer dans le ciel du Québec en cas de nécessité, peut-être en échange d’un accès à certaines informations sur le trafic aérien.
Le résultat final pourrait donc être que le Québec ne pourrait adhérer ni à l’OTAN, ni au NORAD, et donc se retrouver de facto dans la position d’un État neutre. Ainsi, par la force des choses, et malgré la volonté des dirigeants politiques, la politique de défense du Québec pourrait être plus proche de l’idée que s’en fait l’aile plus pacifiste du mouvement indépendantiste.
Une autre possibilité pour le Québec serait, comme en d’autres secteurs d’activité, de tenter de trouver un accord avec le Canada pour maintenir une forme de coopération en matière de défense, ce qui serait sans doute l’option la moins coûteuse et la plus simple à mettre en oeuvre. Mais cette posture, certes pragmatique, pourra fort bien se heurter à la mauvaise volonté de l’une ou l’autre des parties, à une incompatibilité de vue ou, tout simplement, à un désir de maintenir une distance pour bien marquer une identité distincte.
Conclusion : L’Irlande de l’Amérique du Nord
Un État doté d’une petite armée, ainsi que de forces aériennes et navales réduites, comptant quelques milliers de soldats, neutre mais très actif aux Nations unies et dans les opérations de paix, et soucieux de maintenir une distance avec son ancien colonisateur. Cette description, qui pourrait s’appliquer à la politique de défense du Québec, est celle de la politique de défense de l’Irlande. Les deux États ont d’ailleurs beaucoup en commun : Ils sont souvent mentionnés comme étant des prototypes des « petites nations », ont un produit intérieur brut semblable, appartiennent à la région atlantique, et sont traditionnellement réticents à investir dans les activités de défense, pour ne nommer que quelques traits.
Cette proximité peut indiquer dans quelle direction la suite de la réflexion peut se diriger. En 1995, parmi les recherches préliminaires visant à préparer la définition des scénarios évoqués plus haut, figure une série d’études comparatives présentant des traits semblables avec le Québec, comme par exemple les États scandinaves (Suède, Danemark, Norvège) ou la Finlande. Trente ans plus tard, une mise à jour de ces travaux s’impose. Dans le même ordre d’idées, une nouvelle recension des ressources du ministère de la Défense nationale du Canada au Québec (personnel, infrastructure, matériel), ceci d’autant plus que, dans le contexte actuel, il y a tout lieu de croire que d’importants investissements seront faits au cours des années à venir.
1 La palme, à cet égard, appartient certainement à l’éditorialiste Claude Masson qui tourne en ridicule la volonté de Jacques Parizeau de créer un force armée québécoise, sans toutefois fournir le moindre argument ! Claude Masson, « Notre fleuron : notre armée », La Presse, 25 avril 1992, p. B2.
2 Michel Fortmann, « Les soldats de Le Hir », Le Devoir, Montréal, 18 octobre 1995 ; Stéphane Roussel (avec la coll. de Chantal Robichaud), « L’élargissement virtuel : un Québec souverain face à l’OTAN (١٩٦٨-١٩٩٥) », Les cahiers d’histoire de l’Université de Montréal, vol. 20, no 2, hiver 2001, p. 147-193.
3 Ronald Babin et Jean-Guy Vaillancourt, « Le néo-pacifisme québécois », Revue internationale d’action communautaire, vol. 12, no. 52, automne 1984, p. 27-34 ; Jean-Guy Vaillancourt, « Deux nouveaux mouvements sociaux québécois : le mouvement pour la paix et le mouvement vert », dans Gérard Daigle et Guy Rocher, dir., Le Québec en jeu, comprendre les grands défis, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, p. 791-807. Notons que l’invasion américaine de l’Irak va brièvement réanimer certains mouvements.
4 Ole Waever, « Insecurity, security, asecurity in the West European non-war community », dans Emanuel Adler et Michael Barnett, dir., Security Communities, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 76-77.
5 Sur le concept de « petite nation » voir Jean-François Laniel et Joseph Yvon Thériault, dir., Les Petites Nations. Culture, politique et universalité, Paris, Garnier, 2020.
6 Paul C. Adams, « The September 11 Attacks as Viewed from Quebec: The Small-Nation Code in Geopolitical Discourse », Political Geography, vol. 23, août 2004, p. 765-795.
7 Serge Mongeau, « La tradition antimilitariste au Québec », dans Serge Mongeau, dir., Pour un pays sans armée, Montréal, Écosociété, 1993, p. 81-89. Pour une critique, Antoine Robitaille, « Les Québécois, pacifistes ou pacifiques ? » dans Michel Venne, dir., L’Annuaire du Québec 2004, Saint-Laurent, Fides, 2003, p. 53-64. Le terme « tradition pacifiste » est souvent associé au souverainisme, mais son sens demeure flou. Par exemple, Pierre Dubuc, Le Québec et la guerre en Ukraine. La tradition pacifiste québécoise mise à mal, Montréal, Éditions du Renouveau québécois, 2023. Si la « tradition » est mentionnée dans le titre de l’ouvrage, elle n’est pas abordée dans l’ouvrage, sinon de manière implicite dans le dernier chapitre, p. 201 à 211.
8 Stéphane Roussel et Jean-Christophe Boucher, « The Myth of the Pacific Society: Quebec’s Contemporary Strategic Culture », dans Duane Bratt et Christopher J. Kukucha, dir., Reading in Canadian Foreign Policy : Classic Debates and New Ideas, Toronto, Oxford University Press, 2015 (3e éd.), p. 308-325.
9 Julien Lauzon-Chiasson et Stéphane Roussel, « Bilinguisme et fait francophone dans les Forces armées canadiennes », dans Isabelle Caron, dir., L’Éternelle oubliée : la francophonie dans les politiques publiques au Canada, Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 2022, p. 129-156.
10 Justin Massie et Jean-Christophe Boucher, « Militaristes et anti-impérialistes : les Québécois face à la sécurité internationale », Études internationales, vol. XLIV, no 3, septembre 2013, p. 359-385.
11 Selon les chiffres fournis par Mathieu Landriault, Université d’Ottawa (échange du 21 janvier 2025).
12 Stéphane Roussel et Charles-Alexandre Théorêt, « Defense Policy Distorted by the Sovereignist Prism? The Bloc Québécois on Security and Defence Questions (1990-2005) », dans David Carment et David Bercuson, dir., The World In Canada : Diasporas, Demography, and Domestic Policy, Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2007, p. 169-188.
13 Justin Massie et Marjolaine Lamontagne, « Par-delà les champs de compétence : L’affirmation du Québec en matière de guerre et de paix », Revue canadienne de science politique, vol. 51 no 3, septembre 2018, p. 573.
14 Ministère des relations internationales du Québec, La politique internationale du Québec. La force de l’action concertée, Québec, 24 mai 2006 ; Ministère des relations internationales du Québec, « Le Québec : un acteur important pour la sécurité du continent nord-américain », L’action internationale du Québec, no 3, juillet 2008 ; Gouvernement du Québec, Stratégie du Québec à l’égard des États-Unis, Québec, Ministère des relations internationales, janvier 2010 ; Gouvernement du Québec, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Le Québec dans le monde : S’investir, agir, prospérer (La politique internationale du Québec), Québec, MRIF, 2017.
15 Jean-Christophe Boucher, Jean-François Payette et Stéphane Roussel, « The Securitization and Internationalization of Quebec’s Public Security Policy (2001-2019) », dans Andrea Charron, Alex Moens et Stéphane Roussel, dir., The Legacy of 9/11 and the Idea of “North America”, Montréal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2023, p. 197-213 ; David Morin, Stéphane Roussel et Carolina Reyes Marquez « The Politicization of Québec’s Border Security » dans Christian Leuprecht et Todd Hataley, dir., Security. Cooperation. Governance. The Canada-United States Open Border Paradox, Ann Harbor (Mi), University of Michigan Press, 2023, p. 121-138.
16 Parti québécois, Le projet national, s.l. n. d, consulté le 18 janvier 2025 à https://pq.org/wp-content/uploads/2024/08/cahier-projet-nationalv2-1.pdf
17 Daniel Turp, « Penser le Québec indépendant II – La politique étrangère d’un Québec indépendant », L’Action nationale, vol. CXIV, no 8, octobre 2024, p. 61. https://action-nationale.qc.ca/penser-la-politique-etrangere-dun-quebec-independant/ (mis en ligne le 13 novembre 2024)
18 Yves Bélanger, Charles-Philippe David et Stéphane Roussel, Note de recherche sur les questions de Défense, Québec, Ministère du Conseil exécutif, septembre 1995. Quatre des cinq chapitres constituant ce document ont été publiés : Charles-Philippe David et Stéphane Roussel, Environnement stratégique et modèles de défense. Une perspective québécoise, Montréal, Méridien, 1996 ; Yves Bélanger (avec la coll. d’Aude Fleurant et de Céline Métivier), L’industrie de défense du Québec : Dynamique et enjeux, Montréal, Méridien, 1996.
19 Groupe Marcon, Étude sur le ministère de la Défense nationale, Québec, Ministère du Conseil exécutif, août 1995.
20 Comité d’étude sur la défense, Quatre scénarios de restructuration de la défense d’un Québec souverain, Québec, Ministère du Conseil exécutif, 27 septembre 1995. Un résumé des quatre scénarios a été publié dans Yves Bélanger, Charles-Philippe David et Stéphane Roussel, « La défense d’un Québec souverain. Quatre scénarios possibles », Le Devoir, Montréal, 18 octobre 1995, p. A9.
21 Michel Fortmann, op. cit. Voir aussi Ann Gibbon, « Rivals exchange shots over question of Quebec defence », The Globe and Mail, 13 octobre 1995.
22 Finances Québec, « Statistiques budgétaires », Le budget en chiffres, mars 2019 (https://www.budget.finances.gouv.qc.ca/statistiques-budgetaires/fr/table-28.html)
23 Macrotrends, Canada Military Spending/Defense Budget 1960-2025, https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/CAN/canada/military-spending-defense-budget.
Consulté le 21 janvier 2025.
24 Comité d’étude sur la défense, Quatre scénarios de restructuration de la défense d’un Québec souverain, Québec, Ministère du Conseil exécutif, 27 septembre 1995.
25 Par exemple, Philippe Cantin, « Pas de place dans un Québec souverain pour 12 000 employés du fédéral », La Presse, 30 septembre 1995.
26 Telles que la Commission canado-américaine conjointe de Défense (PJBD), mais le nombre exact d’ententes entre le Canada et les États-Unis est en perpétuelle évolution.
27 Parti québécois, Un Québec libre de ses choix. Finances d’un Québec indépendant, octobre 2023, p. 40. https://pq.org/independance/finances-quebec-independant/
28 En 2023, le Parti québécois estimait cependant que la part du Québec à la défense nationale du Canada était de 14,4 % en 2021-2022 (soit 3 581 598 $ de l’époque). Ibid., p. 48.
29 P. Whitney Lackenbauer, Magali Vullierme et Stéphane Roussel, L’histoire des Rangers canadiens du Québec. Le 2 Groupe de Patrouilles des Rangers canadiens, Otterville (On.), North American and Arctic Defense and Security Network & 2e Groupe de Patrouilles des Rangers canadiens, 2022. https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2022/03/histoire-2GPRC-fr-PWL-MV-SR-apr2022.pdf
30 Kim Richard Nossal, Stéphane Roussel et Stéphane Paquin Politique internationale et défense au Canada et au Québec, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2023 (2e éd.), p. 58, 382-384 et 389.
31 Henri Dorion et Jean-Paul Lacasse, Le Québec : territoire incertain, Québec, Les éditions du Septentrion, 2011 ; André Binette, « Le territoire du Québec souverain », dans Gilbert Paquette, André Binette et Ercilia Palacio-Quintin, dir., L’Indépendance, Maintenant !, Montréal, Michel Brûlé, 2012, p. 117-133.
32 Sur la question de la succession du Québec à ces traités, voir Daniel Turp et Frédéric Gouin, Étude sur la succession du Québec aux traités auxquels le Canada est partie dans l’hypothèse d’une accession du Québec à la souveraineté. 1991 http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=46292 ; Daniel Turp et Patrick Dumberry, L’accession du Québec à la souveraineté et la succession d’États en matière de traités – Mise à jour et complément de 2001 https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/institutions-constitution/commision-souverainete-1991-1992/23-DanielTurp.pdf.
33 S. Neil MacFarlane, Sovereignty and Stability: The Domestic and Regional Security Implications of Québec Separation, Hanover, The John Sloan Dickey Center for International Understanding – Dartmouth College, 1997 p. 56-57; Remy Hyppia, “An Independent Quebec in NORAD and NATO: A Long and Winding Road?”, The American Review of Canadian Studies, vol. 27, no 1, printemps 1997, p. 105-119
34 Institut de la statistique du Québec, « Produit intérieur brut selon les revenus, Québec, 1981-2023 », mise à jour le 20 décembre 2024. https://statistique.quebec.ca/fr/document/comptes-economiques-des-revenus-et-depenses-du-quebec-annuels/tableau/produit-interieur-brut-selon-les-revenus-quebec
* Professeur titulaire, École nationale d’administration publique (ENAP).
** L’auteur tient à remercier les professeurs Nicolas Marceau et Daniel Turp pour leurs commentaires et les précisions qu’ils ont apporté à ce texte. Celui-ci reprend par ailleurs des passages de Stéphane Roussel (avec la coll. de Chantal Robichaud), « L’élargissement virtuel : un Québec souverain face à l’OTAN (1968-1995) », Les cahiers d’histoire de l’Université de Montréal, vol. 20, no 2, hiver 2001, p. 147-193.